L’annonce a frappé comme un coup de tonnerre dans les capitales européennes. Le jeudi 18 octobre 2025, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a révélé au monde qu’un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine se tiendra à Budapest, possiblement dans les deux prochaines semaines. Cette déclaration, faite sans consulter les partenaires européens, marque un tournant absolument radical dans la gestion de la guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis l’invasion russe de février 2022, Poutine — recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre — s’apprête à poser le pied dans une capitale membre de l’Union européenne et de l’OTAN. Et cette capitale, c’est celle du dirigeant le plus pro-russe d’Europe, un homme qui n’a cessé de saboter les sanctions contre Moscou et de bloquer l’aide militaire à Kiev. Le choix de Budapest n’est pas anodin, il est explosif. Il témoigne d’une volonté délibérée de marginaliser l’Europe dans les négociations sur l’avenir de l’Ukraine, de transformer le conflit en un duel entre deux empires — Washington et Moscou — tandis que les Européens sont condamnés à regarder, impuissants et humiliés.
Ce sommet survient dans un contexte toxique où les tensions entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ont atteint des niveaux inédits. Vendredi 17 octobre, lors d’une réunion à la Maison-Blanche, Trump aurait littéralement hurlé sur Zelenskyy, lui ordonnant d’accepter les exigences russes sous peine de voir son pays « détruit ». Selon plusieurs sources médiatiques, le président américain aurait même jeté des cartes sur la table en exigeant que l’Ukraine cède le Donbass — les régions orientales de Donetsk et Louhansk — à la Russie. Le lendemain, Trump annonçait publiquement sa rencontre avec Poutine à Budapest, une décision qui a semé la panique à Kiev et dans toute l’Europe. Car derrière ce sommet se cache une question terrifiante : Trump est-il en train de négocier un accord dans le dos de l’Ukraine ? Va-t-il sacrifier la souveraineté ukrainienne pour obtenir une victoire diplomatique rapide avant les élections américaines ? Et surtout, l’Europe a-t-elle encore son mot à dire dans cette partie d’échecs géopolitique où son propre avenir se joue sans elle ?
Le choix empoisonné de Budapest

La sélection de Budapest comme lieu de rendez-vous entre Trump et Poutine constitue en elle-même un affront calculé envers l’Union européenne. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, entretient depuis des années une relation étroite et ambiguë avec le Kremlin. Il a systématiquement bloqué ou affaibli les sanctions européennes contre la Russie, refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine, et multiplié les déclarations hostiles envers Zelenskyy. En juillet 2024, alors que la Hongrie assurait la présidence tournante de l’Union européenne, Orbán s’était lancé dans ce qu’il avait appelé une « mission de paix », se rendant d’abord à Moscou pour rencontrer Poutine, puis en Floride pour voir Trump — alors simple candidat à la présidentielle américaine. Cette initiative solitaire avait été vivement critiquée par Bruxelles, qui y voyait une tentative de saper la position commune européenne sur l’Ukraine. Aujourd’hui, Orbán se présente comme le médiateur providentiel, celui qui peut rapprocher les deux leaders les plus puissants de la planète. Mais cette médiation cache en réalité une stratégie bien plus cynique : affaiblir l’Europe de l’intérieur, éroder sa cohésion, et faire de la Hongrie le pivot d’un nouvel ordre européen aligné sur Moscou.
Le choix de Budapest pose également un problème juridique majeur. Depuis mars 2023, Vladimir Poutine fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) pour son implication présumée dans la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie. En théorie, tous les pays signataires du Statut de Rome — y compris la Hongrie — sont tenus d’arrêter Poutine s’il entre sur leur territoire. Mais en avril 2025, lors d’une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (lui aussi recherché par la CPI), Orbán a annoncé que la Hongrie allait se retirer de la Cour. Ce retrait ne sera effectif qu’en juin 2026, ce qui signifie qu’en théorie, la Hongrie reste pour l’instant juridiquement obligée d’exécuter le mandat. Mais personne n’est dupe : Orbán a clairement fait savoir qu’il n’avait aucune intention d’arrêter Poutine. « Viktor Orbán a déjà montré qu’il pouvait ignorer ses obligations internationales, donc il le laissera venir au nom de la paix », a déclaré avec résignation un diplomate européen. Cette violation anticipée du droit international envoie un signal dévastateur : l’État de droit européen peut être bafoué impunément quand les intérêts politiques l’exigent.
La logistique cauchemardesque du voyage de Poutine

Mais comment Poutine va-t-il physiquement se rendre à Budapest sans se faire arrêter ? La question peut sembler anecdotique, mais elle révèle toute la complexité — et l’absurdité — de cette situation. Pour atteindre la Hongrie depuis Moscou, l’avion présidentiel russe devrait normalement survoler des pays membres de l’Union européenne et signataires du Statut de Rome, notamment la Pologne, la Roumanie ou encore la Slovaquie. Or, selon le droit international, l’espace aérien d’un pays est considéré comme son territoire souverain, ce qui signifie qu’un avion transportant un criminel recherché pourrait théoriquement être intercepté et contraint de se poser. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, a d’ailleurs clairement averti que si Poutine tentait de survoler la Pologne, l’armée de l’air polonaise pourrait forcer son appareil à atterrir pour le remettre à la CPI. « Je ne peux pas garantir qu’un tribunal polonais indépendant n’ordonnera pas au gouvernement d’escorter un tel appareil au sol pour remettre le suspect à la cour de La Haye », a-t-il déclaré à Radio Rodzina. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a immédiatement qualifié cette menace d’« acte terroriste ».
Face à ce risque, plusieurs scénarios sont envisagés. Le premier serait que Poutine emprunte un itinéraire détourné, en contournant l’Europe par le sud — peut-être en survolant la Turquie, la mer Noire, puis la Bulgarie et la Serbie, deux pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne ou qui entretiennent des relations plus amicales avec Moscou. Mais ce trajet allongerait considérablement le voyage et exposerait davantage Poutine à d’éventuels risques sécuritaires. Une autre option, plus audacieuse, serait que Trump propose à Poutine de voyager ensemble sur le même avion — Air Force One, l’appareil présidentiel américain, bénéficiant d’une immunité diplomatique totale. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié cette idée d’« excellente version » lorsqu’elle a été évoquée par les médias, bien qu’il ait ensuite précisé qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise. Cette possibilité, aussi spectaculaire soit-elle, illustre à quel point Trump est prêt à aller loin pour faciliter cette rencontre — quitte à offrir à Poutine une protection diplomatique américaine contre les juridictions internationales.
La colère de Zelenskyy face à l'humiliation hongroise

Du côté ukrainien, le choix de Budapest a été accueilli avec une fureur à peine contenue. Dimanche 20 octobre, Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il ne considérait « pas Budapest comme le lieu le plus approprié pour une telle réunion », citant les efforts constants d’Orbán pour diluer les sanctions contre la Russie et son opposition à toute aide militaire pour l’Ukraine. « Il y avait de nombreuses autres alternatives viables : la Suisse, l’Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie », a-t-il déclaré, laissant transparaître son exaspération. Pourtant, Zelenskyy a également indiqué qu’il serait prêt à participer au sommet de Budapest s’il recevait une invitation, à condition que le format permette une véritable négociation tripartite — et non un simple accord entre Trump et Poutine conclu dans son dos. « Je suis prêt à aller à Budapest si c’est une invitation dans un format où nous nous rencontrons tous les trois, ou ce qu’on appelle la diplomatie de la navette — Trump rencontre Poutine et Trump me rencontre — alors d’une manière ou d’une autre, nous accepterons », a-t-il précisé.
Cette position traduit un dilemme tragique pour l’Ukraine : Zelenskyy ne peut pas se permettre de refuser catégoriquement de participer aux négociations, au risque d’être accusé d’intransigeance et de perdre le soutien occidental. Mais il ne peut pas non plus accepter aveuglément un sommet organisé dans des conditions aussi défavorables, sous l’égide d’un dirigeant ouvertement hostile à Kiev et dans un contexte où Trump semble de plus en plus enclin à faire des concessions massives à Poutine. Cette tension est exacerbée par les événements de la semaine précédente. Le 17 octobre, lors de sa visite à la Maison-Blanche, Zelenskyy a vécu ce que plusieurs médias ont qualifié de « match de cris ». Selon des sources anonymes citées par le Times of India, Trump aurait hurlé sur le président ukrainien, lui ordonnant d’accepter les conditions de Poutine sous peine de voir l’Ukraine « détruite ». Des cartes géographiques auraient même été jetées sur la table, montrant les territoires que l’Ukraine devrait céder — principalement le Donbass. Zelenskyy a qualifié cette rencontre de « franche » dans ses déclarations publiques, un euphémisme diplomatique pour décrire ce qui était manifestement une confrontation brutale.
L'Alaska et ses leçons ignorées

Cette annonce d’un sommet à Budapest intervient après l’échec retentissant d’une première rencontre entre Trump et Poutine, qui s’était tenue en août 2025 en Alaska. Le 15 août, les deux dirigeants s’étaient retrouvés sur la base militaire américaine de Joint Base Elmendorf-Richardson, à Anchorage, pour discuter de la guerre en Ukraine. Trump avait alors qualifié cette réunion de « très productive », affirmant qu’ils avaient fait de « grands progrès ». Mais la réalité était bien plus décevante : aucun accord n’avait été annoncé à l’issue du sommet, et les deux leaders étaient repartis sans avoir trouvé de terrain d’entente. Poutine avait clairement rejeté l’appel de Trump à un cessez-le-feu immédiat, réaffirmant que la Russie ne se contenterait pas d’un simple gel des lignes de front mais exigeait une « paix durable à long terme » — ce qui, dans le langage du Kremlin, signifie la reconnaissance de l’annexion des territoires ukrainiens et des garanties de sécurité pour la Russie qui empêcheraient l’Ukraine de rejoindre l’OTAN.
Pourtant, Trump avait laissé entendre après cette rencontre que le fardeau reposait désormais sur l’Ukraine pour accepter de céder du territoire afin de mettre fin à la guerre. Cette position avait provoqué une onde de choc en Europe et à Kiev, où beaucoup y voyaient le signe que Trump était prêt à abandonner l’Ukraine pour obtenir une victoire diplomatique rapide. Six semaines plus tard, en annonçant le sommet de Budapest, Trump semble avoir doublé la mise, adoptant un ton encore plus conciliant envers la Russie. Il a même suggéré publiquement que l’Ukraine et la Russie devraient « arrêter là où elles sont » et « cesser les tueries ». Cette formulation, apparemment simple, cache en réalité une capitulation totale des principes que l’Occident défend depuis trois ans : le respect de la souveraineté territoriale, le rejet de l’annexion par la force, et le droit de l’Ukraine à choisir librement son avenir. En demandant un gel des lignes de front, Trump entérine de facto les conquêtes russes, transformant l’occupation militaire en frontière politique.
Les Européens tentent de reprendre la main

Face à cette offensive diplomatique américano-russe, les dirigeants européens ont tenté — tardivement et maladroitement — de reprendre l’initiative. Le mardi 21 octobre, onze leaders européens, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président français Emmanuel Macron, ont publié une déclaration commune affirmant leur soutien à la position de Trump selon laquelle « les combats doivent cesser immédiatement » et que « la ligne de contact actuelle devrait être le point de départ des négociations ». Cette déclaration, publiée par le gouvernement britannique, visait à montrer que l’Europe n’était pas exclue du processus de paix et qu’elle restait solidaire de l’Ukraine. Mais elle contenait également un avertissement à peine voilé à l’adresse de Moscou : « Les tactiques dilatoires de la Russie ont montré à maintes reprises que l’Ukraine est la seule partie sérieuse au sujet de la paix. Nous pouvons tous voir que Poutine continue de choisir la violence et la destruction. »
Cependant, cette déclaration a été immédiatement contredite par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a rejeté catégoriquement l’idée d’un gel des lignes de front. « Moscou se concentre uniquement sur la réalisation d’une paix durable à long terme », a-t-il déclaré, suggérant qu’un simple cessez-le-feu ne serait qu’une trêve temporaire permettant à l’Ukraine de se réarmer. Lavrov a également insisté sur le fait que les exigences russes n’avaient pas changé : reconnaissance des territoires annexés, neutralité de l’Ukraine, et démilitarisation partielle du pays. Cette intransigeance russe a semé le doute parmi les diplomates européens quant aux chances réelles de succès du sommet de Budapest. « Je suppose que les Russes en voulaient trop et il est devenu évident pour les Américains qu’il n’y aurait pas d’accord pour Trump à Budapest », a confié un diplomate européen anonyme à Reuters. Cette déclaration témoigne d’une inquiétude croissante : Trump pourrait renoncer au sommet si Poutine ne fait pas de concessions significatives, ou pire, il pourrait accepter un accord désastreux pour l’Ukraine juste pour sauver la face.
Le report mystérieux de la rencontre Rubio-Lavrov

Les doutes sur la tenue effective du sommet de Budapest se sont encore renforcés lorsqu’il a été révélé que la réunion préparatoire entre le secrétaire d’État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov, initialement prévue pour le jeudi 23 octobre à Budapest, avait été reportée sans explication officielle. Cette rencontre était censée poser les bases du sommet Trump-Poutine, définir les contours d’un éventuel accord, et vérifier si les positions des deux pays étaient suffisamment proches pour justifier une rencontre au plus haut niveau. Le report de cette réunion a immédiatement alimenté les spéculations : les Russes avaient-ils maintenu des demandes maximalistes inacceptables pour Washington ? Rubio avait-il conclu qu’il n’y avait aucune chance d’obtenir un accord et qu’il était donc inutile d’organiser le sommet ?
Selon CNN, une source anonyme a indiqué que le report était dû aux « visions très différentes » de Rubio et Lavrov sur la manière de mettre fin à la guerre. Lors d’un appel téléphonique le lundi 20 octobre, les deux hommes auraient constaté que les Russes n’avaient pas significativement assoupli leurs exigences malgré les pressions américaines. Rubio serait donc peu enclin à recommander à Trump d’aller de l’avant avec le sommet de Budapest si Moscou ne montre pas davantage de flexibilité. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a déclaré mardi qu’il était « prématuré » de parler d’une date pour la rencontre Rubio-Lavrov, ajoutant que « nous ne pouvons pas reporter ce qui n’a pas été convenu ». Cette formulation alambiquée suggère que le sommet de Budapest lui-même pourrait être en danger. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, était à Washington mardi et a publié sur Facebook un message énigmatique : « Nous avons des jours sérieux devant nous », sans donner plus de détails. Tout indique que les tractations en coulisses sont intenses, et que rien n’est encore joué.
Le piège de la reconnaissance territoriale

Au cœur de toutes ces négociations se trouve une question fondamentale et terrifiante : Trump est-il prêt à reconnaître, même implicitement, les annexions russes ? Depuis le début de l’invasion en février 2022, la Russie a officiellement annexé cinq régions ukrainiennes : la Crimée (déjà occupée depuis 2014), ainsi que Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Ces annexions n’ont été reconnues par aucun pays occidental et ont été condamnées par l’ONU comme des violations flagrantes du droit international. Pourtant, en proposant un gel des lignes de front comme « point de départ des négociations », Trump semble accepter que ces territoires restent sous contrôle russe, au moins temporairement. Cette position représente un abandon complet du principe selon lequel les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force — un principe qui constitue le fondement même de l’ordre international d’après-guerre.
Pour Zelenskyy, accepter un tel scénario serait un suicide politique et moral. Le président ukrainien a répété à maintes reprises que l’Ukraine ne cèderait jamais le Donbass ou toute autre partie de son territoire. « J’ai clarifié lors de mon voyage à Washington la semaine dernière que la position de l’Ukraine reste inchangée », a-t-il déclaré lundi. Il a également averti que permettre à la Russie de conserver le Donbass ne ferait que créer une nouvelle base de lancement pour de futures attaques contre le reste de l’Ukraine. Cette crainte est loin d’être infondée : après l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie a utilisé la péninsule comme tremplin pour son invasion à grande échelle en 2022. De plus, céder maintenant enverrait un signal désastreux au reste du monde : l’agression militaire paie, et les États puissants peuvent impunément démembrer leurs voisins plus faibles tant qu’ils sont prêts à endurer quelques années de sanctions. Ce précédent pourrait encourager d’autres acteurs — la Chine avec Taïwan, par exemple — à tenter des aventures similaires.
La fracture transatlantique s'élargit

Cette crise diplomatique révèle une fracture croissante entre les États-Unis et l’Europe sur la question ukrainienne. Pendant trois ans, l’OTAN et l’Union européenne ont maintenu une façade d’unité remarquable, coordonnant leurs sanctions contre la Russie et leur soutien militaire à l’Ukraine. Mais cette façade commence sérieusement à se fissurer. Trump, qui n’a jamais caché son scepticisme envers l’OTAN et sa sympathie pour Poutine, semble de plus en plus déterminé à conclure un accord rapide, même au prix de sacrifier les intérêts européens et ukrainiens. De leur côté, les Européens réalisent avec horreur qu’ils ont très peu de leviers pour influencer le processus. Ils ne peuvent pas empêcher Trump de rencontrer Poutine. Ils ne peuvent pas forcer l’Ukraine à refuser un accord. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est publier des déclarations communes exprimant leur « inquiétude » et leur « soutien à la souveraineté ukrainienne » — des formules creuses qui ne changent rien à la réalité du rapport de forces.
Le président français Emmanuel Macron a tenté de rallier les Européens en déclarant le 20 octobre que « l’Europe doit aussi être à la table ». Mais cette demande a été immédiatement rejetée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré : « Personne ne parle de ça pour l’instant. Personne n’a discuté de ces détails. » Ce refus sec témoigne du mépris de Moscou pour l’Europe, perçue comme un acteur secondaire incapable de défendre ses propres intérêts. Les Européens se retrouvent ainsi dans une position humiliante : spectateurs impuissants d’un processus qui déterminera pourtant l’avenir de leur propre sécurité. Car si l’Ukraine tombe, si Poutine réussit à conserver ses conquêtes territoriales, quel pays sera le prochain sur la liste ? Les États baltes ? La Pologne ? La Moldavie ? Ces questions ne sont plus du domaine de la pure spéculation — elles deviennent des scénarios crédibles que les planificateurs militaires européens doivent désormais envisager sérieusement.
Le symbolisme tragique de Budapest
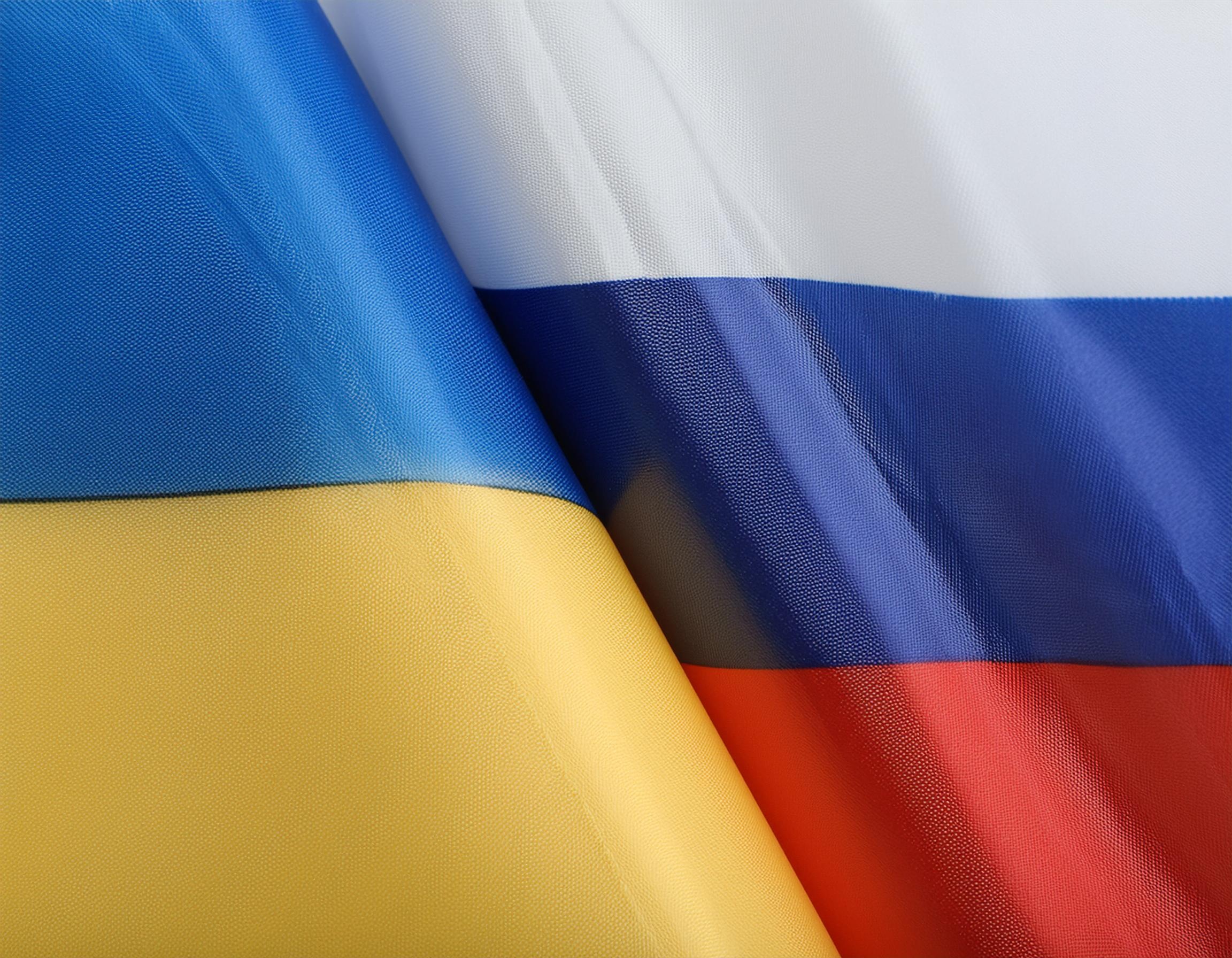
Il existe une ironie historique cruelle dans le choix de Budapest comme lieu de ce sommet. C’est précisément dans cette ville qu’en 1994, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie avaient signé le Mémorandum de Budapest, par lequel ils garantissaient la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine en échange de l’abandon par Kiev de son arsenal nucléaire — le troisième plus important au monde à l’époque. Les signataires s’étaient engagés à respecter les frontières ukrainiennes et à ne jamais recourir à la force contre ce pays. En 2022, la Russie a violé spectaculairement cet engagement en envahissant l’Ukraine. Et maintenant, en 2025, Trump et Poutine s’apprêtent à se retrouver dans cette même ville pour négocier le démembrement du pays que ce mémorandum était censé protéger. Le symbolisme est accablant : Budapest devient le lieu de la trahison, le théâtre où les grandes puissances confirment que leurs promesses ne valent rien, que les garanties de sécurité ne sont que du papier sans valeur.
Pour l’Ukraine, cette trahison a des conséquences concrètes et terribles. En 1994, le pays possédait environ 1 900 ogives nucléaires héritées de l’Union soviétique. Si Kiev avait conservé ne serait-ce qu’une partie de cet arsenal, la Russie n’aurait jamais osé l’envahir. Les dirigeants ukrainiens de l’époque avaient accepté de renoncer à ces armes parce qu’ils croyaient aux garanties occidentales. Ils pensaient que les États-Unis et l’Europe les protègeraient. Cette confiance a été trahie une première fois en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée sans réaction militaire occidentale. Elle est trahie une seconde fois aujourd’hui, alors que Trump s’apprête à légitimer les conquêtes russes pour obtenir un accord rapide. La leçon que les autres pays en tireront est limpide : ne faites jamais confiance aux garanties de sécurité occidentales. Conservez vos armes nucléaires. C’est le seul moyen de vous protéger. Cette conclusion représente un échec civilisationnel majeur pour le système de non-prolifération nucléaire patiemment construit depuis des décennies.
Les enjeux électoraux américains
Il est impossible de comprendre l’empressement de Trump à conclure un accord avec Poutine sans prendre en compte le calendrier électoral américain. Bien que Trump soit au pouvoir jusqu’en janvier 2029, les élections de mi-mandat de novembre 2026 approchent, et le président sait que sa capacité à « mettre fin à la guerre en Ukraine » — une de ses promesses de campagne les plus répétées — sera jugée par les électeurs. Trump a besoin d’une victoire diplomatique rapide et spectaculaire, quelque chose qu’il pourra brandir comme preuve de son génie négociateur. Peu importe que cet accord soit juste ou durable — ce qui compte, c’est qu’il puisse déclarer : « J’ai arrêté la guerre que Biden n’a pas su arrêter. » Cette logique purement électorale explique pourquoi Trump semble prêt à accepter des concessions massives à la Russie, pourquoi il minimise les préoccupations européennes, et pourquoi il fait pression sur Zelenskyy pour qu’il capitule.
Mais cette stratégie comporte des risques énormes. Si Trump conclut un accord perçu comme une capitulation face à Poutine, il pourrait perdre le soutien d’une partie importante de l’électorat républicain, notamment les faucons néo-conservateurs qui considèrent la Russie comme une menace existentielle. Le sénateur Lindsey Graham, pourtant un proche de Trump, a déjà exprimé des réserves sur l’approche présidentielle, appelant à des auditions parlementaires pour examiner les termes de tout accord potentiel. De plus, les entreprises américaines qui font des affaires en Europe ou qui dépendent de la stabilité du continent pourraient s’inquiéter des conséquences à long terme d’un abandon de l’Ukraine. Si la Russie est récompensée pour son agression, pourquoi ne tenterait-elle pas de nouvelles aventures militaires dans les Balkans, en Moldavie ou ailleurs ? Cette instabilité chronique nuirait aux intérêts économiques américains et pourrait finalement coûter bien plus cher que le maintien du soutien à Kiev. Mais Trump, obsédé par les gains politiques immédiats, semble incapable de penser au-delà du cycle électoral suivant.
L'Ukraine face à l'ultimatum impossible

Pour l’Ukraine, la situation est devenue intenable. D’un côté, Zelenskyy ne peut pas accepter de céder le Donbass ou toute autre partie du territoire national sans trahir les centaines de milliers de soldats et de civils ukrainiens qui ont donné leur vie pour défendre le pays. De l’autre côté, il ne peut pas non plus refuser catégoriquement toute négociation sans risquer de perdre le soutien américain — et donc les armes, l’argent et les renseignements sans lesquels l’Ukraine ne peut pas tenir face à la Russie. Zelenskyy se retrouve pris dans un étau implacable, contraint de naviguer entre des exigences contradictoires : satisfaire Trump sans capituler devant Poutine, rassurer les Européens sans les laisser dicter sa stratégie, maintenir la cohésion nationale ukrainienne sans promettre une victoire militaire qui semble de plus en plus illusoire.
Cette pression est exacerbée par la situation militaire sur le terrain. Bien que l’Ukraine ait réussi à repousser plusieurs offensives russes et à tenir ses lignes de défense, elle ne dispose pas des moyens pour lancer une contre-offensive majeure qui permettrait de reconquérir les territoires perdus. Les stocks de munitions s’épuisent, les soldats sont épuisés après plus de trois ans de guerre ininterrompue, et le recrutement devient de plus en plus difficile. Pendant ce temps, la Russie continue de bombarder systématiquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, plongeant le pays dans des coupures d’électricité massives à l’approche de l’hiver. « Poutine cherche à provoquer un désastre énergétique cet hiver en nous attaquant », a déclaré Zelenskyy, accusant le Kremlin d’utiliser le froid comme une arme de guerre. Dans ce contexte, l’idée d’un cessez-le-feu devient de plus en plus séduisante pour les Ukrainiens ordinaires, qui aspirent simplement à vivre en paix, même si cela signifie des sacrifices territoriaux temporaires.
Conclusion

Le sommet annoncé de Budapest représente bien plus qu’une simple rencontre diplomatique entre deux leaders mondiaux. C’est un moment de vérité pour l’ordre international d’après-guerre, un test décisif pour savoir si les principes du droit international et de la souveraineté territoriale ont encore un sens à l’ère Trump-Poutine. En choisissant Budapest — capitale d’un pays dirigé par le Premier ministre le plus pro-russe d’Europe — et en excluant de fait les Européens et l’Ukraine des discussions préliminaires, Trump et Poutine envoient un message brutal : le sort de l’Europe se décide sans les Européens, et l’avenir de l’Ukraine se négocie sans les Ukrainiens. Cette approche rappelle les pires moments de la diplomatie des grandes puissances au XIXe et au début du XXe siècle, lorsque les empires se partageaient le monde dans des conférences auxquelles les peuples concernés n’étaient jamais invités. On croyait que l’humanité avait tiré les leçons de ces erreurs historiques, qu’elle avait compris que la paix durable ne peut pas être imposée de l’extérieur mais doit être construite avec la participation de tous les acteurs concernés. Budapest prouve que cette leçon n’a manifestement pas été retenue.
Pour l’Ukraine, les jours et les semaines à venir seront cruciaux. Zelenskyy se trouve face au dilemme le plus difficile de sa présidence : accepter de participer à un processus de négociation dont les conditions lui sont défavorables, ou refuser et risquer de perdre le soutien américain dont dépend la survie même de son pays. Quelle que soit sa décision, elle sera déchirante, car il n’existe aucune option qui ne comporte pas de sacrifices majeurs. S’il accepte de céder le Donbass ou d’autres territoires, il trahira les centaines de milliers d’Ukrainiens qui ont combattu et sont morts pour défendre ces terres. S’il refuse catégoriquement toute concession territoriale, il risque de se retrouver isolé diplomatiquement, abandonné par Washington et contraint de poursuivre une guerre qu’il ne peut plus gagner militairement. Cette impasse tragique n’est pas le résultat du hasard ou de l’incompétence ukrainienne — elle est le produit direct de la décision de Trump de privilégier un accord rapide avec Poutine plutôt que la défense des principes fondamentaux qui ont maintenu la paix en Europe pendant près de huit décennies.
L’Europe, de son côté, doit urgemment tirer les leçons de son humiliation actuelle. Pendant trop longtemps, les Européens ont cru pouvoir se reposer sur la garantie de sécurité américaine sans investir suffisamment dans leur propre défense. Pendant trop longtemps, ils ont pensé que les États-Unis partageraient automatiquement leurs intérêts et leurs valeurs. Budapest démontre de manière éclatante que cette époque est révolue. Si les Européens veulent avoir leur mot à dire sur leur propre avenir, ils doivent développer une autonomie stratégique réelle : une armée européenne crédible, une industrie de défense indépendante, une diplomatie unifiée capable de peser face aux grandes puissances. Sinon, ils resteront éternellement des spectateurs impuissants, condamnés à regarder leur sort se décider entre Washington et Moscou, entre Pékin et New Delhi, sans jamais pouvoir influencer le cours des événements. Le sommet de Budapest pourrait bien être le déclic qui force enfin les Européens à prendre leur destin en main — ou le symbole définitif de leur déclin irréversible sur la scène mondiale.
Quant à l’ordre international lui-même, il sort profondément ébranlé de cette crise. Le Mémorandum de Budapest de 1994, qui garantissait la sécurité de l’Ukraine, est désormais lettre morte. Les garanties de sécurité occidentales ont été trahies. Le principe selon lequel les frontières ne peuvent être modifiées par la force est en train d’être abandonné. La Cour pénale internationale, censée poursuivre les criminels de guerre, est ouvertement bafouée. Tous ces piliers de l’ordre international sont en train de s’effondrer simultanément, créant un vide juridique et moral qui sera rempli par la loi du plus fort. Les conséquences de cet effondrement se feront sentir bien au-delà de l’Ukraine : elles affecteront Taiwan, les îles contestées en mer de Chine méridionale, les Balkans, le Caucase, et tous les autres points chauds où des puissances régionales pourraient être tentées de réviser les frontières par la force. Budapest 2025 pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère de chaos international, où la diplomatie cède la place à la confrontation militaire, où le droit international est remplacé par des accords bilatéraux négociés sous la menace, et où les petits pays apprennent qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre. C’est ce monde sombre qui se profile derrière le sourire d’Orbán et les poignées de main de Trump et Poutine.