Des décrets présidentiels controversés
Tout a commencé le 1er février 2025, lorsque Donald Trump a publié une série de décrets présidentiels imposant des droits de douane draconiens sur pratiquement toutes les importations américaines. Invoquant l’International Emergency Economic Powers Act de 1977, une loi conçue pour gérer les urgences nationales liées à la sécurité, Trump a déclaré que les déficits commerciaux américains constituaient une menace extraordinaire justifiant ces mesures. Les premiers tarifs visaient le Canada, le Mexique et la Chine — accusés de ne pas freiner le trafic de fentanyl vers les États-Unis. Puis vint le « Liberation Day » du 2 avril, où Trump imposa des tarifs allant de 10 % à 50 % sur les produits de quasiment tous les pays du monde. Une offensive protectionniste sans précédent qui a plongé l’économie mondiale dans l’incertitude.
Ces tarifs dits « de trafic » et « réciproques » ont immédiatement déclenché une onde de choc économique. Les entreprises canadiennes ont vu leurs exportations chuter, entraînant une baisse du PIB du pays. Au Québec, des designers et des PME qui dépendaient du marché américain ont dû revoir leurs stratégies ou fermer boutique. L’exemption initiale de 1 dollar américain pour les petits colis a pris fin le 1er septembre 2025, faisant grimper les frais à 50 dollars par article importé — un coup fatal pour les micro-entrepreneurs. Trump justifie cette politique en affirmant qu’elle ramènera la production industrielle aux États-Unis, mais dans l’immédiat, elle crée surtout du chaos économique et une hausse des prix pour les consommateurs, selon la majorité des économistes.
Une réponse judiciaire immédiate et coordonnée
Face à cette avalanche tarifaire, la résistance s’est organisée rapidement. Dès avril 2025, douze États américains — menés par l’Oregon et incluant la Californie — ont intenté des poursuites devant le Tribunal du commerce international des États-Unis. Leur argument était simple mais dévastateur : Trump n’a pas le pouvoir constitutionnel d’imposer des droits de douane, une prérogative qui appartient exclusivement au Congrès selon l’article I de la Constitution américaine. « Le plan de droits de douane insensé du président Trump est non seulement imprudent sur le plan économique, mais il est également illégal », a martelé la procureure générale de l’Arizona, Kris Mayes. Les États ont soutenu que l’IEEPA ne permettait pas d’utiliser des mesures d’urgence pour imposer des tarifs, et que Trump avait « bouleversé l’ordre constitutionnel et plongé l’économie américaine dans le chaos ».
Parallèlement, les petites entreprises ont lancé leurs propres batailles juridiques. À Washington D.C., Learning Resources et hand2mind ont attaqué les tarifs devant le juge de district Rudolph Contreras, qui leur a donné raison en mai 2025. Dans une décision retentissante, le magistrat a conclu que Trump avait excédé ses pouvoirs sous l’IEEPA. Un autre groupe de cinq petites entreprises, incluant le distributeur de vins et spiritueux V.O.S. Selections, a déposé une action similaire devant le Tribunal du commerce international. Ces compagnies ont insisté sur un point crucial : si le mot « réguler » dans l’IEEPA signifiait « taxer », cela bouleverserait l’interprétation de centaines d’autres lois fédérales où ce terme apparaît. Les enjeux juridiques dépassaient donc largement les tarifs eux-mêmes.
L’escalade vers la Cour suprême
En août 2025, la Cour d’appel du circuit fédéral, qui entend les appels du Tribunal du commerce international, a porté un coup majeur à l’administration Trump. Par un vote de 7 contre 4, elle a confirmé que l’IEEPA ne donnait pas au président le pouvoir d’imposer les tarifs de trafic ou réciproques. Le raisonnement de la majorité s’appuyait sur la doctrine des « questions majeures » — un principe selon lequel le Congrès doit clairement autoriser l’exécutif pour prendre des décisions ayant une « signification économique et politique vaste ». « L’utilisation des tarifs par Trump se qualifie comme une décision de signification économique et politique vaste », a écrit la cour, exigeant une autorisation congressionnelle claire que le gouvernement ne pouvait fournir. Ce jugement a été suspendu jusqu’au 14 octobre pour permettre un appel à la Cour suprême.
Trump a réagi avec une véhémence caractéristique sur son réseau Truth Social : « TOUS LES DROITS DE DOUANE SONT ENCORE EN VIGUEUR ! » a-t-il martelé en majuscules. Il a immédiatement annoncé son intention de saisir la Cour suprême, comptant sur la majorité conservatrice qu’il a lui-même consolidée durant son premier mandat pour renverser ces décisions embarrassantes. Le 9 septembre 2025, les juges ont accepté d’entendre l’affaire sur un calendrier inhabituellement accéléré, fixant les arguments oraux au 5 novembre — un signe que la cour cherche à résoudre rapidement cette crise constitutionnelle. Mais cette décision comportait un risque énorme pour Trump : si la Cour suprême confirmait l’illégalité des tarifs, l’administration pourrait devoir rembourser plus de 210 milliards de dollars américains déjà perçus depuis le printemps 2025.
Les arguments juridiques des petites entreprises
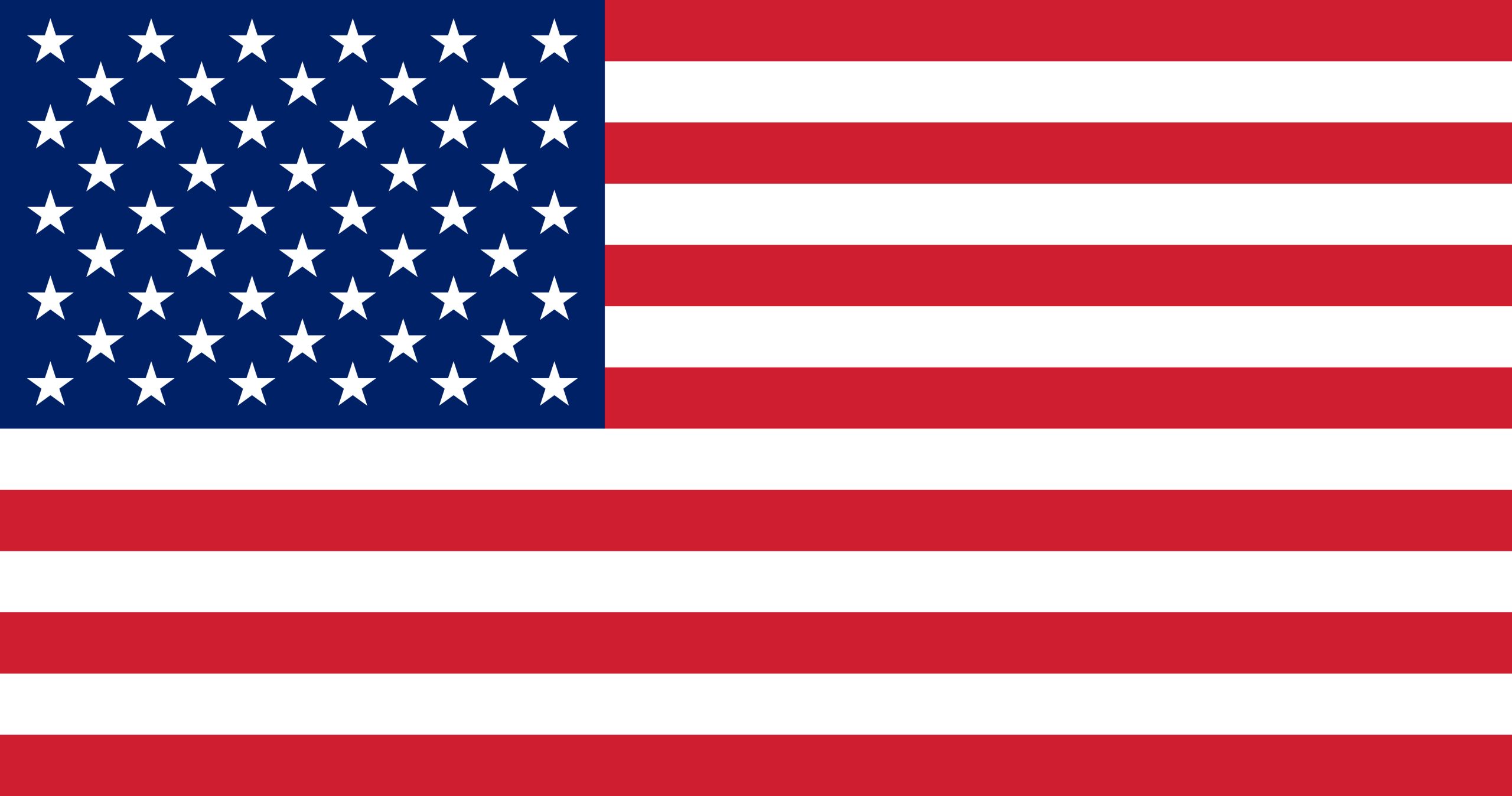
L’usurpation du pouvoir de taxation du Congrès
Dans leur mémoire déposé le 20 octobre 2025, les avocats de Learning Resources ont formulé leur accusation la plus grave : Trump a usurpé le pouvoir constitutionnel du Congrès de lever des impôts. « Le président ne peut pas imposer de tarifs au peuple américain quand il veut, au taux qu’il veut, pour les pays et produits qu’il veut, aussi longtemps qu’il veut — simplement en déclarant que des déficits commerciaux de longue date constituent une urgence nationale », ont-ils écrit. Cette formulation met le doigt sur un point crucial : si l’interprétation de Trump était validée, cela donnerait au président un pouvoir de taxation pratiquement illimité, contournant complètement le rôle du Congrès. Les entreprises ont souligné que depuis février, Trump a « augmenté et abaissé, mis en pause et repris, menacé et démenacé les tarifs à volonté, pour un sac fourre-tout de raisons » — démontrant l’arbitraire de sa politique.
Le texte même de l’IEEPA devient le cœur de l’argumentaire. Contrairement à toutes les lois tarifaires réelles, l’IEEPA ne mentionne nulle part les « tarifs », les « droits » ou tout autre mécanisme de génération de revenus. La loi accorde au président le pouvoir de « réguler » l' »importation » de biens pour faire face à une urgence nationale — mais les plaignants insistent que « réguler l’importation » n’a jamais été compris comme incluant le pouvoir d’imposer des taxes. « Le gouvernement ne peut trouver aucun autre exemple où le Congrès a délégué un pouvoir de taxation par le mot ‘réguler’, encore moins par la phrase ‘réguler… l’importation ou l’exportation' », ont martelé Learning Resources et hand2mind. Si « réguler » signifiait « taxer », ont ajouté les avocats de V.O.S. Selections, cela renverserait la compréhension acceptée de centaines d’autres statuts fédéraux.
La doctrine des questions majeures
Les plaignants ont également invoqué la doctrine des questions majeures, un principe jurisprudentiel de plus en plus influent dans la Cour suprême conservatrice actuelle. Cette doctrine stipule que lorsque le Congrès veut donner au pouvoir exécutif l’autorité de prendre des décisions ayant une « signification économique et politique vaste », il doit le dire clairement. Les avocats ont argumenté que « le Congrès n’utilise pas (et ne pourrait pas utiliser) une terminologie aussi vague pour accorder à l’exécutif un pouvoir de taxation virtuellement illimité d’un effet économique aussi stupéfiant — littéralement des milliers de milliards de dollars — supporté par les entreprises et consommateurs américains ». C’est exactement ce raisonnement que la Cour d’appel fédérale a adopté en août 2025 dans sa décision majoritaire 7-4 contre Trump.
L’administration Trump a tenté de contrer cet argument en invoquant les implications de sécurité nationale et de politique étrangère des tarifs, suggérant que la doctrine des questions majeures ne devrait pas s’appliquer dans ce contexte. Mais les plaignants ont rejeté cette défense avec force. « C’est le Congrès, pas le président, qui a le pouvoir de taxer », ont-ils répondu sans détour. Ils ont souligné que même dans des domaines touchant à la sécurité nationale, le président ne peut pas s’arroger des pouvoirs que la Constitution réserve explicitement au législatif. Les États challengeurs ont également fait valoir que même si la phrase « réguler… l’importation » incluait le pouvoir d’imposer des tarifs, le schéma d’ensemble des lois commerciales mènerait toujours à la conclusion que l’IEEPA ne donnait pas ce pouvoir à Trump.
La violation de la doctrine de non-délégation
Le quatrième argument majeur des plaignants touche à la doctrine de non-délégation — le principe selon lequel le Congrès ne peut pas déléguer ses pouvoirs législatifs à d’autres institutions sans fournir des « principes intelligibles » pour guider leur exercice. Les États ont reconnu que « le Congrès a délégué l’autorité au président d’ajuster les taux tarifaires en réponse à des circonstances discrètes et spécifiquement énumérées. Mais il l’a toujours fait explicitement et soumis à des principes intelligibles qui encadrent l’autorité du président ». Dans le cas présent, par contraste, l’administration Trump a interprété l’IEEPA « comme déléguant l’entièreté du pouvoir tarifaire du Congrès à la discrétion ‘essentiellement non révisable judiciairement’ du président, sans aucun principe intelligible guidant le montant ou la durée des tarifs ».
Cette argumention résonne avec des préoccupations plus larges sur la séparation des pouvoirs dans le système constitutionnel américain. Si le président peut imposer 3 000 milliards de dollars de taxes sur une décennie simplement en déclarant une urgence nationale basée sur des déficits commerciaux de longue date, qu’est-ce qui l’empêche d’utiliser le même pouvoir dans d’autres domaines ? Les plaignants ont souligné que Trump change « d’avis demain et encore le jour d’après » — illustrant l’absence totale de limites prévisibles ou de principes directeurs dans son utilisation de l’IEEPA. Cette instabilité même démontre, selon eux, que le Congrès n’a jamais voulu accorder un tel pouvoir discrétionnaire au président. Le risque constitutionnel va donc bien au-delà des tarifs : c’est toute l’architecture des pouvoirs qui est en jeu.
L'impact dévastateur sur les petites entreprises

Des coûts multipliés par 45 en une année
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et ils racontent une histoire d’asphyxie économique. Learning Resources et hand2mind, deux entreprises spécialisées dans les jouets éducatifs, font face à des coûts de 100 millions de dollars en 2025 — soit 45 fois plus que les 2,2 millions qu’elles payaient en 2024. Cette explosion n’est pas une augmentation graduelle qu’on peut absorber en ajustant les marges ou en renégociant avec les fournisseurs. C’est un tsunami financier qui menace de balayer des décennies de travail acharné et d’investissements. Pour ces petites entreprises, contrairement aux multinationales qui peuvent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement ou absorber temporairement les pertes, chaque dollar compte. Quand vos coûts d’importation multiplient par 45, vous n’avez que deux options : répercuter sur les consommateurs ou fermer boutique.
Le distributeur de vins et spiritueux V.O.S. Selections raconte une histoire similaire, tout comme les quatre autres petites entreprises qui se sont jointes à leur action en justice. Ces compagnies ont bâti leurs modèles d’affaires sur des décennies de commerce international stable, avec des marges calculées au plus près et des relations de confiance avec leurs fournisseurs étrangers. Les tarifs de Trump ont détruit cet équilibre en quelques mois. Plus grave encore, l’instabilité constante — les tarifs qui montent et descendent, qui sont annoncés puis suspendus puis réimposés — rend toute planification impossible. Comment négocier un contrat avec un fournisseur chinois ou canadien quand vous ne savez pas si le tarif sera de 10 %, 25 % ou 50 % le mois prochain ? Cette incertitude paralysante tue les affaires aussi sûrement que les tarifs eux-mêmes.
Un effet domino sur l’économie canadienne
Au nord de la frontière, l’impact des tarifs trumpiens se fait sentir avec une intensité particulière. Le PIB canadien a chuté en raison de l’effondrement des exportations vers les États-Unis, principal partenaire commercial du pays. Au Québec, des designers et artisans qui comptaient sur le marché américain pour écouler leurs créations se retrouvent coincés. La fin de l’exemption pour les petits colis de moins d’un dollar américain, effective depuis le 1er septembre 2025, a été le coup de grâce pour beaucoup de micro-entrepreneurs. Désormais, chaque article importé coûte 50 dollars de frais de douane — rendant impossibles les commandes de petits volumes qui permettaient aux PME de tester les marchés et de croître graduellement. « Ça va être un peu chaotique », avait prédit avec euphémisme un observateur économique au printemps — la réalité s’est avérée bien pire.
Les entreprises canadiennes qui dépendaient de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) se sont retrouvées dans un vide juridique. Bien que Trump ait modifié son décret le 6 mars 2025 pour exempter certaines marchandises conformes à l’ACEUM et réduire les tarifs sur la potasse à 10 %, l’application de ces exemptions reste floue et changeante. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a multiplié les mises en garde sur l’impact catastrophique de cette guerre commerciale. Les frais de douane qui augmentent progressivement — de 50 dollars par article après juin 2025 — transforment des importations autrefois rentables en gouffres financiers. Pour les petites entreprises québécoises et canadiennes qui n’ont ni les ressources pour relocaliser leur production ni la taille pour négocier des exceptions, la situation devient existentielle.
L’augmentation fiscale de 3 000 milliards sur une décennie
Mais le chiffre qui domine tous les autres, celui qui hante les mémoires juridiques et les cauchemars des entrepreneurs, c’est celui-là : 3 000 milliards de dollars américains. C’est le montant que les tarifs de Trump vont coûter aux entreprises et consommateurs américains sur la prochaine décennie, selon les propres calculs du gouvernement. Pour mettre ce nombre en perspective : c’est plus que le PIB annuel du Canada ou de l’Espagne. C’est « la plus grande augmentation fiscale en temps de paix de l’histoire américaine », comme l’ont qualifié les plaignants dans leurs mémoires. Et contrairement à une vraie réforme fiscale votée par le Congrès, où les représentants élus débattent des taux, des exemptions et de l’utilisation des revenus, ces 3 000 milliards ont été imposés par décrets présidentiels, sans vote, sans débat public substantiel.
Cette somme astronomique ne tombe pas du ciel — elle sort directement des poches des entreprises américaines qui importent des biens, et ultimement des consommateurs qui verront les prix grimper. Les économistes sont quasi-unanimes : les tarifs sont une taxe qui est répercutée sur les consommateurs, point final. La ministre de la Justice de l’Arizona avait été on ne peut plus claire : « Peu importe ce que prétend la Maison-Blanche, les droits de douane sont une taxe qui sera répercutée sur les consommateurs ». Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est allé encore plus loin en qualifiant les tarifs de Trump du « pire but contre son camp de l’histoire de ce pays » — une référence sportive qui capture bien l’absurdité de s’infliger à soi-même un tel fardeau économique.
La stratégie de défense de l'administration Trump

L’invocation de l’urgence nationale
Face à ce déluge de critiques juridiques et économiques, l’administration Trump a élaboré une défense audacieuse : les tarifs sont légaux parce que l’IEEPA permet au président de « réguler » l' »importation » de biens pour faire face à une urgence nationale, et que les tarifs sont précisément un moyen traditionnel et commun de réguler les importations. Le solliciteur général des États-Unis, D. John Sauer, a présenté cet argument dans le mémoire gouvernemental déposé le 19 septembre 2025. Selon lui, même si l’IEEPA ne mentionne pas explicitement les « tarifs », le pouvoir de réguler l’importation inclut nécessairement le pouvoir d’imposer des droits de douane — c’est implicite dans la nature même du mot « réguler ». Cette interprétation élargit considérablement la portée de la loi de 1977, mais l’administration insiste qu’elle est fidèle à l’intention originale du Congrès.
Le cœur de la défense repose sur la déclaration d’urgence nationale elle-même. Trump a invoqué deux types d’urgences pour justifier ses différents tarifs. Pour les tarifs « de trafic » sur le Canada, le Mexique et la Chine, il a déclaré que la situation à la frontière — avec le flux de migrants et de fentanyl — constituait une menace extraordinaire pour la sécurité nationale. Pour les tarifs « réciproques » du « Liberation Day », il a déclaré que les déficits commerciaux de longue date des États-Unis représentaient une urgence économique. L’administration soutient que ces déclarations relèvent du pouvoir discrétionnaire du président en matière de sécurité nationale et de politique étrangère — des domaines où les tribunaux ont historiquement fait preuve de grande déférence à l’égard de l’exécutif.
La minimisation de l’impact du litige
De manière révélatrice, les responsables de l’administration Trump ont tenté de minimiser l’importance de cette bataille juridique en affirmant que la plupart des tarifs pourraient être imposés par d’autres voies légales même si la Cour suprême leur donnait tort sur l’IEEPA. Ils ont souligné que les tarifs sur l’acier, l’aluminium et les automobiles — qui représentent une partie substantielle des mesures protectionnistes — ont été imposés sous une loi différente, la Section 232, et ne sont donc pas directement affectés par cet appel. Cette stratégie de repli suggère que l’administration elle-même reconnaît la fragilité juridique de sa position principale. Si Trump était vraiment confiant dans la légalité de ses actions sous l’IEEPA, pourquoi souligner qu’il a d’autres options ?
Mais cette minimisation ne tient pas vraiment la route quand on examine les enjeux financiers. Plus de 210 milliards de dollars américains ont déjà été perçus en droits de douane depuis le printemps 2025. Si la Cour suprême confirme l’illégalité, ces sommes devront potentiellement être remboursées — un scénario que Trump lui-même a qualifié de « dévastateur pour notre pays » lors d’une intervention en septembre. « C’est une décision très importante, et franchement, s’ils prennent la mauvaise décision, ce serait dévastateur », a-t-il déclaré avec une franchise inhabituelle. La manière dont se ferait un tel remboursement reste d’ailleurs floue : l’administration pourrait rembourser toutes les entreprises en bloc, ou les forcer à intenter leurs propres recours individuels — une perspective cauchemardesque pour les petites compagnies qui n’ont ni le temps ni les ressources pour des litiges prolongés.
Le pari sur la majorité conservatrice
La vraie carte que Trump joue, celle qu’il a brandie ouvertement depuis le début, c’est la composition de la Cour suprême elle-même. Durant son premier mandat présidentiel (2017-2021), Trump a nommé trois juges conservateurs à la haute cour : Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett. Ces nominations ont cimenté une solide majorité conservatrice 6-3 qui a déjà démontré sa volonté de revisiter certaines doctrines juridiques établies. Trump compte explicitement sur cette majorité pour renverser les décisions défavorables des tribunaux inférieurs. « Désormais, avec l’aide de la Cour suprême des États-Unis, nous les utiliserons au service de notre pays », a-t-il écrit sur Truth Social immédiatement après la décision défavorable de la Cour d’appel en août. Cette confiance n’est pas entièrement injustifiée — la Cour conservatrice actuelle a montré un certain scepticisme envers le « État administratif » et une volonté d’interpréter généreusement les pouvoirs présidentiels.
Pourtant, le pari n’est pas sans risque. La doctrine des questions majeures que les plaignants invoquent a justement été développée et amplifiée par cette même Cour suprême conservatrice dans des cas récents. Les juges conservateurs ont utilisé cette doctrine pour limiter le pouvoir des agences fédérales comme l’EPA (Agence de protection environnementale) de prendre des décisions économiquement massives sans autorisation claire du Congrès. Appliquer cette même logique aux tarifs présidentiels serait cohérent avec cette jurisprudence récente. De plus, même les juges conservateurs attachent généralement une grande importance au rôle du Congrès en matière de taxation — c’est un principe fondamental qui traverse les lignes idéologiques. Le fait que la Cour ait accepté d’entendre l’affaire sur un calendrier accéléré, avec des arguments oraux fixés au 5 novembre 2025, suggère qu’elle prend les questions constitutionnelles au sérieux plutôt que de les balayer d’un revers de main.
Les précédents judiciaires qui pèsent lourd

La décision de la Cour d’appel fédérale d’août 2025
Le 28 août 2025, la Cour d’appel du circuit fédéral a rendu une décision qui a secoué l’administration Trump jusqu’aux fondations. Par un vote de 7 contre 4, elle a statué qu’une grande partie des droits de douane imposés par le président étaient illégaux — un revers majeur pour un pilier central de sa politique économique. La majorité a conclu que Trump avait excédé son autorité sous l’IEEPA en imposant ces tarifs, appliquant précisément la doctrine des questions majeures que les petites entreprises invoquent maintenant devant la Cour suprême. « L’utilisation des tarifs par Trump se qualifie comme une décision de signification économique et politique vaste », a écrit la cour, exigeant que le gouvernement « pointe vers une autorisation congressionnelle claire » — ce que la majorité a jugé impossible.
Ce qui rend ce précédent particulièrement puissant, c’est la marge du vote : 7 contre 4. Ce n’était pas une décision partagée 2-1 d’un petit panel, mais un jugement d’une cour en formation complète (*en banc*) où une majorité claire de juges — incluant plusieurs nommés par des présidents républicains — ont conclu à l’illégalité des tarifs. Le juge qui a rédigé l’opinion majoritaire a souligné que permettre au président d’imposer des tarifs sous prétexte d’urgence nationale, basé uniquement sur des déficits commerciaux de longue date, viderait de son sens la limitation constitutionnelle du pouvoir de taxation. Si cette interprétation tenait, le président pourrait déclarer une « urgence » pour n’importe quel problème économique persistant et s’arroger le pouvoir de taxer — contournant complètement le Congrès.
Le jugement du tribunal de commerce international
Avant la Cour d’appel, le Tribunal du commerce international des États-Unis avait déjà donné raison aux plaignants dans deux affaires distinctes. En mai 2025, ce tribunal spécialisé — qui entend les litiges commerciaux et douaniers — a statué que Trump n’avait pas le pouvoir d’imposer les tarifs sous l’IEEPA. Cette décision avait porté sur l’action des douze États dirigés par l’Oregon, ainsi que sur celle du groupe de cinq petites entreprises mené par V.O.S. Selections. Le raisonnement du tribunal était direct : l’IEEPA accorde au président des outils financiers pour gérer des urgences de sécurité nationale et de politique étrangère, mais n’inclut pas le pouvoir de lever des revenus par la taxation — un pouvoir que la Constitution réserve au Congrès.
De manière parallèle, le juge de district Rudolph Contreras à Washington D.C. était parvenu à la même conclusion dans l’affaire Learning Resources et hand2mind. Sa décision, bien que provenant d’un tribunal de district plutôt que du Tribunal du commerce international, a renforcé le consensus juridique émergent : les tarifs de Trump dépassaient son autorité légale. Fait notable, aucun des tribunaux qui ont examiné cette question — qu’ils soient de première instance ou d’appel, généraux ou spécialisés — n’a donné raison à l’administration sur le fond. Le seul « succès » de Trump a été d’obtenir des suspensions d’exécution de ces jugements en attendant l’appel, permettant aux tarifs de rester en place temporairement. Mais cette accumulation de décisions défavorables crée un momentum juridique difficile à ignorer.
La doctrine des questions majeures en évolution
La doctrine des questions majeures elle-même est relativement récente dans sa formulation actuelle, bien qu’elle s’appuie sur des principes plus anciens. La Cour suprême l’a articulée de manière de plus en plus claire dans une série de décisions récentes, notamment dans *West Virginia v. EPA* (2022), où elle a limité le pouvoir de l’Agence de protection environnementale de réglementer les émissions de carbone sans autorisation congressionnelle explicite. Le principe sous-jacent est simple : quand une agence ou le président revendique un pouvoir ayant d’énormes conséquences économiques ou politiques basé sur une interprétation créative d’une vieille loi, les tribunaux doivent exiger une autorisation claire et spécifique du Congrès.
Appliquée aux tarifs de Trump, cette doctrine devient dévastatrice. Les plaignants ont souligné que l’IEEPA date de 1977 — une époque où personne n’imaginait qu’elle serait utilisée pour imposer des milliers de milliards de dollars de tarifs. Le Congrès de l’époque concevait la loi comme donnant au président des outils pour geler des avoirs étrangers, bloquer des transactions financières avec des régimes hostiles, ou imposer des sanctions ciblées — pas pour restructurer l’ensemble du système commercial américain. Si le Congrès avait voulu donner au président un tel pouvoir, il l’aurait dit explicitement, en fixant des limites, des durées, des taux maximums — exactement comme il l’a fait dans d’autres lois tarifaires spécifiques. L’absence de toute mention de « tarifs » ou « droits de douane » dans l’IEEPA n’est pas un oubli — c’est une indication claire que le Congrès n’avait pas l’intention de déléguer ce pouvoir.
Les implications pour le commerce international

Le choc sur les chaînes d’approvisionnement mondiales
Au-delà des salles d’audiences américaines, les tarifs de Trump ont envoyé des ondes de choc à travers les chaînes d’approvisionnement mondiales entières. Les entreprises qui avaient passé des décennies à optimiser leurs réseaux de fournisseurs — équilibrant coûts, qualité, délais de livraison et risques géopolitiques — se sont retrouvées forcées de tout repenser du jour au lendemain. Un fabricant de jouets éducatifs qui s’approvisionnait en Chine depuis vingt ans doit soudainement explorer des fournisseurs au Vietnam, en Inde ou au Mexique — sans garantie que ces nouveaux partenaires maintiendront la même qualité ou que Trump n’imposera pas de tarifs là aussi demain. Cette instabilité manufacturée détruit la valeur d’années d’investissements dans les relations commerciales et le contrôle qualité.
Les effets se font sentir particulièrement au Canada, dont l’économie est intimement liée à celle des États-Unis. Les exportations canadiennes vers leur voisin du sud ont chuté dramatiquement, entraînant une baisse mesurable du PIB canadien. Des secteurs entiers — bois d’œuvre, produits agricoles, composantes automobiles — ont vu leurs marges s’évaporer. L’incertitude entourant l’application de l’ACEUM, l’accord commercial qui était censé garantir des échanges fluides entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, a créé un climat d’anxiété permanente chez les exportateurs. Même les entreprises qui ont obtenu des exemptions temporaires ne savent pas si elles tiendront le mois prochain, rendant impossible toute planification à moyen terme.
La guerre commerciale qui ne dit pas son nom
Bien que Trump évite le terme, les observateurs internationaux ne s’y trompent pas : ce à quoi le monde assiste depuis février 2025 est une véritable guerre commerciale unilatérale lancée par les États-Unis. La Chine, principal cible des tarifs « de trafic », a déjà commencé à riposter par ses propres mesures protectionnistes. L’Union européenne évalue ses options de représailles. Même le Canada, traditionnellement réticent à confronter son puissant voisin, a imposé des contre-tarifs sur certains produits américains. Cette spirale d’escalade menace de déchirer le tissu du commerce international qui a sous-tendu la prospérité mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les institutions comme l’Organisation mondiale du commerce semblent impuissantes à contenir cette fragmentation.
Le coût global de cette guerre commerciale dépasse largement les 3 000 milliards que les tarifs américains vont coûter aux entreprises et consommateurs américains. Quand on ajoute les représailles d’autres pays, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, la perte d’efficacité économique due à la relocalisation forcée de production vers des sites moins optimaux, et l’incertitude qui freine les investissements — le chiffre réel pourrait facilement doubler ou tripler. Des économistes ont averti que cette politique protectionniste pourrait déclencher une récession mondiale si elle persistait. Ironiquement, Trump justifie ses tarifs comme nécessaires pour protéger l’économie américaine, mais les entreprises américaines — surtout les petites — sont parmi les premières victimes.
L’érosion de la confiance dans le système commercial multilatéral
Peut-être plus grave encore que les coûts économiques directs est l’érosion de la confiance dans le système commercial basé sur des règles que les États-Unis eux-mêmes avaient largement conçu et défendu après 1945. Quand le pays qui a été le principal architecte et garant de l’ordre commercial international décide soudainement de l’ignorer, imposant des tarifs massifs en violation probable de ses engagements à l’OMC, quel message cela envoie-t-il aux autres nations ? Si les États-Unis peuvent unilatéralement déclarer que leurs déficits commerciaux constituent une urgence nationale justifiant des tarifs punitifs, qu’est-ce qui empêche la Chine, l’Inde ou le Brésil de faire de même demain pour n’importe quelle raison ?
Cette situation crée un dangereux précédent de fragmentation économique mondiale. Plutôt qu’un système mondial intégré où les biens, services et capitaux circulent relativement librement selon des règles convenues, nous glissons vers un monde de blocs commerciaux rivaux, chacun utilisant le commerce comme arme géopolitique. Les petites entreprises — qu’elles soient américaines, canadiennes, européennes ou asiatiques — sont les premières victimes de cette fragmentation. Elles n’ont ni les ressources pour naviguer dans des régimes réglementaires multiples et changeants, ni le poids politique pour obtenir des exemptions. Les grandes multinationales finiront par s’adapter ; ce sont les entrepreneurs ordinaires qui paieront le prix de cette désintégration de l’ordre commercial.
L'audience cruciale du 5 novembre 2025

Un calendrier exceptionnellement accéléré
Le fait que la Cour suprême ait accepté d’entendre les appels le 9 septembre 2025 et fixé les arguments oraux au 5 novembre — à peine deux mois plus tard — est remarquable. Normalement, le processus entre l’acceptation d’un cas (*certiorari*) et les arguments oraux prend plusieurs mois, parfois près d’un an. Ce calendrier accéléré indique que les juges comprennent l’urgence économique de la situation. Chaque jour où les tarifs restent en place coûte des millions de dollars aux entreprises américaines. Chaque semaine d’incertitude juridique empêche des investissements et des embauches. La Cour a clairement décidé que cette affaire méritait d’être tranchée rapidement, sans les délais habituels qui caractérisent la justice américaine.
Cette rapidité comporte toutefois des risques. Les juges auront moins de temps pour digérer les arguments complexes, étudier les précédents historiques, et peser les implications constitutionnelles profondes de leur décision. Les avocats des deux côtés ont dû condenser leurs mémoires et préparer leurs arguments oraux dans des délais serrés — un défi particulier pour les petites entreprises qui ont moins de ressources légales que le gouvernement fédéral. Mais l’alternative — laisser l’incertitude persister pendant des mois supplémentaires — était jugée inacceptable par la Cour. Le 5 novembre 2025 sera donc un jour crucial, non seulement pour les parties directement impliquées, mais pour l’équilibre constitutionnel des pouvoirs aux États-Unis.
Les questions que la Cour doit trancher
Au cœur de l’affaire se trouvent plusieurs questions juridiques interconnectées. Premièrement : le mot « réguler » dans l’IEEPA inclut-il le pouvoir d’imposer des tarifs qui génèrent des revenus ? Deuxièmement : si oui, existe-t-il des « principes intelligibles » suffisants dans la loi pour guider l’exercice de ce pouvoir, ou s’agit-il d’une délégation inconstitutionnelle du pouvoir législatif ? Troisièmement : la doctrine des questions majeures s’applique-t-elle à l’imposition de tarifs par le président, exigeant une autorisation congressionnelle claire pour des décisions de cette ampleur économique ? Quatrièmement : les considérations de sécurité nationale et de politique étrangère invoquées par Trump justifient-elles une déférence judiciaire spéciale, même quand il s’agit du pouvoir de taxation ?
Chacune de ces questions implique des enjeux constitutionnels fondamentaux. Si la Cour conclut que « réguler » inclut « taxer », cela pourrait potentiellement affecter l’interprétation de centaines d’autres lois fédérales utilisant ce terme. Si elle applique strictement la doctrine des questions majeures, elle pourrait limiter significativement le pouvoir présidentiel dans de nombreux domaines au-delà des tarifs. Si elle accorde une large déférence au président en matière de sécurité nationale, elle pourrait ouvrir la porte à des abus futurs où chaque problème politique est requalifié en « urgence de sécurité nationale » pour contourner le Congrès. Les implications de cette décision résonneront pendant des décennies, influençant non seulement la politique commerciale mais l’équilibre même des pouvoirs entre les branches du gouvernement américain.
Les scénarios possibles et leurs conséquences
Si la Cour suprême confirme l’illégalité des tarifs, les conséquences seront immédiates et massives. L’administration Trump devra probablement rembourser plus de 210 milliards de dollars déjà perçus — un transfert financier sans précédent qui pourrait lui-même déclencher des perturbations économiques. Les entreprises qui ont absorbé ces coûts ou les ont répercutés sur les consommateurs devront naviguer le processus complexe de récupération de ces sommes. Trump pourrait tenter d’imposer les mêmes tarifs sous une autorité légale différente, mais cela nécessiterait de suivre les procédures prévues par ces lois alternatives, incluant souvent des enquêtes, des périodes de commentaires publics, et des limites de taux — précisément les contraintes qu’il avait cherché à éviter en utilisant l’IEEPA.
Si au contraire la Cour donne raison à Trump, elle établira un précédent extraordinairement large pour le pouvoir présidentiel. Les présidents futurs pourront potentiellement imposer des milliers de milliards de dollars de taxes simplement en déclarant une urgence nationale — une perspective qui devrait inquiéter les Américains de toutes tendances politiques. Les petites entreprises perdront leur combat juridique mais continueront de subir les coûts écrasants des tarifs, avec toutes les conséquences économiques que cela implique. Le système commercial international continuera de se fragmenter, avec d’autres pays ripostant par leurs propres mesures protectionnistes. Et fondamentalement, l’équilibre constitutionnel entre le Congrès et le président sur la question cruciale du pouvoir de taxation aura été radicalement altéré.
Conclusion

Ce qui se joue devant la Cour suprême des États-Unis transcende largement la question technique des tarifs douaniers — c’est un combat existentiel sur la nature même de la démocratie constitutionnelle américaine. Quand des petites entreprises comme Learning Resources, hand2mind et V.O.S. Selections affrontent le pouvoir présidentiel devant les tribunaux, elles ne défendent pas seulement leurs marges de profit ou leur survie économique — aussi cruciales soient-elles. Elles défendent le principe fondamental selon lequel personne, pas même le président, ne peut imposer des milliers de milliards de dollars de taxes aux citoyens sans l’autorisation explicite de leurs représentants élus. Ce principe, inscrit dans la Constitution par les fondateurs qui avaient fui la taxation sans représentation, constitue un pilier de la liberté américaine.
Les chiffres sont vertigineux, presque abstraits dans leur ampleur : 3 000 milliards de dollars sur une décennie, 210 milliards déjà perçus, des coûts d’importation multipliés par 45 pour certaines entreprises. Mais derrière chaque dollar se cachent des histoires humaines — des entrepreneurs qui ont passé des décennies à construire leurs affaires, des employés dont les postes dépendent de la viabilité de ces compagnies, des consommateurs qui paieront ultimement la note par des prix plus élevés. Les petites entreprises, colonne vertébrale de l’économie américaine, se retrouvent prises en otage d’une guerre commerciale qu’elles n’ont jamais voulue, imposée par décrets présidentiels changeants qui rendent toute planification impossible. L’instabilité devient la nouvelle normalité — une normalité qui tue les investissements et l’innovation.
Le 5 novembre 2025, neuf juges de la Cour suprême rendront une décision qui résonnera pendant des générations. Confirmeront-ils que le président peut usurper le pouvoir de taxation du Congrès en invoquant des urgences nationales vaguement définies ? Ou réaffirmeront-ils que même en matière de sécurité nationale et de politique étrangère, le pouvoir de taxer appartient au peuple par l’intermédiaire de ses représentants élus ? La réponse déterminera non seulement le sort de ces tarifs spécifiques, mais l’équilibre fondamental des pouvoirs dans le système constitutionnel américain. Les enjeux dépassent les frontières américaines — le monde entier observe, car l’ordre commercial international lui-même pend dans la balance. Dans cette bataille juridique apparemment technique se joue quelque chose de bien plus vaste : la question de savoir si les règles, les institutions et les contraintes constitutionnelles comptent encore face au pouvoir présidentiel affirmé sans nuances. La réponse de la Cour suprême définira le contour de la démocratie américaine pour les décennies à venir.