« Je ne prévois pas soutenir de candidats après ce cycle électoral »
Les mots de Suárez, prononcés lors du symposium intitulé « Dieu, le gouvernement et l’algorithme », ont l’effet d’une bombe dans le monde évangélique. « Je ne prévois pas soutenir de candidats après ce cycle électoral », a-t-il déclaré, établissant une ligne claire dans le sable. Pour un homme qui a voté pour Trump trois fois — en 2016, 2020 et 2024 — et qui a conseillé l’administration Trump pendant des années, c’est un virage à 180 degrés. Suárez explique qu’il veut désormais se concentrer sur « la politique, pas la personnalité », privilégiant les discussions sur les concepts, les idées et les politiques plutôt que de remettre en question les choix de vote des autres. Mais cette décision n’est pas née d’une simple lassitude — elle est le fruit d’une désillusion profonde, d’une trahison ressentie viscéralement par un pasteur qui croyait servir à la fois Dieu et son pays.
L’idolâtrie trumpiste : « Cela confine à l’idolâtrie »
Suárez n’hésite pas à employer des termes théologiques durs pour décrire le phénomène MAGA. « Cela confine à l’idolâtrie », a-t-il affirmé, faisant référence à l’attitude de soumission aveugle qui entoure le mouvement de Trump. « Je ne peux pas y participer. » Pour un pasteur évangélique, accuser un mouvement politique d’idolâtrie est l’une des condamnations les plus sévères possibles — c’est dire que les partisans de Trump ont remplacé Dieu par un homme, qu’ils adorent une figure politique au lieu de suivre les enseignements du Christ. Cette critique fait écho aux préoccupations croissantes d’une partie de la communauté chrétienne qui voit dans le culte de la personnalité autour de Trump une dérive dangereuse, une forme de religion politique qui détourne les fidèles de leur foi véritable.
Stephen Miller : le véritable architecte de la cruauté
Si Suárez ménage encore partiellement Trump, il ne fait aucune concession concernant Stephen Miller, le conseiller principal de la Maison-Blanche et architecte des politiques d’immigration. Miller, figure controversée de l’administration, est connu pour ses positions extrêmement dures sur l’immigration et sa volonté de mettre en œuvre des mesures de répression massive. Suárez le tient directement responsable de la peur qui règne dans les congrégations hispaniques — des églises où les fidèles n’osent plus se rassembler par crainte d’être arrêtés, où les familles vivent dans la terreur quotidienne d’une descente de l’ICE. « Je le tiens responsable de beaucoup de l’idéologie actuelle », répète Suárez, insistant sur le fait que Miller incarne la ligne dure qui a transformé les promesses de réforme en machine de déportation massive.
La crise migratoire : des congrégations dans la terreur
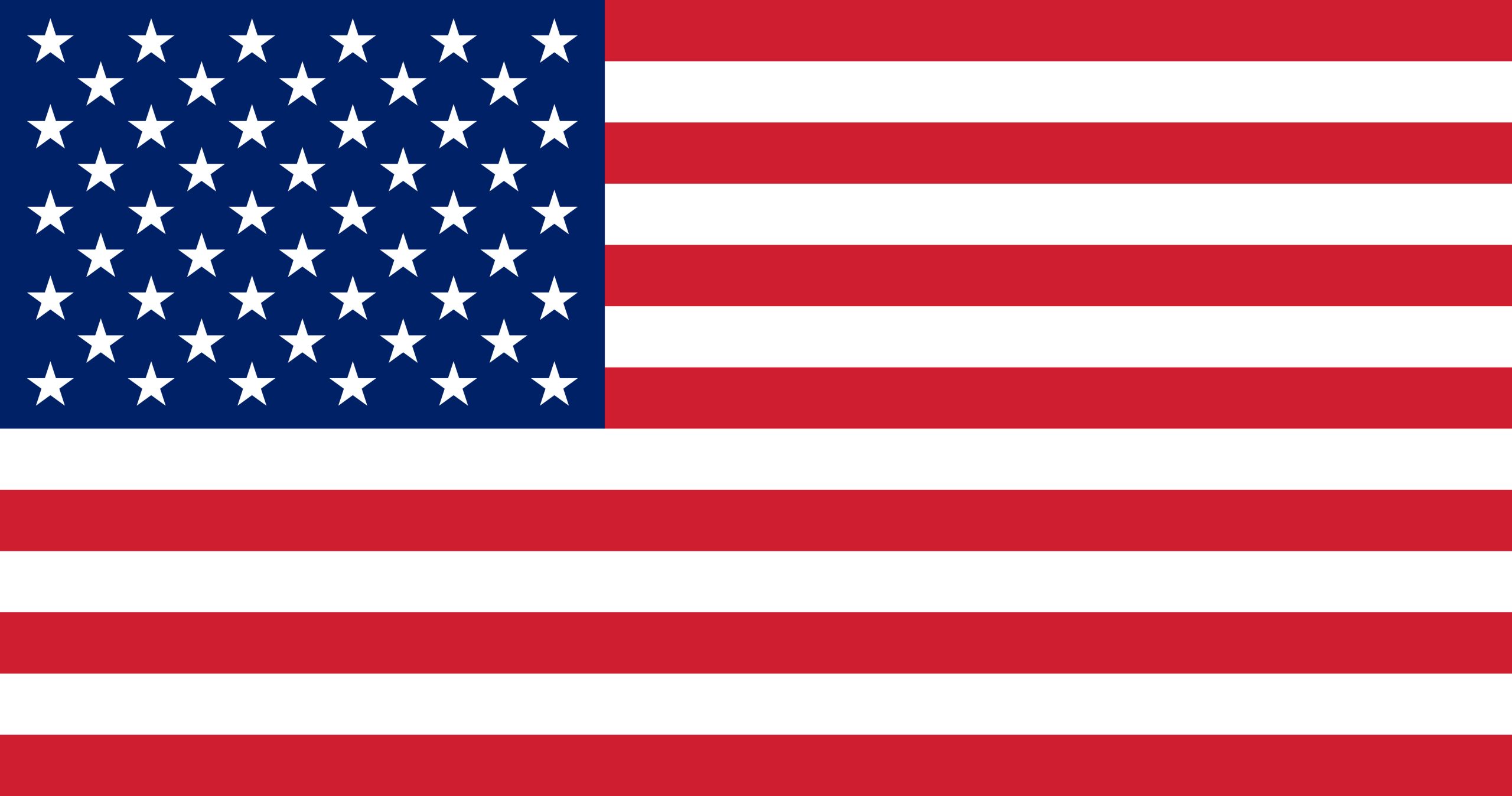
Des raids de l’ICE qui terrorisent les églises hispaniques
Les politiques d’immigration de Trump ont créé un climat de terreur absolue dans les communautés hispaniques à travers les États-Unis. Les raids de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) se multiplient, ciblant non seulement les lieux de travail mais aussi, de manière alarmante, les zones sensibles comme les églises, les écoles et les hôpitaux — des espaces qui étaient auparavant considérés comme des sanctuaires. Des pasteurs comme Suárez rapportent que leurs paroissiens vivent dans une peur constante, que les familles se cachent, que les enfants ne vont plus à l’école par crainte que leurs parents soient arrêtés pendant leur absence. Cette atmosphère de chasse à l’homme a déchiré le tissu social des communautés hispaniques, créant une crise humanitaire et spirituelle que les leaders religieux ne peuvent plus ignorer.
Des chrétiens déportés vers les pays qu’ils avaient fuis
L’ironie cruelle de la situation actuelle est que des chrétiens pratiquants, membres actifs de congrégations évangéliques, sont déportés vers les pays mêmes qu’ils avaient fuis pour échapper à la violence, à la persécution religieuse et à la pauvreté extrême. Des pasteurs comme le révérend Eddie Anderson et le révérend Brendan Busse dénoncent avec véhémence ces déportations, affirmant qu’elles violent les principes chrétiens les plus fondamentaux — l’accueil de l’étranger, la protection des plus vulnérables, la compassion envers ceux qui souffrent. Ces leaders religieux escortent maintenant des immigrants aux audiences judiciaires, organisent des vigiles de prière, envoient des alertes texte pour prévenir leurs communautés des descentes de l’ICE. C’est une forme de résistance spirituelle qui prend racine dans les Évangiles, dans les paroles de Jésus appelant à aider « le plus petit d’entre mes frères ».
Les deux partis coupables : promesses vides contre refus de dialogue
Suárez ne limite pas sa critique aux républicains — il condamne également les démocrates pour leurs « promesses vides » concernant les électeurs latinos et l’immigration. Selon lui, les démocrates parlent beaucoup de réforme migratoire mais n’ont jamais eu le courage ou la volonté politique de la mettre en œuvre lorsqu’ils en avaient l’opportunité. De l’autre côté, les républicains refusent catégoriquement d’engager une discussion rationnelle sur le sujet, préférant l’approche punitive et la rhétorique de la peur. Cette situation laisse les communautés hispaniques dans un vide politique total, sans allié véritable dans le système bipartisan américain. C’est cette absence de représentation authentique qui pousse des leaders comme Suárez à se retirer complètement du soutien électoral — parce qu’il n’y a personne qui mérite vraiment leur confiance.
Le « God gap » : la fracture qui divise le christianisme américain

Évangéliques conservateurs contre chrétiens modérés et progressistes
Les États-Unis sont témoins d’une fracture religieuse d’une ampleur historique au sein du christianisme, souvent appelée le « God gap » — l’écart de Dieu. D’un côté, les évangéliques conservateurs blancs restent majoritairement loyaux à Trump, soutenant sans réserve ses politiques d’immigration, ses déploiements de la Garde nationale, ses raids massifs contre les sans-papiers. De l’autre, une coalition de plus en plus visible de chrétiens modérés et progressistes — comprenant des catholiques, des protestants mainline, des évangéliques hispaniques et afro-américains — monte au front pour dénoncer ces politiques comme fondamentalement anti-chrétiennes. Cette division ne porte pas seulement sur des questions politiques — elle touche au cœur même de ce que signifie être chrétien en Amérique au XXIe siècle.
Les pasteurs modérés descendent dans la rue
Les leaders religieux modérés et progressistes ne se contentent plus de prêches du dimanche — ils descendent dans la rue, escortent des immigrants aux tribunaux, organisent des vigiles devant les centres de détention, envoient des « alertes rapides » par texto lorsque l’ICE est repéré dans un quartier. Le révérend Brendan Busse, pasteur de l’église catholique Dolores Mission à Los Angeles, résume leur philosophie : « Nous ne prions pas seulement pour la paix. Nous apportons la paix. » Ces pasteurs ont même mis physiquement leurs corps entre des manifestants et la Garde nationale en juin dernier pour empêcher l’escalade de la violence. Ils prient avec les agents de l’ICE et les soldats pour tenter d’apaiser les tensions, tout en donnant des ateliers « connaissez vos droits » aux immigrants. C’est une forme d’activisme chrétien qui puise directement dans les Évangiles, dans les enseignements de Jésus sur l’accueil de l’étranger et la protection des opprimés.
Les 15 millions de « chrétiens persuadables »
Cette mobilisation pourrait avoir des conséquences électorales majeures. Selon Doug Pagitt, pasteur et directeur exécutif du groupe chrétien progressiste Vote Common Good, il existerait environ 15 millions de « chrétiens persuadables » — des électeurs qui ne sont ni complètement à gauche ni totalement à droite, mais qui pourraient être mobilisés autour de valeurs chrétiennes de compassion, de justice sociale et d’accueil. Ces chrétiens modérés, souvent ignorés par les démocrates qui ont abandonné le langage religieux au profit d’un discours purement séculier, représentent un bloc électoral potentiellement décisif pour les élections de mi-mandat de 2026. Leur mobilisation pourrait rebattre les cartes politiques et remettre en question le monopole des évangéliques conservateurs sur la définition du « vote chrétien » en Amérique.
L'hypocrisie de l'administration Trump et les symboles religieux détournés

La vidéo de recrutement de l’ICE avec un verset biblique
L’administration Trump a récemment publié une vidéo de recrutement de l’ICE utilisant le verset biblique Ésaïe 6:8, où le prophète répond à l’appel de Dieu en disant : « Me voici, envoie-moi. » Cette instrumentalisation d’un texte sacré pour recruter des agents chargés de déporter des immigrants — dont beaucoup sont des chrétiens fuyant la persécution — a provoqué l’indignation des leaders religieux modérés. Pour eux, c’est une distorsion grotesque des Écritures, une manipulation cynique de la foi pour justifier des politiques cruelles. Le révérend Dave Gibbons, pasteur principal de l’église multiéthnique Newsong à Santa Ana en Californie, qualifie ces utilisations de versets bibliques de « distorsions des valeurs chrétiennes qui sanctifient l’exclusion et la peur ». C’est une forme de blasphème politique qui choque même certains conservateurs religieux.
Paula White-Cain et la théologie tordue de l’immigration
Paula White-Cain, leader du Bureau de la Foi à la Maison-Blanche de Trump et conseillère spirituelle personnelle du président, a déclaré que Jésus aurait été « pécheur » et non « notre Messie » s’il avait enfreint les lois sur l’immigration lorsqu’il a fui vers l’Égypte bébé avec sa famille pour échapper à la persécution d’Hérode, comme le raconte l’Évangile de Matthieu. Cette déclaration théologiquement absurde — puisque la fuite en Égypte est présentée dans les Évangiles comme l’accomplissement d’une prophétie divine — illustre à quel point l’administration Trump est prête à tordre les Écritures pour justifier ses politiques. White-Cain, qui prêche la « théologie de la prospérité » (l’idée que la foi se traduit par la richesse matérielle), est déjà considérée comme une hérétique par de nombreux évangéliques conservateurs. Sa nomination a même provoqué la colère de certains partisans chrétiens de MAGA qui la qualifient de « fausse enseignante ».
Le silence coupable de certains leaders évangéliques
Pendant que des pasteurs modérés risquent leur sécurité pour protéger les immigrants, de nombreux leaders évangéliques conservateurs restent remarquablement silencieux — ou pire, applaudissent les politiques de Trump. Des figures comme le pasteur Robert Jeffress de Dallas continuent de défendre Trump sans réserve, affirmant qu’il est « le président le plus pro-vie et pro-liberté religieuse de l’histoire ». Mais cette défense ignore complètement les souffrances infligées aux communautés immigrantes chrétiennes, la séparation des familles, les déportations de personnes qui ont fui la violence. Pour les critiques, ce silence n’est pas neutre — c’est une complicité morale, une acceptation tacite de politiques qui violent les enseignements les plus fondamentaux du Christ sur l’accueil de l’étranger et la compassion envers les plus vulnérables.
Les conséquences électorales : vers un réalignement religieux ?

Les évangéliques hispaniques : une rupture générationnelle
Les évangéliques hispaniques, qui représentent un segment en croissance rapide du protestantisme américain, traversent une crise existentielle face aux politiques de Trump. Alors que certains membres plus âgés restent loyaux au président en raison de ses positions contre l’avortement et pour la « liberté religieuse », les jeunes générations se détournent massivement de lui. Ces jeunes Hispaniques évangéliques ne peuvent pas réconcilier leur foi avec des politiques qui déportent des membres de leurs propres familles, qui terrorisent leurs communautés, qui traitent les Latino-Américains comme des criminels par défaut. Cette fracture générationnelle pourrait avoir des conséquences électorales majeures dans les années à venir, transformant ce qui était autrefois un bloc électoral relativement prévisible en un groupe beaucoup plus volatile et imprévisible.
Le risque pour les républicains en 2026
Les élections de mi-mandat de 2026 s’annoncent comme un test crucial pour l’administration Trump et le Parti républicain. Si les chrétiens modérés et hispaniques se mobilisent massivement contre les politiques d’immigration, cela pourrait coûter aux républicains des sièges clés dans des États comme le Texas, l’Arizona, la Floride et le Nevada — des États avec d’importantes populations hispaniques où les marges de victoire sont souvent minces. Le révérend Joseph Tomás McKellar, directeur exécutif de PICO California, espère que ce mouvement deviendra une « force politique plutôt qu’une force partisane » — c’est-à-dire un mouvement capable d’influencer les deux partis plutôt que de s’aligner automatiquement sur l’un ou l’autre. Mais dans le climat polarisé actuel, cette aspiration semble presque utopique.
Les démocrates peuvent-ils capitaliser sur cette ouverture ?
Pour les démocrates, cette fracture religieuse représente à la fois une opportunité et un défi. L’opportunité, c’est de reconquérir une partie de l’électorat chrétien en parlant le langage de la foi, en mettant en avant des valeurs de compassion, de justice sociale, d’accueil de l’étranger. Mais le défi est immense — le Parti démocrate a passé des décennies à se séculariser, à abandonner le discours religieux, à laisser le monopole de la foi aux républicains. Reconquérir cet espace nécessitera plus que quelques discours bien tournés — cela demandera une transformation profonde de la manière dont le parti parle de valeurs, de morale, de foi. Certains leaders démocrates, conscients de cette ouverture, commencent à tendre la main aux chrétiens modérés. Mais il reste à voir si cette approche sera suffisante pour convaincre des électeurs qui se sentent profondément trahis par le système politique dans son ensemble.
L'idolâtrie MAGA : quand la politique remplace la religion

Le culte de la personnalité autour de Trump
Plusieurs pasteurs et théologiens ont commencé à employer un terme extrêmement fort pour décrire le phénomène MAGA : l’idolâtrie. L’ancien leader évangélique Rob Schenck, qui a rompu avec le mouvement conservateur à cause de Trump, va encore plus loin : « Je ne pense pas qu’on puisse être chrétien et embrasser Donald Trump, parce que je le vois comme l’antithèse de tout ce que Jésus représentait, tout ce qu’il a modelé, et dans ma théologie, tout ce pour quoi il est mort. » Ces mots, prononcés publiquement pour la première fois, constituent une accusation dévastatrice — l’idée qu’être chrétien et soutenir Trump sont des positions mutuellement exclusives. Pour Schenck, le mouvement MAGA représente une forme d’apostasie, un abandon de la foi chrétienne au profit d’une religion politique qui adore un homme plutôt que Dieu.
Les images messianiques et la rhétorique divine
Depuis la tentative d’assassinat de mai 2024, la rhétorique messianique autour de Trump a atteint des sommets inquiétants. Ses partisans les plus fervents parlent ouvertement de lui comme d’un « élu de Dieu », comme d’un homme « protégé par la main divine », allant jusqu’à comparer sa survie à l’assassinat à des miracles bibliques. Trump lui-même alimente cette rhétorique, se présentant comme un martyr persécuté, comme un prophète incompris, comme le seul capable de « sauver l’Amérique ». Cette fusion dangereuse entre politique et messianisme crée un culte de la personnalité qui effraie même certains conservateurs religieux. L’historienne Kristin Kobes Du Mez, auteure de « Jesus and John Wayne », avertit que ce nationalisme chrétien blanc transformera fondamentalement le gouvernement américain si le mouvement atteint ses objectifs.
La pression pour se conformer ou se taire
Les évangéliques qui n’adhèrent pas au nationalisme chrétien blanc font face à une pression immense pour se conformer ou, au minimum, pour rester silencieux. Comme l’explique Du Mez, « vous n’avez pas besoin d’approuver Trump ou l’agenda MAGA, mais parler contre cela pourrait mettre en péril votre emploi. » Cette dynamique crée un climat de peur dans les institutions évangéliques — églises, universités, médias chrétiens — où la dissidence est réprimée, où poser des questions devient dangereux. De nombreux pasteurs modérés racontent qu’ils ont été exclus, ostracisés, bannis de leurs propres communautés simplement pour avoir exprimé des doutes sur Trump. C’est une forme de totalitarisme religieux qui transforme la foi en instrument de contrôle politique plutôt qu’en source de liberté spirituelle.
Les voix dissidentes : ceux qui ont quitté le navire MAGA

Rob Schenck : du militantisme anti-avortement à l’opposition à Trump
Rob Schenck, ancien leader évangélique et militant farouchement anti-avortement, représente l’une des ruptures les plus spectaculaires avec le mouvement MAGA. Schenck raconte comment il a rompu avec ses anciens alliés lorsqu’ils ont choisi Trump comme champion. « Je l’ai trouvé répugnant. Je pensais qu’il était un charlatan, un faux, un homme de foire », dit-il. Mais ce qui a définitivement scellé sa rupture, c’est quand il a annoncé publiquement qu’il votait pour Joe Biden en 2020 — une décision qui l’a fait bannir de son propre mouvement. « Pour beaucoup de mes confrères dans le monde évangélique, c’était la goutte d’eau. J’étais parti. J’étais maintenant banni, ostracisé. Il n’y avait plus de place pour moi dans leur monde. » Schenck vit désormais avec des regrets profonds concernant son militantisme passé, réalisant que le mouvement qu’il a aidé à construire a été détourné pour servir des objectifs politiques plutôt que spirituels.
Joshua Harris : « Le soutien à Trump a été extrêmement dommageable »
L’ancien pasteur de mégaéglise Joshua Harris, auteur évangélique influent, a déclaré en 2019 que le soutien massif que Trump a reçu de la communauté évangélique a été « extrêmement dommageable pour l’Évangile et l’église ». Harris, qui a renoncé publiquement à sa foi en 2019, estime qu’« avoir un leader comme Trump est, en soi, une partie de l’accusation » contre les chrétiens. Il compare la situation aux récits de l’Ancien Testament où les prophètes étaient associés à des leaders corrompus — une connexion qui reflétait le jugement divin sur les fausses religions de l’époque. « Je ne pense pas que cela finira bien », a-t-il averti, craignant que l’association de l’église avec Trump n’entraîne des conséquences négatives à long terme pour le christianisme américain.
Franklin Graham : « Bien sûr qu’il a perdu l’élection »
Même Franklin Graham, fils du célèbre évangéliste Billy Graham et partisan de longue date de Trump, a finalement admis en 2023 que Trump avait « bien sûr » perdu l’élection de 2020. « Il n’y a aucun doute là-dessus », a-t-il déclaré, bien qu’il ait reconnu que des millions de personnes ne le croient pas. Cette admission, venant d’un homme qui avait appelé à une journée de prière pour protéger Trump de ses ennemis et qui avait prié lors de son investiture, représente un changement subtil mais significatif. Graham continue de défendre Trump en tant que protecteur de la foi chrétienne, mais sa volonté de reconnaître la vérité sur l’élection de 2020 le distingue des trumpistes les plus fanatiques. C’est un équilibre précaire — soutenir Trump tout en admettant certaines de ses failles — qui reflète la position inconfortable de nombreux évangéliques modérés.
Conclusion

La déclaration du révérend Tony Suárez — « Je suis très frustré » — résonne comme le cri d’une génération de leaders religieux qui ont cru, qui ont espéré, qui ont prié, et qui aujourd’hui se retrouvent face aux ruines de leurs illusions. Cette rupture entre un pasteur influent et le mouvement politique qu’il a soutenu pendant près d’une décennie n’est pas un incident isolé — c’est le symptôme d’une fracture profonde qui traverse le christianisme américain, une division qui pourrait remodeler fondamentalement le paysage religieux et politique des États-Unis dans les années à venir. Quand un homme qui a voté trois fois pour Trump, qui a conseillé son administration, qui a défendu publiquement ses politiques, déclare qu’il ne soutiendra plus jamais de candidat politique, c’est que quelque chose s’est irrémédiablement brisé — une confiance trahie, une foi détournée, une espérance anéantie.
Les politiques d’immigration brutales de l’administration Trump, orchestrées principalement par Stephen Miller, ont créé une crise humanitaire et spirituelle dans les communautés hispaniques chrétiennes à travers le pays. Des raids de l’ICE qui terrorisent les congrégations, des familles déchirées, des chrétiens déportés vers les pays qu’ils avaient fuis — tout cela au nom d’une idéologie de pureté nationale qui contredit frontalement les enseignements du Christ sur l’accueil de l’étranger et la compassion envers les vulnérables. Pendant ce temps, l’administration Trump manipule cyniquement les symboles religieux, utilisant des versets bibliques pour recruter des agents de déportation, tandis que sa conseillère spirituelle Paula White-Cain tord les Écritures pour justifier des politiques cruelles. Cette instrumentalisation de la foi pour servir des objectifs politiques a provoqué l’indignation d’une coalition croissante de chrétiens modérés et progressistes qui descendent littéralement dans la rue pour défendre les immigrants, mettant leurs corps entre les manifestants et la Garde nationale, escortant les sans-papiers aux tribunaux, organisant des vigiles de prière devant les centres de détention. Le « God gap » — l’écart de Dieu — divise désormais le christianisme américain en deux camps irréconciliables : d’un côté, les évangéliques conservateurs qui voient en Trump un protecteur oint par Dieu ; de l’autre, une coalition diverse qui dénonce le culte de la personnalité autour du président comme une forme d’idolâtrie politique, une apostasie qui remplace l’adoration de Dieu par l’adoration d’un homme. Cette division aura des conséquences électorales majeures en 2026, potentiellement transformant les chrétiens modérés en force politique capable de défier le monopole conservateur sur le « vote chrétien ». Mais au-delà des calculs électoraux, c’est l’âme même du christianisme américain qui est en jeu — une bataille théologique et morale dont l’issue déterminera si la foi peut encore servir de boussole morale dans une société profondément polarisée, ou si elle sera définitivement détournée pour servir les intérêts du pouvoir politique.