La capitulation ukrainienne comme seule issue acceptable
Lorsque Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a pris la parole lundi 21 octobre, son message était d’une clarté cristalline — la Russie ne veut pas d’un cessez-le-feu temporaire, elle exige une « paix stable à long terme » qui réponde à toutes ses conditions. Et ces conditions n’ont pas changé depuis les premières heures de l’invasion du 24 février 2022. Lavrov a réitéré que Moscou cherche à éliminer les « causes profondes » du conflit, définies par le Kremlin comme l’expansion de l’OTAN vers l’est et la prétendue « discrimination contre les russophones » en Ukraine — deux narratifs fallacieux utilisés pour justifier l’agression. En substance, la Russie exige que l’Ukraine renonce à sa souveraineté, accepte la neutralité permanente, démantèle ses forces armées, renverse son gouvernement démocratiquement élu et installe un régime fantoche pro-russe. C’est exactement ce que Poutine voulait dès le départ — non pas quelques territoires, mais la destruction complète de l’Ukraine en tant qu’État indépendant capable de choisir son propre destin.
Crimée et quatre régions : le contrôle territorial non négociable
Les exigences territoriales de la Russie sont également restées inchangées. Moscou insiste pour que l’Ukraine reconnaisse la souveraineté russe sur la Crimée — annexée illégalement en 2014 — ainsi que sur les quatre régions partiellement occupées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Ces quatre régions ont été formellement annexées par la Russie en septembre 2022 lors d’une cérémonie au Kremlin, malgré le fait que Moscou ne contrôle même pas la totalité de ces territoires. La Russie occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien, mais elle revendique la souveraineté sur des zones qu’elle n’a jamais conquises. Et maintenant, malgré les discussions sur une possible « offre » où la Russie céderait quelques petites portions des régions de Kherson et Zaporijjia en échange du contrôle total du Donbass, Peskov a clairement affirmé lundi que « la position de la Russie ne change pas » — autrement dit, Moscou n’a pas renoncé à ses exigences maximalistes sur les cinq régions complètes. Pour Poutine, accepter moins reviendrait à admettre un échec militaire, quelque chose qu’il ne peut absolument pas se permettre politiquement.
Démilitarisation et dénazification : les euphémismes d’un changement de régime
Au-delà des territoires, les exigences russes incluent la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine — deux termes orwelliens qui masquent l’objectif réel : détruire la capacité de l’Ukraine à se défendre et renverser son gouvernement légitime. La « démilitarisation » signifie que l’Ukraine devrait dissoudre ou réduire drastiquement ses forces armées, abandonner ses systèmes de défense, renoncer à toute capacité de résistance militaire — la laissant complètement vulnérable à de futures invasions russes. La « dénazification » est encore plus insidieuse — c’est une attaque directe contre le gouvernement de Zelensky, que Moscou qualifie de « régime nazi » malgré le fait que Zelensky soit juif et que son grand-père ait combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce terme est un prétexte pour exiger le renversement du gouvernement ukrainien et son remplacement par un régime pro-russe obéissant. Poutine l’a dit explicitement au début de l’invasion — il veut installer des « autorités compétentes » à Kiev, c’est-à-dire des marionnettes contrôlées depuis Moscou.
Trump humilié : la fin des illusions sur Poutine

« Ils devraient s’arrêter là où ils sont » : la proposition ignorée
Après sa rencontre avec Zelensky vendredi 17 octobre, Trump a publié sur Truth Social ce qu’il croyait être une proposition géniale : « Ils devraient s’arrêter là où ils sont. Qu’ils revendiquent tous deux la victoire. » Cette approche simpliste — geler le conflit sur les lignes actuelles, permettre à chaque camp de déclarer qu’il a gagné — reflète la vision transactionnelle de Trump sur la géopolitique. Pour lui, la guerre en Ukraine est un problème à régler rapidement pour pouvoir passer à autre chose, un irritant qui empêche de se concentrer sur d’autres priorités. Mais Poutine a immédiatement rejeté cette proposition. Peskov a déclaré lundi que ce sujet avait été « évoqué à plusieurs reprises sous diverses formes lors des contacts entre la Russie et les États-Unis », et que « la partie russe a répondu à chaque fois » — en refusant catégoriquement. Moscou ne veut pas d’un gel du conflit qui laisserait l’Ukraine survivre et se reconstruire. Poutine veut la destruction totale de la capacité ukrainienne à résister, et un cessez-le-feu sans capitulation ne sert pas cet objectif.
L’appel téléphonique du 16 octobre : Poutine dicte ses conditions
Jeudi 16 octobre, Trump a eu une conversation téléphonique avec Poutine qu’il a initialement qualifiée de « très productive ». Mais selon des fuites rapportées par le Financial Times, cette conversation a en réalité été une leçon d’humiliation pour le président américain. Poutine aurait présenté à Trump une « nouvelle offre » : l’Ukraine céderait les parties du Donbass qu’elle contrôle encore en échange de quelques petites portions des régions de Kherson et Zaporijjia. Autrement dit, l’Ukraine abandonnerait des zones industrielles stratégiques vitales pour récupérer des fragments territoriaux sans importance stratégique. Et surtout, Poutine aurait menacé de « détruire » l’Ukraine si elle refusait ces conditions. Trump, loin de rejeter ces menaces, les aurait transmises à Zelensky lors de leur réunion explosive du lendemain, pressant le président ukrainien d’accepter sous peine de voir son pays anéanti. C’est une inversion complète du rôle que devrait jouer un président américain — au lieu de défendre un allié démocratique contre un agresseur autocratique, Trump est devenu le messager des ultimatums de Poutine.
Le sommet de Budapest annulé : « Je ne veux pas d’une réunion gâchée »
Face au refus catégorique de Poutine d’accepter ses propositions, Trump a finalement admis mercredi 22 octobre qu’il annulait le sommet prévu à Budapest. « Je ne veux pas d’une réunion gâchée », a-t-il déclaré aux journalistes, reconnaissant implicitement que Poutine ne cédera rien et qu’une rencontre serait une perte de temps. Cette annulation marque un tournant dans la stratégie de Trump sur l’Ukraine. Pendant des mois, le président américain a cru qu’il pourrait résoudre le conflit grâce à ses « bonnes relations » avec Poutine, qu’une simple conversation entre hommes forts suffirait à mettre fin à la guerre. Mais après l’échec du sommet d’Alaska en août 2025 — où Trump avait également cru obtenir une percée qui ne s’est jamais matérialisée — et maintenant l’annulation de Budapest, Trump est forcé de reconnaître une vérité amère : Poutine ne le respecte pas, ne le craint pas, et n’a aucune intention de négocier sérieusement tant qu’il pense pouvoir gagner militairement. C’est une défaite diplomatique cinglante pour un homme qui a bâti son image sur sa capacité à conclure des « deals » impossibles.
Zelensky coincé entre Trump et Poutine : la pression insoutenable

La réunion explosive du 17 octobre à la Maison-Blanche
La rencontre entre Trump et Zelensky vendredi 17 octobre à la Maison-Blanche était censée être une démonstration d’unité — mais selon plusieurs sources, elle s’est transformée en confrontation brutale. Des rapports de Reuters et d’autres médias indiquent que Trump aurait utilisé un langage très dur, pressant Zelensky d’accepter les demandes russes et le menaçant implicitement d’un retrait du soutien américain si l’Ukraine continuait à refuser de négocier. Trump aurait transmis les menaces de Poutine — que la Russie « détruirait » l’Ukraine si elle n’acceptait pas les conditions du Kremlin — comme si c’étaient des faits inévitables plutôt que du chantage pur et simple. Malgré cette pression écrasante, Zelensky a réussi à obtenir un engagement public de Trump en faveur d’un cessez-le-feu basé sur les lignes actuelles — une position que Kiev défend depuis longtemps. Mais le prix de cet engagement était élevé : Zelensky a dû accepter publiquement d’envisager le gel territorial si cela s’accompagnait d’un cessez-le-feu immédiat et de négociations sérieuses avec Moscou.
La question des territoires : « C’est notre souveraineté »
Après la réunion avec Trump, Zelensky a déclaré que la question la plus « sensible et difficile » restait celle des territoires ukrainiens. « Pour nous, c’est essentiel, notre terre et notre pays, parce que cela fait partie de notre indépendance. Il s’agit de notre souveraineté », a-t-il affirmé. Ces mots résument le dilemme existentiel de l’Ukraine — comment négocier avec un agresseur qui exige non seulement des territoires, mais la destruction de l’État ukrainien lui-même ? Zelensky a admis qu’il envisagerait un gel sur les lignes actuelles si la Russie acceptait un cessez-le-feu immédiat et des négociations directes sur un accord de paix. Mais cette ouverture est conditionnelle — Kiev ne cédera jamais formellement la souveraineté sur les territoires occupés, même si elle accepte temporairement le gel militaire. C’est une distinction cruciale que Poutine refuse d’accepter. Le président russe veut non seulement contrôler ces territoires, mais que l’Ukraine reconnaisse formellement qu’ils appartiennent désormais à la Russie — une humiliation que Zelensky ne peut accepter sans trahir son peuple.
Les 25 batteries Patriot : l’arme défensive négligée
Face à l’impasse diplomatique, Zelensky se tourne vers des solutions militaires. Lundi 21 octobre, le président ukrainien a annoncé que Kiev cherchait à obtenir 25 systèmes de défense aérienne Patriot supplémentaires dans le cadre d’un contrat à long terme avec les États-Unis. L’Ukraine a actuellement reçu seulement sept batteries Patriot — fournies par les États-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et Israël — ce qui est largement insuffisant pour protéger un pays de la taille de l’Ukraine contre les attaques massives de missiles et de drones russes. Les systèmes Patriot sont parmi les rares au monde capables d’intercepter des missiles balistiques, et leur importance stratégique est immense. Mais Trump a déjà signalé son scepticisme — il a déclaré que les États-Unis avaient « besoin de leurs Tomahawk et de beaucoup d’autres armes que nous envoyons à l’Ukraine », laissant entendre qu’il pourrait réduire plutôt qu’augmenter les livraisons d’armes. Cette position place Zelensky dans une situation impossible : presser de négocier avec la Russie sans lui donner les moyens militaires de négocier en position de force.
Les « causes profondes » : le prétexte russe pour justifier l'agression
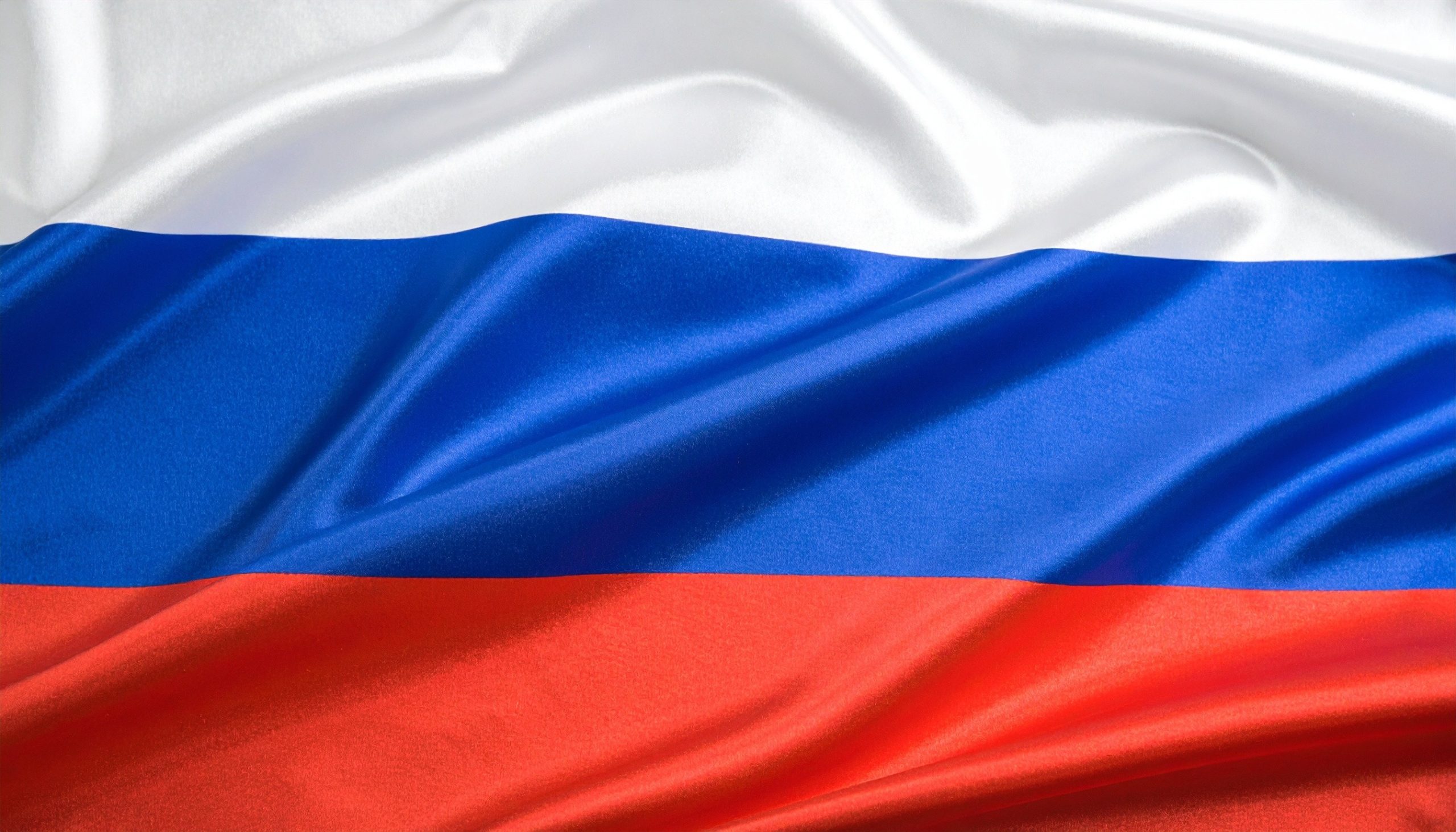
L’expansion de l’OTAN : un narratif fallacieux
Lavrov a répété lundi que la Russie ne peut accepter un simple cessez-le-feu sans résoudre les « causes profondes » du conflit — qu’il définit comme l’expansion de l’OTAN vers l’est et la prétendue discrimination contre les russophones en Ukraine. Ce narratif est au cœur de la propagande russe depuis des décennies. L’idée que l’OTAN « menace » la Russie en acceptant de nouveaux membres est une distorsion totale de la réalité — l’OTAN est une alliance défensive dont aucun pays n’est forcé de rejoindre, et son expansion résulte des demandes des pays d’Europe de l’Est qui cherchent à se protéger contre l’agression russe. La Russie prétend que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constituerait une menace existentielle, mais c’est un prétexte — la véritable menace pour Poutine est une Ukraine démocratique, prospère et alignée sur l’Occident, qui servirait d’exemple pour les citoyens russes et démontrerait qu’il existe une alternative au régime autocratique de Moscou. L’expansion de l’OTAN n’est pas la cause de la guerre — l’impérialisme russe et le refus de Poutine d’accepter l’indépendance ukrainienne le sont.
La discrimination contre les russophones : un mensonge instrumentalisé
L’autre « cause profonde » invoquée par Lavrov est la prétendue discrimination contre les russophones en Ukraine. Cette accusation est tout aussi fallacieuse. Avant l’invasion russe de 2014, l’Ukraine était un pays bilingue où le russe était largement parlé dans l’est et le sud du pays, et où les citoyens russophones jouissaient des mêmes droits que les autres. Les mesures linguistiques adoptées par l’Ukraine après 2014 visaient à promouvoir l’ukrainien comme langue officielle, mais elles n’interdisaient pas l’usage du russe dans la vie quotidienne, les médias ou la culture. De plus, ces mesures ont été adoptées en réponse directe à l’agression russe — lorsqu’un pays étranger envahit votre territoire en prétendant protéger ses « compatriotes », il est naturel de chercher à renforcer l’identité nationale. La Russie utilise la protection des russophones comme prétexte pour justifier l’invasion, exactement comme l’Allemagne nazie utilisait la protection des germanophones pour justifier l’annexion de la Tchécoslovaquie en 1938. C’est un classique de l’agression impérialiste déguisée en mission humanitaire.
La neutralité ukrainienne : l’effacement de la souveraineté
L’exigence russe de neutralité ukrainienne semble raisonnable en surface — pourquoi l’Ukraine ne pourrait-elle pas rester neutre comme l’Autriche ou la Suisse ? Mais dans le contexte russe, « neutralité » signifie quelque chose de très différent. Cela signifie que l’Ukraine ne pourrait jamais rejoindre l’OTAN ou l’Union européenne, ne pourrait jamais accueillir de bases militaires occidentales, ne pourrait jamais développer d’alliances stratégiques avec l’Occident. En substance, la « neutralité » imposée par la Russie transformerait l’Ukraine en un État tampon impuissant, incapable de se défendre contre une future agression russe. C’est exactement ce qui s’est passé avec la Finlandisation pendant la Guerre froide — la Finlande était techniquement neutre, mais dans la pratique, elle devait constamment tenir compte des préférences de Moscou dans sa politique étrangère. Poutine veut faire de l’Ukraine une version extrême de ce modèle — un pays nominalement indépendant mais entièrement soumis à la volonté russe, incapable de choisir son propre destin.
L'Institute for the Study of War : l'analyse qui révèle la stratégie russe
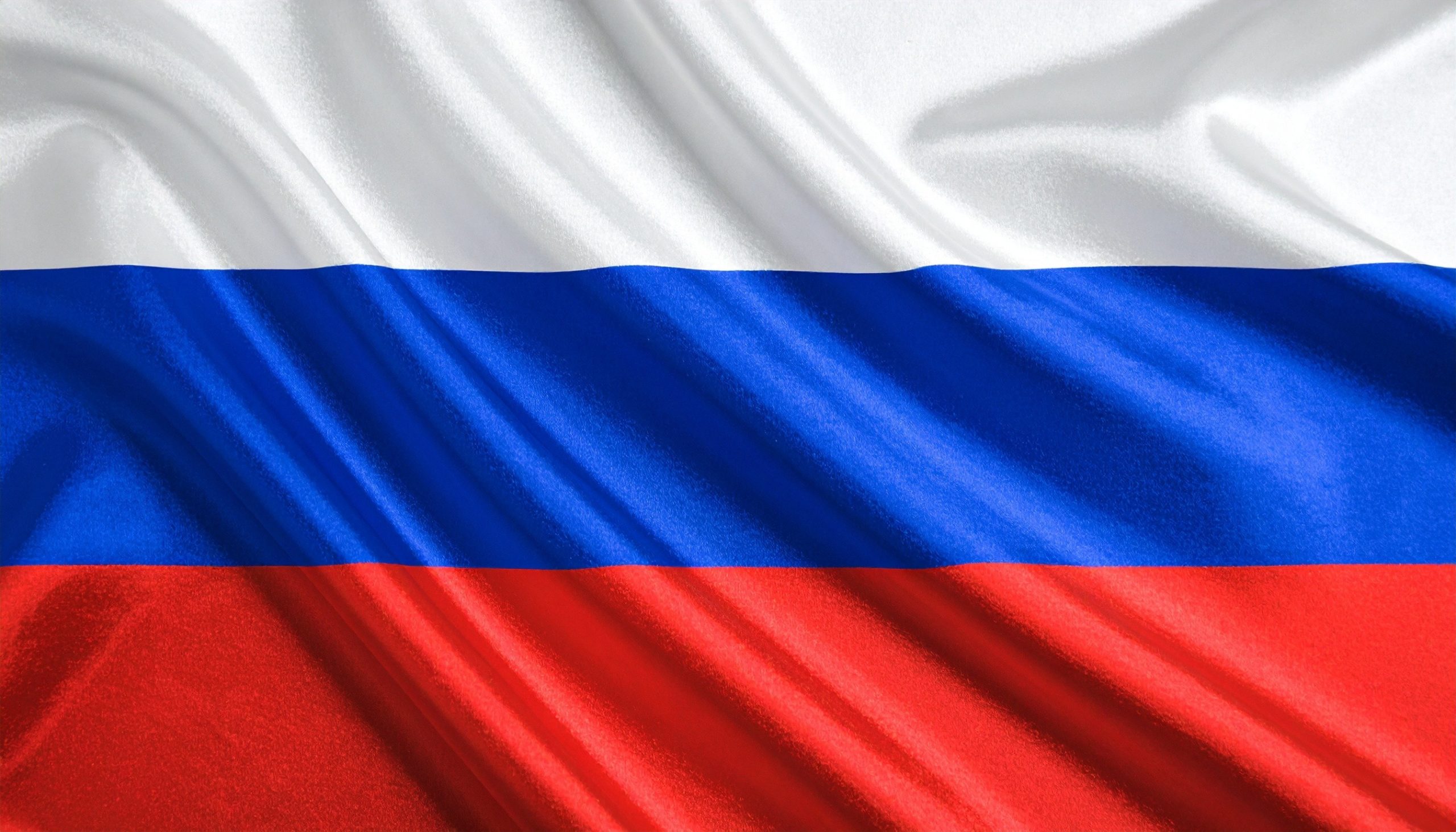
Le signal envoyé à Trump : vos demandes sont incompatibles avec nos objectifs
L’Institute for the Study of War (ISW), un think tank américain spécialisé dans l’analyse des conflits, a publié lundi 21 octobre un rapport dévastateur sur la stratégie russe. Les analystes de l’ISW concluent que « les déclarations de Lavrov soulignent la détermination du Kremlin à atteindre ses objectifs de guerre originaux malgré les demandes américaines d’une fin immédiate du conflit. » Autrement dit, la Russie utilise les déclarations publiques de Lavrov pour signaler à Trump que ses propositions de cessez-le-feu immédiat sont totalement incompatibles avec les buts de guerre russes. Ce n’est pas une négociation — c’est un ultimatum déguisé en diplomatie. L’ISW note que Poutine et les hauts responsables du Kremlin ont répété à maintes reprises qu’ils n’accepteront pas de cessez-le-feu tant que l’Ukraine et l’Occident ne satisferont pas les exigences russes : neutralité ukrainienne, renversement du gouvernement légitime, installation d’un régime pro-russe, modifications de la politique d’ouverture de l’OTAN. Ces objectifs n’ont pas changé depuis le début de l’invasion — et ils ne changeront pas parce que Trump veut conclure un accord.
Gagner du temps : la tactique éprouvée du Kremlin
L’analyse de l’ISW révèle également la tactique temporelle de Poutine. En acceptant de parler, en évoquant la possibilité de sommets, en laissant entendre que des compromis sont possibles, le Kremlin gagne un temps précieux pour renforcer ses positions militaires sur le terrain. Chaque semaine de négociations est une semaine où la Russie peut avancer dans le Donbass, consolider ses défenses dans les territoires occupés, mobiliser plus de troupes, produire plus d’armements. Poutine a utilisé cette tactique à maintes reprises — pendant les négociations d’Istanbul au printemps 2022, pendant les discussions indirectes via la Turquie et la Chine, et maintenant avec Trump. Il n’a aucune intention de conclure un accord, mais il maintient l’apparence de la négociation pour empêcher l’Occident de fournir à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner. C’est une stratégie cynique mais terriblement efficace — tant que l’Occident croit qu’un accord est possible, il hésite à escalader militairement.
La pression économique seule ne suffira pas
L’ISW conclut également que « la pression économique seule est insuffisante pour contraindre la Russie à négocier » et que « mettre fin à la guerre en Ukraine dépend d’un soutien militaire fort et continu à Kiev. » Cette conclusion va à l’encontre de la stratégie actuelle de Trump, qui mise principalement sur les sanctions économiques — comme celles annoncées mercredi 22 octobre contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil — pour forcer Poutine à négocier. Mais les sanctions, bien qu’importantes, n’ont jamais suffi à changer le comportement d’un régime autoritaire déterminé. La Russie a appris à contourner les sanctions, à trouver des marchés alternatifs, à restructurer son économie pour survivre à l’isolement. Ce qui pourrait vraiment changer la dynamique du conflit, c’est la fourniture à l’Ukraine d’armements offensifs capables de frapper profondément en territoire russe — des missiles Tomahawk, des avions de combat modernes, des systèmes d’artillerie à longue portée. Mais Trump refuse de fournir ces armes, craignant une escalade avec la Russie. Résultat : l’Ukraine est condamnée à se battre avec un bras attaché dans le dos.
Trump change de ton : premières sanctions depuis janvier 2025
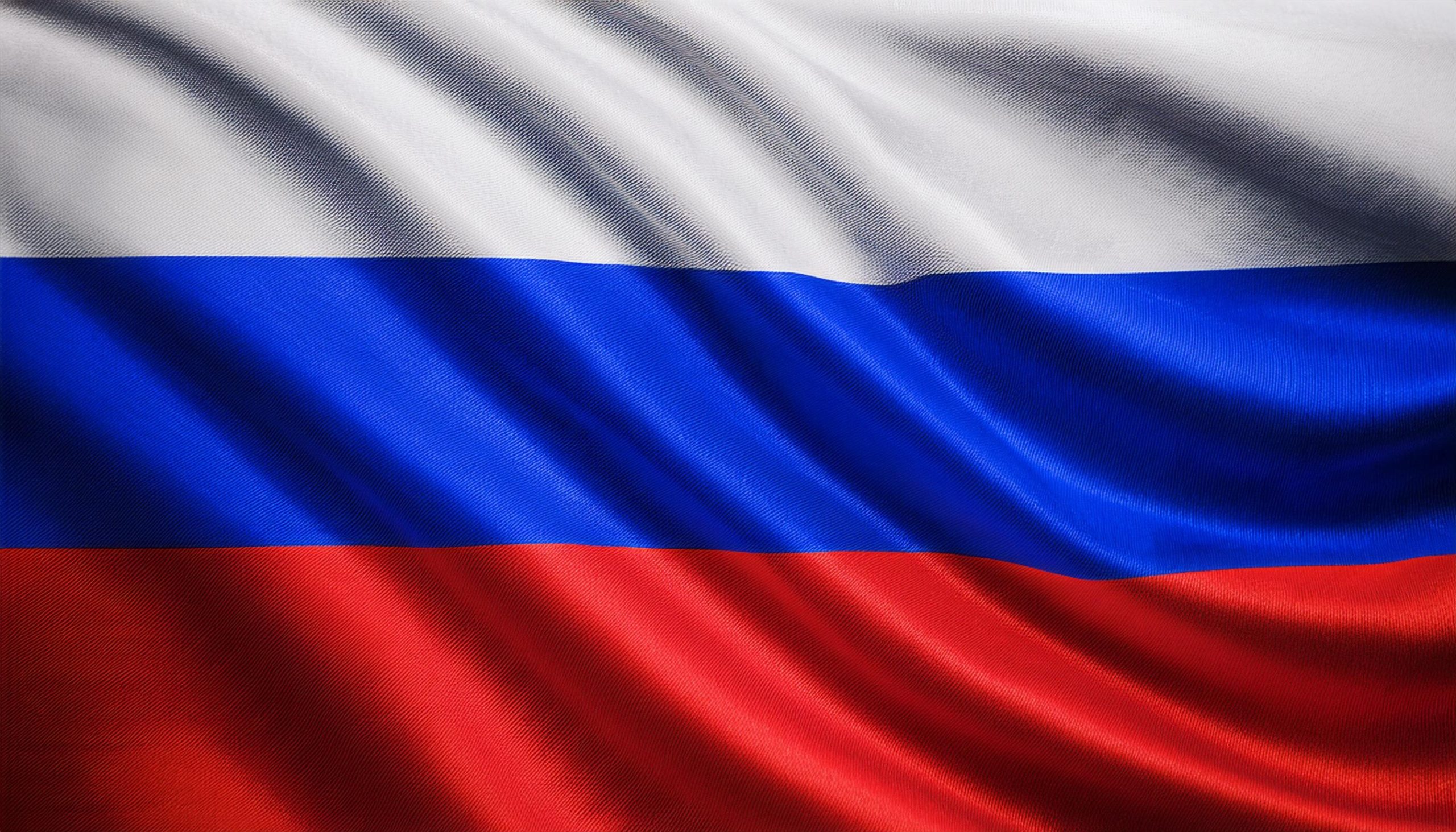
Rosneft et Lukoil dans le viseur : un signal fort
Face à l’humiliation diplomatique infligée par Poutine, Trump a finalement décidé de passer à l’action. Mercredi 22 octobre, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a annoncé des sanctions supplémentaires contre deux géants pétroliers russes — le groupe d’État Rosneft et la compagnie privée Lukoil, qui représentent ensemble près de la moitié des exportations de pétrole russe. C’est la première fois depuis janvier 2025 que l’administration Trump impose de nouvelles sanctions à la Russie, marquant un changement de ton significatif. Pendant les neuf premiers mois de son mandat, Trump avait refusé d’ajouter des sanctions, espérant que sa diplomatie personnelle avec Poutine suffirait à résoudre le conflit. Mais après l’échec du sommet d’Alaska en août et maintenant l’annulation de Budapest, Trump réalise qu’il a besoin d’utiliser le bâton en plus de la carotte. Ces sanctions visent à limiter la rente pétrolière qui finance la machine de guerre russe, en rendant plus difficile pour Moscou de vendre son pétrole sur les marchés internationaux.
« Poutine n’a été ni franc ni honnête » : l’aveu tardif
Le ministre des Finances américain est allé jusqu’à déclarer que « Vladimir Poutine n’a été ni franc ni honnête avec Donald Trump » lors de leurs récentes conversations. Cet aveu public d’un membre du cabinet Trump est extrêmement révélateur — il signifie que l’administration reconnaît finalement avoir été manipulée par le Kremlin. Pendant des mois, Trump a insisté sur le fait que ses conversations avec Poutine étaient « productives », que des « progrès » étaient réalisés, que la paix était « proche ». Maintenant, ses propres collaborateurs admettent que tout cela était une illusion, que Poutine mentait et manipulait dès le début. Cette reconnaissance tardive est embarrassante pour Trump, qui a bâti une partie de son image politique sur sa capacité à négocier avec les dirigeants autoritaires. Le fait que son propre ministre des Finances doive publiquement admettre que le président a été dupé par Poutine constitue une humiliation politique majeure.
Le « silence stupéfait » de Moscou face au durcissement américain
La réaction russe aux sanctions a été un « silence stupéfait », selon les termes utilisés par CNBC. Mercredi 22 et jeudi 23 octobre, aucun responsable russe de haut niveau n’a commenté publiquement les nouvelles sanctions ou l’annulation du sommet de Budapest. Ce silence est inhabituel pour un régime qui répond habituellement rapidement aux actions occidentales avec des contre-menaces et de la rhétorique belliqueuse. Il suggère que le Kremlin a été pris de court par le changement de ton de Trump, qu’il ne s’attendait pas à ce que le président américain passe aussi rapidement de la diplomatie à la confrontation. Vendredi 23 octobre, Poutine a finalement réagi — non pas par des déclarations diplomatiques, mais en organisant un vaste exercice des forces nucléaires stratégiques impliquant des tirs de missiles balistiques et de croisière depuis la mer de Barents jusqu’au Kamtchatka. C’est un message sans équivoque : si Trump veut jouer dur, la Russie peut escalader aussi. Poutine promet une réponse « très forte » si les États-Unis fournissent à l’Ukraine des missiles Tomahawk capables de frapper profondément en Russie.
L'Europe inquiète : la pression pour ne pas abandonner l'Ukraine

La déclaration conjointe des leaders européens
Face aux zigzags de la politique américaine sur l’Ukraine, les leaders européens ont publié mardi 22 octobre une déclaration conjointe exprimant leur « fort soutien à la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser et que les lignes de contact actuelles servent de point de départ aux négociations. » Cette déclaration, signée par le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Union européenne, vise à enfermer Trump dans un engagement public en faveur d’une position qui protège les intérêts ukrainiens — un cessez-le-feu sur les lignes actuelles, pas une capitulation qui céderait encore plus de territoire à la Russie. Les Européens craignent profondément qu’un deuxième sommet Trump-Poutine sans concessions russes ne conduise à un accord catastrophique où l’Ukraine serait sacrifiée sur l’autel des ambitions diplomatiques du président américain. Ils tentent de créer un cadre diplomatique qui limite la marge de manœuvre de Trump, qui l’empêche de faire des concessions unilatérales qui trahiraient Kiev.
La rencontre de Budapest avec Zelensky
Les leaders européens ont prévu de rencontrer Zelensky cette semaine à Budapest — ironiquement, la ville où devait se tenir le sommet Trump-Poutine annulé. Zelensky participera d’abord à un sommet de l’Union européenne, puis à une réunion de la « coalition des volontaires » discutant d’une force de sécurité internationale pour garantir une résolution d’après-guerre en Ukraine. Cette force de sécurité — essentiellement des troupes européennes déployées en Ukraine pour garantir un cessez-le-feu — est catégoriquement rejetée par la Russie, qui y voit une tentative de l’OTAN de s’établir en Ukraine par la porte de derrière. Mais pour les Européens, c’est la seule garantie crédible qu’un cessez-le-feu sera respecté — sans présence militaire occidentale, rien n’empêchera la Russie de violer un accord dès que ce sera opportun. Les discussions à Budapest détermineront si l’Europe est prête à assumer la responsabilité de défendre l’Ukraine, même si les États-Unis se retirent.
La crainte d’un nouveau Munich : ne pas répéter 1938
Dans les capitales européennes, on évoque de plus en plus ouvertement le spectre de Munich 1938 — quand la Grande-Bretagne et la France ont sacrifié la Tchécoslovaquie pour apaiser Hitler, cédant les Sudètes à l’Allemagne nazie dans l’espoir d’éviter la guerre. Cet apaisement n’a fait que retarder l’inévitable, encourageant Hitler à être encore plus agressif, conduisant finalement à la Seconde Guerre mondiale. Les leaders européens craignent que céder à Poutine maintenant — lui permettre de conserver les territoires ukrainiens conquis, forcer l’Ukraine à accepter la neutralité, affaiblir l’OTAN — ne conduise au même résultat : une pause temporaire suivie d’une agression encore plus grande. Si Poutine obtient ce qu’il veut en Ukraine sans payer de prix réel, il sera encouragé à cibler d’autres pays — la Moldavie, la Géorgie, peut-être même les États baltes membres de l’OTAN. C’est pourquoi les Européens insistent pour que tout accord inclue des garanties de sécurité crédibles et ne récompense pas l’agression russe.
Conclusion

Lorsque le porte-parole du Kremlin déclare froidement que « la cohérence de la position de la Russie ne change pas », il ne fait pas simplement une déclaration diplomatique — il inflige une humiliation publique à Donald Trump, signalant au monde entier que le président américain n’a aucune influence réelle sur Vladimir Poutine et que ses tentatives de négociation rapide sont vouées à l’échec. Cette gifle diplomatique du 21 octobre 2025 marque un tournant dans la guerre en Ukraine et dans la présidence de Trump — le moment où l’illusion s’effondre, où la réalité brutale s’impose : Poutine ne veut pas d’un compromis, il veut la capitulation totale de l’Ukraine, et aucune quantité de charme présidentiel ou de « bonnes relations » ne changera cela. Les exigences russes n’ont pas bougé d’un millimètre depuis février 2022 — contrôle territorial de la Crimée et des quatre régions partiellement occupées, démilitarisation de l’Ukraine, renversement du gouvernement de Zelensky, installation d’un régime fantoche pro-russe, modification de la politique d’ouverture de l’OTAN. Ces demandes équivalent à l’effacement de l’Ukraine en tant qu’État souverain, à la transformation d’un pays de 40 millions d’habitants en État vassal impuissant soumis à la volonté du Kremlin.
Trump, qui croyait pouvoir régler cette guerre « en 24 heures » grâce à ses prétendues capacités de négociateur exceptionnel, découvre la dure réalité de la géopolitique face à un autocrate déterminé et sans scrupules. Le sommet d’Alaska en août 2025 était déjà un échec — Trump avait cru obtenir une percée qui ne s’est jamais matérialisée. Maintenant, l’annulation du sommet de Budapest mercredi 22 octobre, accompagnée de l’aveu embarrassant de Trump qu’il ne voulait pas « une réunion gâchée », constitue une défaite diplomatique cinglante qui révèle au grand jour son impuissance face à Poutine. Le président américain a été forcé de reconnaître que Poutine l’a manipulé, que ses « bonnes relations » n’étaient qu’une illusion soigneusement entretenue par le Kremlin pour gagner du temps et semer la discorde au sein de l’OTAN. Face à cette humiliation, Trump a finalement réagi en imposant mercredi des sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil — les premières sanctions nouvelles depuis janvier 2025 — signalant un durcissement de sa position après des mois de diplomatie infructueuse. Mais ces sanctions, bien que significatives, arrivent tard et seront probablement insuffisantes tant que l’Ukraine ne recevra pas les armements offensifs nécessaires pour changer la dynamique militaire sur le terrain — des missiles Tomahawk, des avions de combat modernes, des systèmes d’artillerie à longue portée capables de frapper les infrastructures militaires russes en profondeur. L’Institute for the Study of War conclut que « la pression économique seule est insuffisante pour contraindre la Russie à négocier » et que « mettre fin à la guerre en Ukraine dépend d’un soutien militaire fort et continu à Kiev » — une analyse qui va à l’encontre de la stratégie actuelle de Trump mais qui reflète la réalité du conflit. Pendant ce temps, Zelensky se retrouve coincé dans une position impossible, presser par Trump d’accepter des concessions territoriales massives tout en faisant face aux exigences maximalistes de Poutine qui équivalent à une capitulation totale. L’Europe, inquiète de voir Trump potentiellement sacrifier l’Ukraine sur l’autel de ses ambitions diplomatiques, tente de créer un cadre qui limite sa marge de manœuvre et garantit que tout accord ne récompensera pas l’agression russe. Mais la question fondamentale demeure sans réponse : comment négocier avec un adversaire dont les objectifs sont totalement incompatibles avec toute paix juste ? Poutine a clairement signalé qu’il n’acceptera rien de moins que la destruction de l’Ukraine en tant qu’État souverain — et face à cette intransigeance, toute la diplomatie du monde ne servira à rien tant que l’Occident ne sera pas prêt à fournir à Kiev les moyens de gagner militairement ou à accepter l’humiliation d’une capitulation qui trahirait tous les principes démocratiques et encouragerait l’agression russe future contre d’autres pays.