Le triomphe médiatique russe
Revenons en arrière. Le 15 août 2025. Anchorage, Alaska. Base militaire conjointe d’Elmendorf-Richardson. Poutine pose le pied sur le sol américain pour la première fois depuis 2015, quand il avait participé à l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Cette fois, c’est différent. Il vient rencontrer Trump. Sur une base militaire américaine. Alors qu’une mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pèse sur lui pour crimes de guerre. La BBC l’a noté avec justesse : Moscou a accueilli ce sommet comme un triomphe diplomatique, le tapis rouge symbolisant la résurgence de la Russie sur la scène mondiale et l’échec de l’isolement de Moscou. Pendant près de trois heures, les deux hommes discutent. À la sortie, Poutine mentionne un « accord » lors de sa conférence de presse. Trump parle de « grands progrès. » Mais aucun cessez-le-feu. Aucun accord concret. Rien de tangible. Steve Witkoff, l’envoyé spécial de Trump, tente de justifier l’absence de résultat en expliquant à CNN : « Nous avons fait tellement de progrès lors de cette réunion concernant tous les autres ingrédients nécessaires à un accord de paix que nous — que le président Trump a pivoté vers cet endroit. » Pivoté. Quel mot magnifique pour dire on n’a rien obtenu.
Mais pour la Russie, peu importe. L’image compte plus que la substance. Poutine reçu en Alaska, traité comme un égal par le président américain alors qu’il est recherché internationalement — c’est déjà une victoire. Le Moscow Times cite des commentateurs russes qui ont caractérisé cette rencontre comme une gifle à Bruxelles, une démonstration que Moscou n’est plus isolé. Et pendant ce temps, sur le terrain en Ukraine, rien ne change. Les bombardements continuent. Les attaques s’intensifient. Le 27 août, quelques jours après le sommet d’Alaska, la Russie lance l’une des plus grandes attaques aériennes de la guerre selon l’Atlantic Council, tuant au moins vingt-trois personnes à Kiev. C’était un embarras pour la Maison-Blanche, qui insistait encore que la Russie était maintenant plus flexible. Flexible. Moscou venait de massacrer des civils ukrainiens par dizaines pour prouver sa « flexibilité. » La vérité brutale que John Herbst, ancien ambassadeur américain en Ukraine, a exprimée à l’Atlantic Council : « Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre. Son objectif n’est pas de verrouiller ses gains ou de prendre le reste de l’oblast de Donetsk, mais de prendre le contrôle politique effectif de l’Ukraine. »
Le double jeu permanent de Moscou
Depuis août, c’est le même scénario qui se répète. Moscou fait miroiter des possibilités de négociation, parle de « compréhensions » atteintes, suggère une ouverture — et puis bombarde plus fort. Sergey Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a eu une conversation téléphonique avec Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, le lundi 20 octobre. Le Kremlin a décrit cet appel comme une « discussion constructive » qui abordait « des étapes concrètes possibles pour mettre en œuvre les compréhensions » entre Trump et Poutine. Magnifique. Sauf qu’un jour plus tard, Lavrov dit aux journalistes que la Russie rejette « les signaux venant de Washington » concernant un désir de mettre fin à la guerre le long des lignes de bataille actuelles. Politico a rapporté que Lavrov a précisé à Rubio que les exigences russes en Ukraine n’ont pas changé. Pas changé. C’est-à-dire : contrôle total des quatre oblasts de l’est et du sud, neutralité permanente de l’Ukraine, pas d’adhésion à l’OTAN, pas de troupes étrangères. En gros, capitulation ukrainienne totale.
Andrei Fedorov, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères russe, l’a dit franchement à NBC News le 23 octobre : « Cela représente la différence fondamentale existant actuellement entre la Russie et les États-Unis. » Washington veut un cessez-le-feu maintenant, négociations ensuite. Moscou veut des concessions ukrainiennes massives d’abord, peut-être un cessez-le-feu ensuite. C’est incompatible. Totalement. Et pendant que cette comédie diplomatique se joue, les gens meurent. Six personnes dans la nuit du 21 au 22 octobre selon NBC News, tuées par des frappes russes peu après que Trump ait annoncé qu’il ne voulait pas perdre son temps à rencontrer Poutine. Le président ukrainien Zelensky l’a exprimé avec une clarté déchirante : « La Russie fait tout pour éviter la diplomatie. Plus les capacités à longue portée de l’Ukraine seront étendues, plus la Russie sera encline à conclure le conflit. » Plus on frappe fort, plus Moscou négocie. C’est la seule langue que le Kremlin comprend. Et l’Occident continue de croire aux paroles russes plutôt qu’aux actes russes.
Budapest fantôme : le sommet qui n'a jamais existé

L’annonce puis le démentissement
Le 16 octobre, Trump et Poutine ont une conversation téléphonique. Trump en sort enthousiaste et annonce qu’il rencontrera Poutine « dans les deux semaines » en Hongrie pour discuter de l’Ukraine. L’agence NHK rapporte qu’un représentant de la Maison-Blanche avait confirmé que Rubio et Lavrov devaient se rencontrer comme précurseur au sommet. Tout semble se mettre en place. Les médias d’État russes se délectent de cette perspective selon le Moscow Times, y voyant encore une fois une victoire diplomatique — rencontrer Trump en Europe, sans l’Union européenne. Budapest. La Hongrie d’Orbán, le plus pro-russe des leaders européens. Un pied de nez à Bruxelles. Parfait pour Moscou. Sauf que. Cinq jours plus tard, le 21 octobre, tout s’effondre. La Maison-Blanche annonce qu’il n’y a « pas de projets » pour une rencontre dans un futur immédiat. Le Kremlin, pris de court, commence son numéro de contorsion sémantique. Peskov déclare le 22 octobre : « Les dates n’ont en réalité pas été fixées. » Attendez. Trump avait dit deux semaines. Maintenant Peskov prétend qu’aucune date n’a jamais été fixée. C’est du révisionnisme en temps réel.
Trump, interrogé sur les raisons du délai, refuse de fournir des détails mais cadre le report comme une question d’efficacité selon Al Jazeera : « Je ne veux pas d’une réunion gaspillée. Je ne veux pas perdre mon temps, donc je verrai ce qui se passe. » Et puis, le 23 octobre, il devient encore plus direct selon CNN. Debout aux côtés du secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, Trump lâche : « J’ai annulé la réunion avec le président Poutine. Ça ne semblait pas juste de procéder à la réunion. Ça ne semblait pas que nous atteindrions le résultat nécessaire. Donc je l’ai annulée, mais nous la reprogrammerons pour l’avenir. » Puis cette phrase qui tue : « Chaque conversation que j’ai avec Vladimir est productive, pourtant elles ne mènent nulle part. Elles ne donnent simplement pas de résultats. » Ne mènent nulle part. Ne donnent pas de résultats. C’est un aveu d’échec complet de la stratégie Trump envers Poutine. Six mois de tentatives de négociation. Deux sommets prévus. Des dizaines d’appels. Résultat ? Zéro. Nada. Rien.
La stratégie de retardement russe
Mais pour Moscou, c’est exactement le plan. Oleksandr Merezhko, membre du parlement ukrainien et président de son comité des affaires étrangères, l’a expliqué à ABC News avec une lucidité brutale : « L’objectif principal de la Russie est d’éviter les sanctions en prétendant négocier. Poutine n’est pas intéressé par les négociations et le cessez-le-feu, parce qu’il espère lancer une offensive pendant l’été. » Prétendre négocier pour éviter les sanctions. C’est tout. Le Moscow Times rapporte que des publications russes ont exhorté ces derniers jours à continuer l’action militaire. Moskovsky Komsomolets a déclaré : « Il n’y a pas une seule raison pour laquelle nous devrions accepter un cessez-le-feu. » Pas une seule raison. Pourquoi accepter un cessez-le-feu quand on gagne du terrain ? Quand l’Occident hésite à fournir plus d’armes à l’Ukraine ? Quand Trump presse Kiev de céder du territoire ? La stratégie russe est simple et efficace : traîner les négociations, bombarder pendant ce temps, gagner plus de terrain, puis exiger encore plus de concessions. Rincer et répéter.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov a déclaré le 22 octobre selon TASS que « les préparatifs pour un sommet se poursuivent, » ajoutant que ces préparatifs « peuvent prendre diverses formes. » Diverses formes. Ça veut tout dire et rien dire. C’est l’ambiguïté comme arme diplomatique. Pendant ce temps, Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a publié un message sur Telegram le 23 octobre qui révèle le vrai visage de Moscou. Newsweek l’a cité : « Les États-Unis sont notre adversaire, et leur bavard ‘artisan de paix’ s’est maintenant complètement embarqué sur un chemin de conflit avec la Russie. » Il poursuit, parlant des nouvelles sanctions américaines contre les géants pétroliers russes : « Les actions entreprises représentent un acte de guerre contre la Russie. » Acte de guerre. Voilà le langage réel du Kremlin quand les caméras sont éteintes. Et Medvedev conclut avec ce qui pourrait être l’objectif russe depuis le début : « Ce changement dans l’approche de Trump permet le bombardement de tous les bastions banderistes avec diverses armes sans le tracas de négociations inutiles. L’accent devrait être mis sur la réalisation de la victoire là où c’est faisable — sur le champ de bataille, plutôt que dans les réunions. »
Les vraies raisons de l'échec diplomatique

Des positions irréconciliables
Pourquoi Budapest n’aura pas lieu ? Parce que les positions sont fondamentalement incompatibles. Reuters a révélé que la Russie a envoyé aux États-Unis au cours de la semaine un document privé appelé « non-paper » réaffirmant ses conditions établies pour un accord de paix. Ce document exigeait le contrôle total de la région contestée du Donbass oriental, ce qui rejette effectivement la proposition de Trump d’un cessez-le-feu qui gelerait les lignes de front à leurs positions actuelles. Contrôle total du Donbass. Pas négociable selon Moscou. Mais voilà le problème : l’Ukraine contrôle encore des parties importantes du Donbass, incluant Kramatorsk, Slovyansk et Pokrovsk — des villes facilement défendables que Moscou essaie de saisir depuis des années selon l’Atlantic Council. Céder ces villes signifierait abandonner des centaines de milliers d’Ukrainiens à l’occupation russe. Inacceptable pour Kiev. Inacceptable pour les Européens. Et maintenant, apparemment, inacceptable même pour Trump.
Le changement de ton de Washington est frappant. Trump a rencontré Zelensky à la Maison-Blanche le 18 octobre, juste après son appel avec Poutine. Selon Politico, il a refusé la demande de Zelensky pour des missiles Tomahawk américains pour frapper plus profondément en Russie, poussant plutôt l’Ukraine à céder plus de territoire pour un règlement de paix largement aux conditions de Poutine. Mais quelques jours plus tard, le ton change. Le 22 octobre, les officiels ukrainiens annoncent selon CNN qu’ils ont ciblé l’usine chimique de Briansk en Russie avec des missiles Storm Shadow à longue portée. Cette usine fabrique de la poudre à canon et d’autres explosifs. C’est une escalation majeure — et elle n’aurait pas pu se produire sans au moins un consentement tacite américain. Puis, le 23 octobre, Trump annonce de nouvelles sanctions massives contre Lukoil et Rosneft, les deux plus grands géants pétroliers russes. Interrogé sur le timing, Trump répond simplement selon CNBC : « J’ai juste senti que c’était le bon moment ; nous avons assez attendu. »
L’Europe pousse Washington vers la fermeté
Ce qui a changé ? L’Europe. Le 21 octobre, huit leaders européens et hauts responsables de l’Union européenne ont publié une déclaration conjointe selon PBS, exprimant leur soutien à la position de Trump selon laquelle « la ligne de contact actuelle devrait être le point de départ des négociations » et que la pression sur la Russie doit s’intensifier. Ils ont également déclaré leur intention de procéder avec des plans pour utiliser les vastes avoirs gelés de Moscou à l’étranger pour aider Kiev dans ses efforts pour l’emporter dans la guerre. C’est un front uni européen qui dit à Trump : pas de capitulation ukrainienne. Pas de deal avec Poutine aux dépens de Kiev. Pas d’abandon de l’Ukraine. Et ça fonctionne. Trump, qui déteste être vu comme faible, qui vient de vivre un échec cuisant à Alaska, qui réalise que Poutine le manipule depuis des mois, bascule. Il annule Budapest. Il sanctionne les pétroliers russes. Il durcit le ton.
La BBC note que la décision de Trump d’annuler ses discussions avec Poutine et d’imposer des sanctions pétrolières ne sera pas bien accueillie à Moscou. Un euphémisme monumental. CNBC rapporte qu’il y avait un « silence de pierre » à Moscou le jeudi 23 octobre, un jour après que Trump ait signalé qu’il avait perdu patience avec Poutine. Les médias d’État russes — TASS, Radio Sputnik, RIA Novosti — ont à peine reconnu la critique ou l’annulation de la réunion dans leur couverture. C’est révélateur. Quand le Kremlin ne sait pas quoi dire, il ne dit rien. Le silence comme aveu d’impuissance. Parce que quoi dire ? Que Trump les a abandonnés ? Que les sanctions pétrolières vont faire mal ? Que Budapest était leur dernière chance d’éviter une escalation ? Impossible. Alors Peskov sort sa phrase magique : « Il est difficile de perturber quelque chose qui n’a pas été convenu. » Sauvez les apparences. Prétendez que rien ne s’est passé. Continuez comme si de rien n’était. Sauf que tout le monde sait que c’est une débâcle.
Les conséquences de cet échec diplomatique
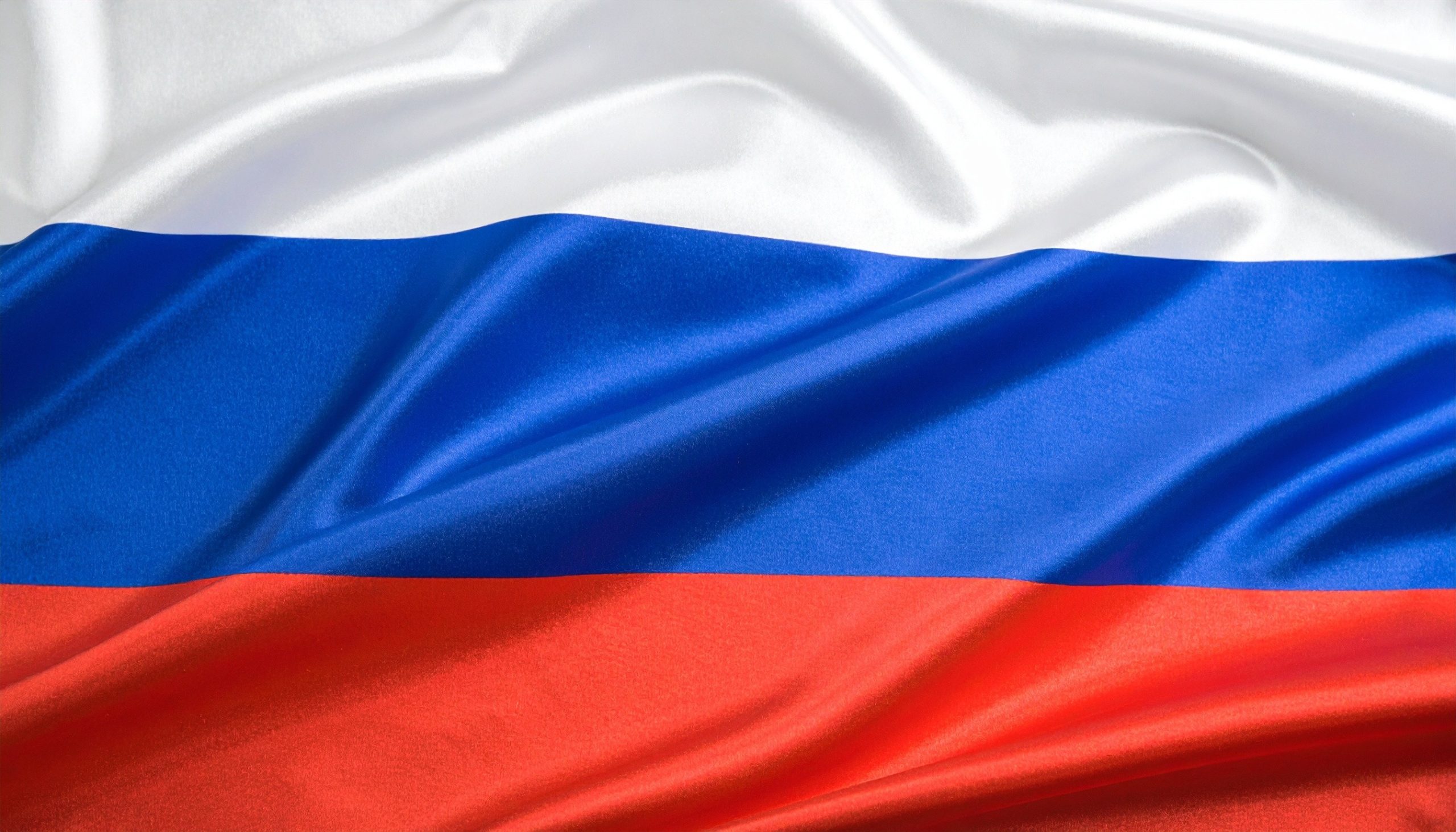
La guerre va s’intensifier
Que se passe-t-il maintenant ? La guerre continue. S’intensifie même. Medvedev l’a dit clairement dans son message Telegram : puisque les négociations sont inutiles, concentrons-nous sur la victoire sur le champ de bataille. La Russie a lancé des attaques massives sur l’infrastructure électrique ukrainienne ces dernières semaines selon CNN, plongeant des parties du pays dans l’obscurité alors que les températures chutent. Zelensky a déclaré qu’il y a 203 installations en Ukraine qui doivent être protégées avec des systèmes de défense aérienne, dont la plupart concernent l’électricité, le gaz et l’eau. Deux cent trois cibles critiques. Et pas assez de systèmes pour toutes les protéger. L’hiver approche. Moscou veut rendre la vie insupportable pour les Ukrainiens. Les forcer à se soumettre par le froid, la faim, l’épuisement. C’est une guerre d’usure contre les civils. Un crime de guerre permanent.
Côté ukrainien, les frappes en profondeur en Russie vont continuer. L’usine de Briansk n’est que le début. Zelensky l’a martelé à NBC News : « Plus les capacités à longue portée de l’Ukraine seront étendues, plus la Russie sera encline à conclure le conflit. » Frapper les raffineries. Les dépôts d’armes. Les usines chimiques. Les nœuds logistiques. Rendre la guerre coûteuse pour Moscou. C’est la seule stratégie qui fonctionne. Les sanctions aussi commencent à mordre sérieusement. Lukoil et Rosneft représentent une part massive de la production pétrolière russe. Les couper du système financier international va étrangler l’économie russe. Combien de temps Poutine peut-il tenir sans revenus pétroliers ? C’est la question que tout le monde se pose au Kremlin en ce moment. Et la réponse les terrifie probablement.
Trump face à son échec
Pour Trump, c’est un moment de vérité douloureux. Il avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine « en vingt-quatre heures. » Il avait vanté sa relation personnelle avec Poutine. Il avait présenté sa diplomatie directe comme la solution. Six mois plus tard ? Rien. Pire que rien — il s’est fait manipuler. Alaska était un piège. Budapest aurait été un autre piège. Et maintenant, Trump le réalise. D’où sa frustration visible. « Chaque conversation que j’ai avec Vladimir est productive, pourtant elles ne mènent nulle part. » C’est l’aveu d’un homme qui comprend enfin qu’il s’est fait avoir. Poutine n’a jamais voulu la paix. Il voulait du temps. Du temps pour consolider ses gains. Du temps pour que l’Occident se lasse. Du temps pour que l’Ukraine s’affaiblisse. Et Trump lui a donné ce temps en croyant naïvement que la diplomatie personnelle suffirait.
Maintenant, Washington bascule vers une approche plus dure. Les sanctions. Le soutien militaire renforcé à l’Ukraine. La coordination avec l’Europe. C’est ce qu’aurait dû être la politique depuis le début. Moskovsky Komsomolets, cité par la BBC, avait écrit avant l’annulation de Budapest : « Dans le jeu de Trump au tir à la corde, il mène à nouveau. Dans les semaines précédant la réunion de Budapest, Trump sera tiré dans la direction opposée et visitera l’Europe. Poutine le ramènera de notre côté à nouveau. » Tiré d’un côté, tiré de l’autre. Mais cette fois, Trump semble avoir choisi son camp. Pas celui de Poutine. Celui de l’Europe et de l’Ukraine. Est-ce définitif ? Rien n’est jamais définitif avec Trump. Mais pour l’instant, Budapest est mort. Et avec lui, l’illusion que Poutine négocie de bonne foi.
Conclusion
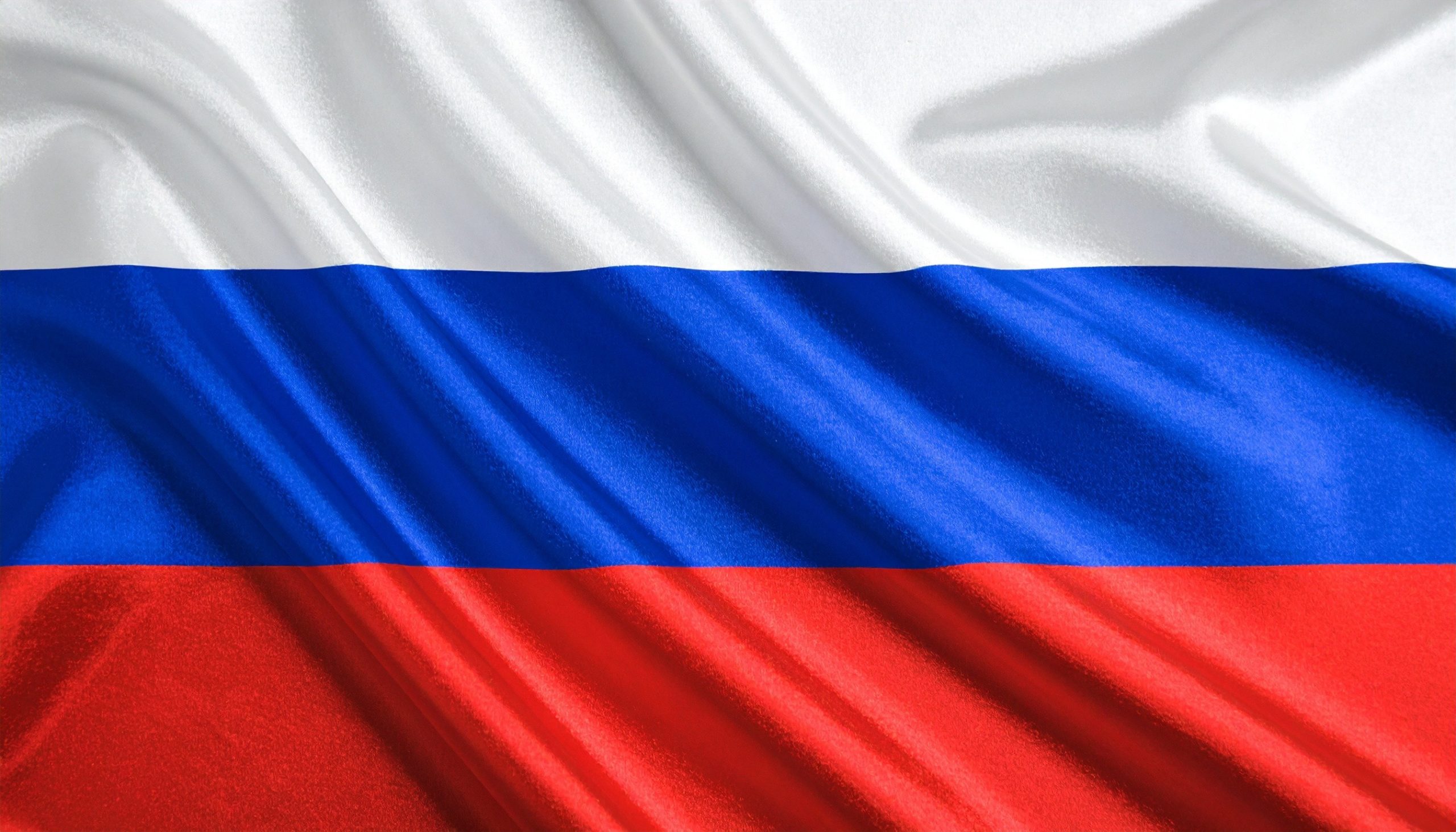
Revenons à la phrase de Peskov. « Il est difficile de perturber quelque chose qui n’a pas été convenu. » C’est du génie orwellien. Réécrire l’histoire en temps réel. Nier l’évidence. Prétendre que l’échec n’existe pas parce que le projet n’a jamais existé. Sauf que tout le monde sait. Trump avait annoncé Budapest. Les médias russes s’en délectaient. Lavrov et Rubio devaient se rencontrer d’abord. Et puis tout s’est effondré. Parce que Moscou refuse un cessez-le-feu. Parce que Moscou exige la capitulation ukrainienne. Parce que Moscou pense encore pouvoir gagner sur le champ de bataille. Peskov a ajouté ce 22 octobre : « Ni le président Trump ni le président Poutine ne souhaitent gaspiller du temps. » Gaspiller du temps. Exactement ce qu’ils ont fait pendant six mois. Des appels téléphoniques interminables. Un sommet en Alaska qui n’a rien donné. Des promesses vides. Et pendant ce temps, des Ukrainiens meurent. Six la nuit du 21 au 22 octobre selon NBC News. Combien d’autres depuis août ? Combien d’autres avant que Moscou accepte enfin que cette guerre est perdue d’avance ? Dmitry Medvedev a peut-être révélé la vraie pensée du Kremlin : oubliez les négociations inutiles, concentrez-vous sur la victoire militaire. Sauf qu’il n’y aura pas de victoire militaire. Pas avec les sanctions qui étranglent l’économie russe. Pas avec l’Ukraine qui frappe en profondeur sur le territoire russe. Pas avec l’Europe et l’Amérique enfin unies contre Moscou. Budapest n’aura pas lieu. Pas maintenant. Probablement jamais. Et peut-être que c’est mieux ainsi. Parce que négocier avec quelqu’un qui bombarde des civils pendant qu’il parle de paix, c’est perdre son temps. Trump l’a compris. Tardivement. Mais il l’a compris. Maintenant, place aux actes. Sanctions. Armes pour l’Ukraine. Pression maximale. C’est la seule langue que le Kremlin comprend. Le reste n’est que du théâtre. Et le rideau vient de tomber sur la farce de Budapest.