L’aveu public de Stephen Miran
Le 15 octobre 2025, lors du forum CNBC Invest, Stephen Miran a prononcé les mots que l’administration Trump redoutait par-dessus tout. Face à un parterre d’investisseurs et d’analystes médusés, le gouverneur de la Réserve fédérale a déclaré sans détour que l’économie américaine était plus faible qu’au cours de l’année précédente. Pas une simple fluctuation. Pas un ralentissement temporaire. Non. Un affaiblissement réel, mesurable, indéniable. Miran a pointé du doigt la détérioration continue du marché du travail durant le premier semestre de l’année, contredisant directement les déclarations triomphales de Trump selon lesquelles l’Amérique jouissait de la meilleure économie de son histoire.
Mais Miran n’en est pas resté là. Il a enfoncé le clou en identifiant les coupables : les incertitudes politiques créées par l’administration elle-même. Les modifications fiscales chaotiques, les guerres commerciales mal gérées, les politiques tarifaires agressives qui ont fait exploser les prix pour les consommateurs. « L’économie n’était pas aussi robuste au premier semestre de l’année comparé à la même période l’année dernière », a-t-il affirmé, selon les rapports du Daily Beast. Chaque mot pesait des tonnes. Chaque syllabe était un coup de poignard dans le dos de Trump. Et Miran savait exactement ce qu’il faisait. Il n’a pas directement nommé le président, mais l’implication était cristalline : les politiques de Trump ont saboté la reprise économique.
Les chiffres qui ne mentent pas
Les données économiques racontent une histoire que la Maison-Blanche tente désespérément d’enterrer. En septembre 2025, une révision catastrophique des chiffres de l’emploi a révélé que les États-Unis avaient créé 911 000 emplois de moins que prévu entre mars 2024 et mars 2025. Cette correction massive — la plus importante depuis des décennies — a provoqué un séisme dans les milieux financiers. Trump a immédiatement blâmé Jerome Powell et la Fed, accusant le président de la banque centrale d’incompétence et de s’appuyer sur des données obsolètes. Mais cette fois, il ne pouvait pas aussi facilement écarter Miran. Parce que Miran était son homme. Son choix. Son représentant au sein de l’institution qu’il déteste le plus.
Les révisions à la baisse ont touché tous les secteurs de l’économie. Les services de loisirs et d’hôtellerie ont perdu 15 000 emplois par mois de plus que rapporté initialement. Les services professionnels et commerciaux ont chuté de 13 000 emplois mensuels supplémentaires. Le commerce de détail a perdu 10 000 postes de plus que prévu. Comme l’a souligné Bradley Saunders, économiste pour Capital Economics basé à Londres, ces révisions généralisées dans les services — le dernier bastion de la croissance de l’emploi — n’augurent rien de bon pour la santé globale du marché du travail. L’économie américaine ne ralentit pas. Elle recule. Et les architectes de cette débâcle refusent de l’admettre.
La détérioration du marché du travail
Miran a également mis en lumière un aspect particulièrement préoccupant : la dégradation continue du marché de l’emploi. « Le marché du travail a continué de se détériorer au premier semestre de l’année », a-t-il déclaré lors de son intervention. Il a attribué une partie de ce déclin aux incertitudes entourant les politiques gouvernementales, notamment ce qu’il a qualifié de plus grande augmentation fiscale de l’histoire. Cette déclaration explosive fait référence aux conséquences imprévues des politiques tarifaires de Trump, qui ont essentiellement fonctionné comme une taxe déguisée sur les consommateurs et les entreprises américaines. Les compagnies ont reporté leurs investissements en attendant de voir comment les choses évolueraient. Résultat : stagnation, licenciements, incertitude généralisée.
Les données du Bureau of Labor Statistics confirment cette tendance alarmante. Le taux de chômage, bien que toujours relativement bas à 4,3 % en août 2025, masque une réalité beaucoup plus sombre. Les demandeurs d’emploi restent sans travail pendant des périodes de plus en plus longues. Il y a maintenant plus de chercheurs d’emploi que de postes disponibles. Les embauches ont ralenti de manière spectaculaire. En juillet 2025, seulement 73 000 emplois ont été créés, un chiffre catastrophique qui a conduit à des révisions à la baisse encore plus sévères pour mai et juin, ramenées respectivement à 14 000 et 19 000 emplois. L’hémorragie est constante, progressive, inéluctable. Et personne à la Maison-Blanche ne semble avoir de plan pour l’arrêter.
L'offensive tous azimuts contre la Fed
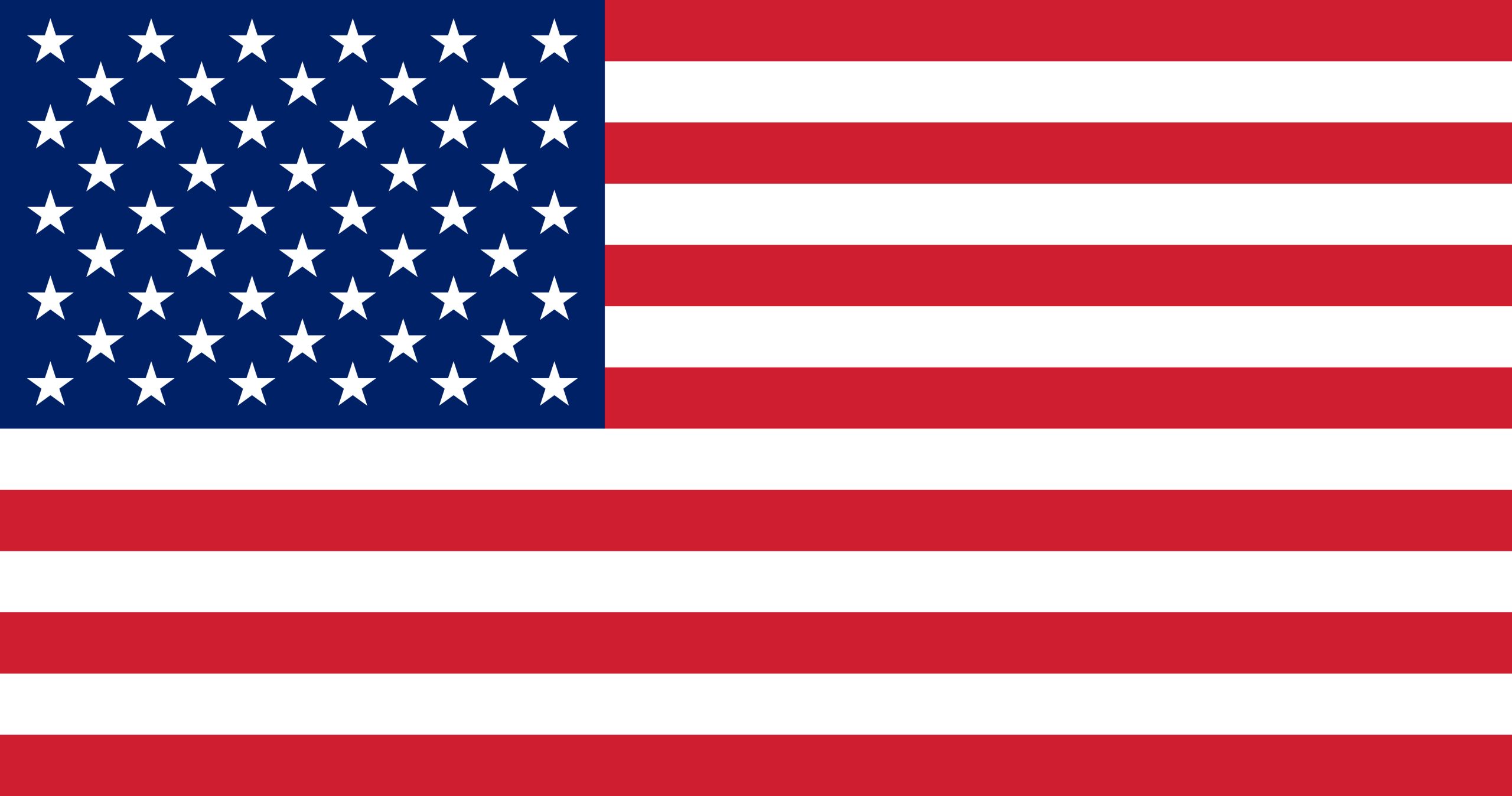
Trump contre Jerome Powell : une guerre ouverte
La relation entre Donald Trump et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale qu’il a lui-même nommé en 2018, s’est transformée en une guerre ouverte qui menace l’indépendance même de l’institution monétaire la plus puissante au monde. Depuis des mois, Trump martèle inlassablement le même message : Powell est incompétent, la Fed est en retard, les taux d’intérêt doivent être réduits immédiatement et massivement. Le président exige une baisse de trois points de pourcentage du taux directeur, une réduction si brutale qu’elle pourrait déclencher une nouvelle vague d’inflation incontrôlable. Mais Trump s’en moque. Il veut des résultats immédiats, peu importe les conséquences à long terme.
En juillet 2025, après que Powell et la Fed eurent refusé de baisser les taux lors de leur réunion mensuelle, Trump a explosé publiquement. Il a qualifié Powell de « désastre » et a appelé les autres gouverneurs de la Fed à prendre le contrôle et à passer outre les décisions du président. Cette attaque frontale contre l’indépendance de la banque centrale a choqué les observateurs du monde entier. Trump a même salué les votes dissidents de Michelle Bowman et Christopher Waller — deux gouverneurs qu’il avait lui-même nommés — qui plaidaient pour des baisses de taux plus agressives. Le président a qualifié leurs dissensions de « fortes » et les a encouragés à défier Powell ouvertement. L’institution centenaire qui est censée opérer à l’abri des pressions politiques était ouvertement instrumentalisée pour servir les intérêts électoraux du président.
La tentative de licenciement de Lisa Cook
Mais l’offensive de Trump contre la Fed ne s’est pas limitée aux attaques verbales contre Powell. En août 2025, le président a franchi une ligne rouge que personne n’avait jamais osé franchir en 112 ans d’histoire de la Réserve fédérale : il a tenté de licencier un gouverneur en exercice. La cible ? Lisa Cook, la première femme noire à siéger au conseil des gouverneurs, nommée par Joe Biden. Trump l’a accusée de fraude hypothécaire, affirmant qu’elle avait déclaré deux résidences principales sur ses demandes de prêt — une accusation que Cook nie catégoriquement et qui, selon elle, n’est qu’un prétexte pour la virer en raison de ses positions sur la politique monétaire.
L’accusation provenait de Bill Pulte, le directeur de la Federal Housing Finance Agency nommé par Trump, qui a affirmé avoir mené une enquête sur Cook et avoir transmis le dossier au Département de la Justice avec une recommandation d’enquête criminelle. Pulte, qui avait précédemment rédigé une lettre suggérant que Trump licencie Powell, a également porté des accusations similaires contre le sénateur démocrate Adam Schiff et la procureure générale de New York Letitia James. Le schéma est clair : utiliser les leviers du gouvernement pour attaquer et neutraliser les opposants politiques. Cook a immédiatement poursuivi Trump en justice, arguant que sa révocation était illégale et menaçait l’indépendance de la Fed. Un juge fédéral lui a donné raison, bloquant temporairement son licenciement.
La Cour suprême intervient
Le 1er octobre 2025, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui a temporairement sauvé Lisa Cook et, par extension, l’indépendance de la Réserve fédérale. Dans une ordonnance non signée, la plus haute juridiction du pays a rejeté la demande de Trump de retirer immédiatement Cook de ses fonctions et a annoncé qu’elle entendrait les arguments concernant sa révocation en janvier 2026. Cette décision permet à Cook de participer aux deux dernières réunions de la Fed en 2025, y compris celle sur les taux d’intérêt prévue pour octobre. C’est une victoire temporaire, mais symboliquement cruciale, pour ceux qui défendent l’autonomie de la banque centrale face aux ingérences présidentielles.
Le juge de district Jia Cobb avait précédemment statué que la tentative de Trump de révoquer Cook violait probablement le Federal Reserve Act, qui stipule qu’un gouverneur ne peut être révoqué que « pour cause », un terme qui n’a jamais été clairement défini et qui n’avait jamais été testé devant les tribunaux en 112 ans d’existence de l’institution. L’avocat de Cook, Abbe Lowell, a déclaré que la décision de la Cour suprême « permet correctement au gouverneur Cook de maintenir sa position au conseil de la Réserve fédérale ». De son côté, la Maison-Blanche a affirmé être impatiente que l’affaire soit « pleinement examinée par la Cour suprême ». La bataille juridique ne fait que commencer, et son issue pourrait redéfinir fondamentalement le rapport de force entre le pouvoir exécutif et l’indépendance monétaire.
Le shutdown gouvernemental et les licenciements massifs

La paralysie du gouvernement fédéral
Pendant que Trump livrait sa guerre contre la Fed, une autre crise — tout aussi grave, sinon plus — se déroulait simultanément : la paralysie totale du gouvernement fédéral. Le 1er octobre 2025, faute d’accord budgétaire entre l’administration et le Congrès, le gouvernement américain est entré en shutdown, une fermeture qui a rapidement pris une tournure particulièrement sinistre. Car cette fois, Trump n’a pas simplement utilisé le shutdown comme levier de négociation. Il l’a transformé en arme de destruction massive contre la fonction publique fédérale. Dès le début de la crise, l’administration a clairement annoncé son intention : profiter de la paralysie pour licencier massivement des employés fédéraux jugés « non alignés » avec les priorités présidentielles.
Le 24 septembre 2025, avant même le début officiel du shutdown, l’Office of Management and Budget (OMB) a publié un mémo glaçant qui instruisait les agences fédérales de préparer des licenciements massifs — des Reductions in Force (RIF) — dès que le financement viendrait à manquer. Le mémo précisait trois conditions pour cibler des employés : leur programme perdait son financement discrétionnaire le 1er octobre, aucune source alternative de financement n’était disponible, et — voici le critère le plus révélateur — le programme « n’était pas cohérent avec les priorités du président ». Autrement dit, l’administration Trump s’octroyait le droit de licencier des fonctionnaires non pas en fonction de leur performance ou de la nécessité budgétaire, mais en fonction de leur alignement idéologique supposé.
Plus de 4 000 employés sacrifiés
Le 10 octobre 2025, Russell Vought, directeur de l’OMB, a tweeté trois mots qui ont glacé le sang de milliers de familles américaines : « The RIFs have begun » — les licenciements ont commencé. Dans les heures qui ont suivi, au moins 4 200 travailleurs de sept agences fédérales différentes ont reçu des avis de licenciement. Les départements du Trésor et de la Santé ont été les plus durement touchés, avec plus de 1 100 licenciements chacun. Mais les coupes ont également frappé le Département de la Sécurité intérieure, l’Agence de protection de l’environnement, le Département de l’Éducation, celui de l’Énergie, et celui du Logement et du Développement urbain. Des travailleurs de l’IRS, des experts en cybersécurité, des spécialistes de l’éducation spécialisée, des gestionnaires de subventions au logement — des milliers de professionnels compétents jetés à la rue en pleine crise nationale.
Les témoignages des employés licenciés ont rapidement envahi les réseaux sociaux. Certains ont partagé leurs lettres de licenciement, exprimant leur incrédulité face à cette décision prise en plein shutdown, alors que le pays avait désespérément besoin de leurs compétences pour maintenir les services essentiels. Les syndicats de fonctionnaires — l’American Federation of Government Employees et l’American Federation of State, County and Municipal Employees — ont immédiatement déposé une plainte devant un tribunal fédéral de San Francisco, contestant la légalité des licenciements. Une audience pour examiner leur demande d’injonction était prévue pour le mercredi suivant. Mais pour les milliers de travailleurs déjà licenciés, le mal était fait. Leurs carrières détruites, leurs revenus coupés, leurs familles plongées dans l’incertitude.
Trump assume et accuse les démocrates
Confronté aux critiques sur ces licenciements massifs, Donald Trump n’a montré aucun remords. Bien au contraire. Interrogé par des journalistes sur le nombre de personnes qui perdraient leur emploi, le président a répondu avec un sourire narquois : « Ce sera beaucoup ». Il a ensuite qualifié ces licenciements de « licenciements démocrates », affirmant que toute personne mise à pied l’était « à cause des démocrates ». Cette rhétorique — aussi absurde soit-elle — servait un objectif politique clair : rejeter la responsabilité de la crise sur l’opposition, même si c’était son administration qui avait ordonné les licenciements et refusé tout compromis budgétaire avec le Congrès.
Le vice-président JD Vance a enfoncé le clou lors d’une apparition à l’émission Meet the Press de NBC. Il a déclaré que les licenciements pendant le shutdown étaient « essentiels » pour maintenir les services fédéraux prioritaires, y compris le programme WIC et la rémunération du personnel militaire. « Nous devons laisser partir certains travailleurs fédéraux pendant le shutdown pour fournir les services essentiels à la population », a-t-il affirmé, tout en attribuant la faute aux démocrates. Cette logique tordue — licencier des milliers de personnes pour mieux servir le public — a laissé de nombreux observateurs perplexes. En réalité, les licenciements n’ont fait qu’aggraver la crise, rendant le gouvernement encore moins capable de répondre aux besoins de la population.
L'impact dévastateur sur l'économie et les services publics

Les données économiques paralysées
Le shutdown n’a pas seulement détruit des milliers d’emplois et paralysé les services gouvernementaux. Il a également créé un vide informationnel catastrophique au moment même où l’économie américaine vacillait et où la Réserve fédérale avait désespérément besoin de données fiables pour prendre ses décisions sur les taux d’intérêt. La fermeture du gouvernement a interrompu la publication de la plupart des statistiques économiques officielles sur lesquelles la Fed s’appuie pour évaluer la santé de l’économie. Le Bureau of Labor Statistics, le Department of Commerce, et d’autres agences clés ont cessé de publier leurs rapports mensuels. L’Amérique naviguait à l’aveugle dans une tempête économique de plus en plus violente.
Jerome Powell a reconnu ce problème lors d’un discours le 14 octobre 2025 devant la National Association for Business Economics. Il a déclaré que la Fed examinait « une large variété de données du secteur public et privé qui restaient disponibles » et qu’elle s’appuyait également sur « un réseau national de contacts à travers les banques de réserve qui fournissent des informations précieuses ». Mais ces sources alternatives — aussi utiles soient-elles — ne peuvent pas remplacer les données officielles complètes et rigoureuses produites par les agences gouvernementales. Powell a ajouté, avec une prudence mesurée, qu’« en se basant sur les données dont nous disposons, il est juste de dire que les perspectives pour l’emploi ne semblent pas avoir beaucoup changé depuis la réunion de septembre ». Une manière diplomatique de dire : nous volons à l’aveugle et nous espérons ne pas nous écraser.
Les programmes sociaux menacés
Au-delà des statistiques manquantes, le shutdown a eu des conséquences humaines immédiates et dévastatrices. Le 24 octobre 2025, l’administration Trump a annoncé qu’elle refusait d’utiliser environ 5 milliards de dollars de fonds de contingence pour maintenir l’aide alimentaire du programme SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, anciennement connu sous le nom de « food stamps »). Cette décision signifiait que 42 millions d’Américains — dont des millions d’enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées — ne recevraient pas leurs prestations alimentaires en novembre, à moins que le Congrès n’intervienne. Quarante-deux millions de personnes. Laissées sans aide alimentaire. En pleine crise économique. Parce que l’administration refusait d’utiliser des fonds spécifiquement prévus pour ce genre d’urgence.
Le programme WIC (Women, Infants, and Children), qui fournit une nutrition supplémentaire aux femmes enceintes, aux nouvelles mères et aux jeunes enfants, était également menacé. Des millions de familles vulnérables se sont retrouvées dans l’incertitude, ne sachant pas si elles pourraient nourrir leurs enfants le mois suivant. Les banques alimentaires à travers le pays ont signalé une augmentation massive de la demande, alors même que leurs propres ressources s’épuisaient rapidement. Les hôpitaux ont rapporté une hausse des cas de malnutrition infantile. Les écoles ont dû puiser dans leurs budgets déjà limités pour fournir des repas gratuits aux élèves dont les familles avaient perdu l’accès aux programmes fédéraux. Le pays le plus riche du monde laissait ses citoyens les plus vulnérables mourir de faim pour des raisons purement politiques.
Les travailleurs fédéraux privés de salaire
Le 24 octobre 2025, des centaines de milliers d’employés fédéraux ont manqué leur chèque de paie pour la première fois depuis le début du shutdown. Pour beaucoup, ce n’était pas simplement un inconvénient temporaire — c’était une catastrophe financière. Environ 60 % des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre, sans épargne suffisante pour couvrir une urgence de 400 dollars. Pour ces travailleurs, manquer un seul salaire signifiait ne pas pouvoir payer le loyer, l’hypothèque, les factures d’électricité, les frais de garde d’enfants. Certains ont dû choisir entre acheter de la nourriture et payer leurs médicaments. D’autres ont été expulsés de leur logement. Les files d’attente aux banques alimentaires s’allongeaient chaque jour.
Les témoignages étaient déchirants. Une employée du Department of Education à Denver a raconté comment elle avait dû retirer ses enfants de la garderie parce qu’elle ne pouvait plus payer les frais. Un agent de l’IRS à Atlanta a expliqué qu’il avait vendu sa voiture pour couvrir ses factures médicales. Une cyberspécialiste du Department of Homeland Security à Washington DC a décrit comment elle vivait dans sa voiture après avoir été expulsée de son appartement. Ces histoires — et des milliers d’autres — révélaient la cruauté systémique d’une administration qui prétendait défendre les travailleurs américains tout en détruisant délibérément leurs vies pour marquer des points politiques. Et le pire, c’est que l’administration savait exactement ce qu’elle faisait. Elle savait et elle s’en fichait.
Les contradictions économiques de l'administration

L’inflation qui refuse de reculer
Pendant que Trump proclamait avoir « vaincu l’inflation », la réalité sur le terrain racontait une histoire radicalement différente. En octobre 2025, l’indice des prix à la consommation préféré par la Fed affichait une hausse annuelle de 2,6 %, nettement au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale. Mais ce chiffre global masquait une situation encore plus grave pour les familles ordinaires. Les prix de l’alimentation avaient augmenté beaucoup plus rapidement que l’inflation générale, en partie à cause des tarifs douaniers massifs imposés par Trump sur les importations. Les données du Department of Commerce — avant que le shutdown n’interrompe leur publication — montraient que les tarifs avaient déjà entraîné des augmentations de prix significatives dans plusieurs secteurs clés.
Une enquête menée en septembre 2025 par la National Federation of Independent Business a révélé qu’un nombre croissant de petites entreprises anticipaient de nouvelles hausses de prix dans les mois à venir. Elles citaient directement les tarifs douaniers comme facteur principal, ainsi que l’incertitude créée par les changements constants de politique commerciale de l’administration. Les consommateurs ressentaient cette pression quotidiennement. Le prix du lait, du pain, des œufs — les produits de base que les familles achètent chaque semaine — continuait d’augmenter malgré les assurances répétées du président que l’inflation était vaincue. Les Américains savaient que quelque chose ne tournait pas rond. Leurs portefeuilles étaient vides, mais Trump leur disait que l’économie n’avait jamais été aussi florissante. Le décalage entre rhétorique et réalité devenait insoutenable.
Les tarifs douaniers comme taxe cachée
Stephen Miran lui-même a fait référence à ce problème lors de son intervention d’octobre, mentionnant ce qu’il a appelé « la plus grande augmentation fiscale de l’histoire ». Il ne parlait pas d’une hausse officielle des impôts votée par le Congrès. Il parlait des tarifs douaniers de Trump, qui fonctionnent essentiellement comme une taxe sur les consommateurs américains. Contrairement à ce que le président affirmait constamment, ce ne sont pas les pays étrangers qui paient les tarifs. Ce sont les importateurs américains qui les paient, et ces coûts sont ensuite répercutés sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés. Les études économiques l’ont confirmé à maintes reprises : les tarifs de Trump ont coûté aux ménages américains des milliards de dollars en pouvoir d’achat perdu.
Les entreprises américaines ont également souffert. Beaucoup dépendaient de composants importés pour leurs produits manufacturés. Lorsque Trump a imposé des tarifs de 25 % ou plus sur certaines importations chinoises, européennes et mexicaines, les coûts de production ont explosé. Certaines entreprises ont tenté d’absorber ces coûts pour rester compétitives, ce qui a réduit leurs marges bénéficiaires et conduit à des licenciements. D’autres ont simplement augmenté leurs prix, transférant le fardeau aux consommateurs déjà pressurés. D’autres encore ont reporté ou annulé des investissements prévus, attendant de voir si les politiques commerciales se stabiliseraient. Comme Miran l’a souligné, cette incertitude a contribué directement à la détérioration du marché du travail. Les politiques de Trump, censées « rendre l’Amérique grande à nouveau », étaient en train de saboter la reprise économique.
Les pressions politiques sur la politique monétaire
La Réserve fédérale se trouvait dans une position impossible. D’un côté, elle devait lutter contre une inflation persistante alimentée en partie par les tarifs de Trump. De l’autre, elle devait soutenir un marché du travail en détérioration rapide. Jerome Powell a décrit ce dilemme lors de son discours du 14 octobre : « Il n’y a pas de chemin sans risque pour nous alors que nous naviguons la tension entre nos objectifs d’emploi et d’inflation ». Les politiques commerciales, migratoires et fiscales radicales de Trump avaient placé la banque centrale dans une situation inédite depuis sa création il y a plus d’un siècle. Comment peut-on baisser les taux pour soutenir l’emploi sans déclencher une nouvelle flambée inflationniste ? Comment peut-on maintenir les taux élevés pour contrôler l’inflation sans provoquer une récession et des licenciements massifs ?
Et pendant que la Fed tentait de résoudre cette équation impossible, Trump continuait de la bombarder d’attaques publiques, exigeant des baisses de taux massives et immédiates. Il avait même évoqué publiquement l’idée de licencier Jerome Powell — une action que la Cour suprême avait suggéré dans une décision de mai 2025 qu’il ne pouvait probablement pas entreprendre pour de simples désaccords politiques. La Maison-Blanche avait alors lancé une enquête pour déterminer si Powell pouvait être licencié « pour cause » en raison de dépassements de coûts dans les projets de rénovation de la Fed, qui s’élevaient à 2,5 milliards de dollars. C’était une justification risible, mais elle révélait jusqu’où Trump était prêt à aller pour soumettre une institution censée être indépendante. Le mandat de Powell en tant que président prend fin en mai 2026, moment où Trump pourra nommer son propre candidat confirmé par le Sénat.
Le gel des embauches et la réduction de la fonction publique

Le gel prolongé des embauches fédérales
Le 20 janvier 2025, le jour même de son inauguration pour un second mandat, Donald Trump a signé un mémorandum présidentiel instituant un gel immédiat des embauches de tous les employés civils fédéraux. Cette mesure, qui rappelait une politique similaire mise en œuvre au début de son premier mandat en 2017, interdisait de pourvoir tout poste nouveau ou vacant après midi ce jour-là. Le mémorandum prévoyait certaines exceptions pour le personnel militaire, l’application des lois sur l’immigration, la sécurité nationale et la sécurité publique, ainsi que pour d’autres exemptions à déterminer par le directeur de l’Office of Personnel Management. Mais pour la grande majorité des agences fédérales, les embauches étaient gelées. Indéfiniment.
Le gel initial devait expirer après 90 jours, le temps pour l’Office of Management and Budget de publier un plan de réduction globale de la main-d’œuvre fédérale. Mais Trump l’a prolongé une première fois le 17 avril 2025 pour trois mois supplémentaires jusqu’au 15 juillet. Puis il l’a prolongé une deuxième fois le 8 juillet 2025 jusqu’au 15 octobre. Et le 14 octobre, il a signé un nouvel ordre exécutif qui prolongeait effectivement le gel indéfiniment, tout en renforçant le contrôle politique sur toute embauche future. Le nouvel ordre stipulait que « aucun employé civil fédéral ne peut être embauché et aucun poste ne peut être créé » sauf autorisation spécifique conforme à l’ordre ou exigée par la loi applicable.
Le contrôle politique sur les embauches
L’ordre exécutif d’octobre 2025 a introduit une dimension particulièrement inquiétante : il exigeait que toutes les embauches fédérales futures soient conformes au « Merit Hiring Plan » émis par l’Assistant du Président pour la Politique Intérieure et le Directeur de l’OMB. En d’autres termes, les nominations politiques de Trump auraient un contrôle direct et total sur qui pouvait être embauché dans la fonction publique fédérale. Comme l’a observé Donald Kettl, expert en gouvernance publique cité par le New York Times, « cela représente une escalade considérable de la supervision politique sur les embauches. Cela impose des restrictions plus strictes sur les embauches que jamais auparavant, exigeant l’approbation des niveaux supérieurs pour chaque poste et introduisant la possibilité d’un filtre partisan pour chaque employé ».
Tim Kaufman, représentant de l’American Federation of Government Employees — le syndicat des travailleurs fédéraux — a commenté : « Il semble que l’ordre indique que bien qu’il y ait un gel des embauches pour les postes concurrentiels réguliers, les nominations politiques de chaque agence peuvent embaucher des personnes qui s’alignent idéologiquement avec l’agenda politique de Donald Trump ». En d’autres termes, le gel ne s’appliquait pas vraiment à tout le monde. Les loyalistes de Trump pouvaient toujours être embauchés. Mais les professionnels de carrière, les experts techniques, les spécialistes qualifiés — eux étaient bloqués. L’objectif n’était pas de réduire la taille du gouvernement. C’était de le transformer en une machine politique au service exclusif du président. De remplacer la compétence par la loyauté. L’expertise par l’obéissance.
Les conséquences sur les services publics
Les employés du gouvernement fédéral ont rapporté des difficultés considérables à remplir leurs responsabilités en raison des gels d’embauche, qui ont laissé des postes essentiels vacants. Beaucoup de ces vacances existaient avant l’administration Trump, et les agences fédérales avaient prévu de les pourvoir en 2025. Mais le gel prolongé — maintenant dans sa dixième mois — avait créé des pénuries critiques de personnel dans des domaines vitaux. Les inspecteurs de sécurité alimentaire, les contrôleurs aériens, les scientifiques de recherche médicale, les agents de protection de l’environnement, les auditeurs fiscaux — tous ces postes et bien d’autres restaient vacants alors que la charge de travail continuait d’augmenter. Les employés restants étaient submergés, épuisés, démoralisés.
Les retards se sont accumulés dans tous les domaines. Les demandes de prestations de la Sécurité sociale prenaient des mois à traiter. Les remboursements d’impôts étaient retardés. Les inspections de sécurité des aliments et des médicaments étaient reportées ou annulées. Les permis environnementaux restaient en attente. Les applications d’immigration s’accumulaient par millions. Le système de justice pénale fédéral était engorgé. Les parcs nationaux manquaient de gardes et de personnel d’entretien. Les laboratoires de recherche fédéraux perdaient des scientifiques de classe mondiale qui partaient vers le secteur privé ou l’étranger, frustrés par l’impossibilité d’embaucher des assistants ou de remplacer les collègues partis à la retraite. L’Amérique, la superpuissance mondiale, ne pouvait pas effectuer les fonctions gouvernementales de base parce que son président avait décidé d’affamer délibérément sa propre administration.
Les dissensions internes et les fissures dans l'administration

Le vote dissident de Stephen Miran
Le 16 septembre 2025, lors de sa toute première réunion en tant que gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran a fait quelque chose d’extraordinaire. Il a voté contre la décision de la majorité de ses collègues. Alors que Jerome Powell et dix autres membres du Federal Open Market Committee votaient pour une réduction modeste des taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage — marquant la première baisse de taux de l’année — Miran était le seul dissident, plaidant pour une réduction beaucoup plus agressive d’un demi-point. C’était un signal fort envoyé dès son premier jour : il n’était pas là pour suivre le consensus. Il était là pour pousser un agenda différent. Un agenda trumpiste.
Trois jours plus tard, lors d’un discours devant l’Economic Club of New York, Miran a défendu publiquement sa position dissidente. Il a déclaré que la politique monétaire actuelle était « très restrictive » et qu’elle posait « un risque matériel pour le mandat d’emploi de la Fed ». Il a affirmé que le taux des fonds fédéraux approprié devrait se situer autour de 2,5 % — près de deux points de pourcentage en dessous du taux actuel. Maintenir les taux d’intérêt à court terme environ deux points trop élevés, a-t-il averti, pourrait entraîner des licenciements inutiles et une hausse du chômage. Sa logique était claire : les changements économiques massifs mis en œuvre par Trump — en matière de fiscalité, de commerce et d’immigration — avaient effectivement abaissé le taux d’intérêt neutre, ce qui justifiait des baisses de taux beaucoup plus importantes pour maintenir la croissance.
Les tensions avec les autres gouverneurs
La position de Miran l’a immédiatement placé en opposition directe avec la majorité de ses collègues à la Fed, y compris Jerome Powell. Lors d’une interview avec CNBC le 19 septembre 2025 — sa première apparition publique depuis sa confirmation — Miran a minimisé les préoccupations concernant l’influence de Trump sur ses décisions, qualifiant ces inquiétudes de « stupides ». Il a révélé que Trump l’avait appelé le matin du 16 septembre pour le féliciter de sa nouvelle position, mais qu’ils n’avaient pas discuté du vote à venir. « Il ne m’a pas demandé de prendre des mesures spécifiques, et je n’ai pas promis d’entreprendre des actions particulières. J’ai basé mes décisions sur mes évaluations économiques, et j’ai l’intention de continuer à le faire », a-t-il affirmé.
Mais peu de gens étaient convaincus par ces assurances. Le timing de sa nomination — accélérée de manière inhabituelle par un Sénat contrôlé par les républicains — et ses positions qui s’alignaient parfaitement avec les demandes publiques de Trump pour des baisses de taux massives soulevaient inévitablement des questions sur son indépendance réelle. La tentative simultanée de Trump de licencier Lisa Cook renforçait les craintes que le président cherchait activement à remodeler le conseil des gouverneurs de la Fed pour le rendre plus docile et plus réactif à ses exigences politiques. Miran pouvait prétendre agir uniquement sur la base de son analyse économique, mais le contexte dans lequel il opérait racontait une histoire différente. Il était l’homme de Trump à la Fed. Et tout le monde le savait.
La critique subtile mais dévastatrice d’octobre
C’est pourquoi les commentaires de Miran lors du forum CNBC Invest d’octobre étaient si significatifs. Pour la première fois, il a publiquement reconnu ce que les données montraient depuis des mois : l’économie s’affaiblissait, le marché du travail se détériorait, et les politiques de l’administration Trump — son administration Trump — contribuaient au problème. Il n’a pas directement critiqué le président. Il a soigneusement évité d’attribuer la responsabilité de manière explicite. Mais en identifiant l’incertitude politique, les augmentations fiscales effectives dues aux tarifs, et les problèmes commerciaux comme facteurs clés du ralentissement économique, il pointait implicitement du doigt la Maison-Blanche. C’était une critique par omission. Une dissidence feutrée mais claire. Et venant de l’homme que Trump avait personnellement choisi pour le représenter à la Fed, elle avait un poids énorme.
On peut imaginer la rage de Trump en apprenant les commentaires de Miran. Après tout ce qu’il avait fait pour le mettre à ce poste. Après avoir accéléré sa confirmation. Après avoir compté sur lui pour être un allié fidèle dans sa guerre contre Powell. Et voilà que Miran osait suggérer — même subtilement — que les politiques présidentielles causaient des dommages économiques. C’était une trahison aux yeux de Trump. Pas aussi flagrante que celle de Powell, bien sûr. Mais une trahison quand même. Et Trump ne pardonne jamais les trahisons. La question maintenant est de savoir combien de temps Miran pourra maintenir cette position d’équilibriste précaire — reconnaître la réalité économique sans ouvertement défier son bienfaiteur politique. Et que se passera-t-il quand cet équilibre deviendra intenable ?
Conclusion

Nous voici donc, à la fin d’octobre 2025, au milieu d’une tempête qui ne cesse de s’intensifier. L’économie américaine vacille sous le poids des contradictions, des mensonges et de l’incompétence d’une administration qui refuse obstinément de reconnaître la réalité. Stephen Miran, l’homme que Trump avait choisi pour être son champion à la Réserve fédérale, a brisé le mur du silence et reconnu publiquement ce que des millions d’Américains vivent quotidiennement : l’économie s’affaiblit, les emplois disparaissent, l’incertitude paralyse les investissements, et les politiques présidentielles contribuent directement à cette détérioration. C’est un aveu dévastateur venant de l’intérieur même du cercle trumpiste. Une fissure dans le narratif soigneusement construit de la grandeur économique retrouvée.
Pendant ce temps, le gouvernement fédéral reste paralysé par un shutdown qui a déjà coûté leur emploi à plus de 4 000 travailleurs, laissé des centaines de milliers d’autres sans salaire, et menacé de priver 42 millions d’Américains d’aide alimentaire. La Réserve fédérale, l’institution censée protéger la stabilité économique à l’abri des pressions politiques, est assiégée de toutes parts — attaquée verbalement par Trump, juridiquement avec la tentative de licenciement de Lisa Cook, et structurellement avec le gel des embauches et les licenciements qui déciment la fonction publique. Les données économiques dont la Fed a besoin pour prendre des décisions éclairées ne sont plus publiées. L’Amérique navigue à l’aveugle dans une crise que ses propres dirigeants ont créée et qu’ils refusent d’admettre. L’inflation persiste. Le chômage augmente. Les familles souffrent. Et au sommet, on continue de prétendre que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Jusqu’à quand cette mascarade pourra-t-elle continuer ? Jusqu’où devrons-nous tomber avant que la vérité ne devienne impossible à ignorer ? Les semaines et mois à venir nous donneront la réponse. Et j’ai bien peur qu’elle ne soit pas celle que nous espérions.