La pression d’Epstein, une bombe à retardement
Trump face à l’affaire qui le hante
L’affaire Jeffrey Epstein revient comme un boomerang. Depuis des mois, Trump qualifie cette histoire d’« arnaque démocrate », une tentative de diversion orchestrée par ses adversaires pour masquer leurs propres turpitudes. Mais en novembre 2025, cette stratégie de déni atteint ses limites. La Chambre des représentants se prépare à voter sur la publication de nouveaux documents du ministère de la Justice concernant Epstein — et Trump panique. Quatre représentants républicains ont été convoqués à la Maison-Blanche pour recevoir leurs instructions : bloquer ce vote à tout prix. Parmi eux, Lauren Boebert, qui avait pourtant exprimé son soutien à la transparence, a finalement plié. « Nous demeurons engagés à assurer la transparence pour le peuple américain », a-t-elle déclaré après la rencontre, une déclaration qui sonne comme une capitulation déguisée.
Un discours qui a radicalement changé
Le ton de Trump sur Epstein a complètement basculé. Il y a quelques mois encore, il se disait favorable à la publication de certains documents, jouant sur la carte de la transparence pour se dédouaner. Puis, au printemps 2025, Elon Musk — son ancien collaborateur — a évoqué la présence du nom de Trump dans ces documents. Depuis, le président n’a cessé de durcir sa position, multipliant les attaques contre les démocrates qu’il accuse de manipuler l’affaire. « Seuls de très mauvais ou très stupides républicains tomberaient dans ce piège », a-t-il écrit sur Truth Social, visant directement les élus de son propre camp tentés de voter en faveur de la divulgation. Cette pression constante révèle une nervosité grandissante — celle d’un homme qui sait qu’il a quelque chose à cacher.
Les républicains pris en étau
Les élus républicains se retrouvent coincés entre deux feux. D’un côté, Trump qui menace, convoque, insulte ceux qui osent ne serait-ce qu’envisager de voter pour la transparence. De l’autre, une opinion publique qui réclame la vérité et des électeurs qui commencent à douter. Patrick Sebastian, ce stratège républicain souvent cité, avertit que ce type de pression interne est contre-productif. « C’est une très mauvaise idée de forcer les républicains modérés à choisir entre leur conscience et la loyauté au président », confie-t-il dans les coulisses. Cette stratégie de Trump ne fait qu’aggraver les divisions internes, fragilisant le parti à quelques mois d’élections cruciales.
Je regarde cette scène avec une certaine fascination morbide. Trump, ce manipulateur chevronné qui a su pendant des années transformer chaque attaque en victoire médiatique, se retrouve aujourd’hui empêtré dans ses propres mensonges. L’affaire Epstein n’est pas qu’un dossier judiciaire — c’est un symbole de tout ce que Trump incarne : l’impunité, la corruption, le mépris des règles. Et cette fois, il ne peut pas s’en sortir par une pirouette communicationnelle. Ses alliés le lâchent, un par un. C’est l’histoire d’un homme qui a construit son empire sur la peur et qui découvre, trop tard, que la peur finit toujours par se retourner contre celui qui l’invoque.
Marjorie Taylor Greene, la rupture symbolique

L’ancienne icône du MAGA prend ses distances
Marjorie Taylor Greene, cette figure emblématique de l’aile la plus radicale du parti républicain, a rompu avec Trump en novembre 2025. La députée de Géorgie, connue pour son soutien indéfectible au président et pour ses positions complotistes assumées, a osé critiquer publiquement la priorité donnée par Trump à la politique étrangère au détriment des préoccupations intérieures. « Je voudrais qu’il y ait des réunions incessantes à la Maison-Blanche sur la politique intérieure, pas sur la politique étrangère avec des dirigeants étrangers », a-t-elle écrit sur X après la visite du président syrien Ahmed al-Charaa. Cette sortie a provoqué une réaction immédiate et brutale de Trump, qui l’a accusée de s’être « égarée » et de « servir la soupe au camp d’en face ».
Trump insulte son ancienne alliée
Le ton utilisé par Trump pour parler de Greene révèle l’ampleur de la fracture. « Je ne sais pas ce qui arrive à Marjorie, c’est une femme bien. Je pense qu’elle s’est égarée », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale, avant de durcir encore son discours. Sur Truth Social, il l’a traitée de « dingue » et de « traîtresse ». Pour une femme qui a défendu Trump pendant des années, qui a relayé ses thèses les plus extrêmes, qui a été l’une des voix les plus agressives du mouvement MAGA, cette rupture est un séisme politique. Greene ne s’est pas contentée de critiquer : elle a expliqué à CNN que cette rupture était motivée par la volonté de « mettre fin aux luttes toxiques en politique », une déclaration qui sonne comme un désaveu total de la méthode Trump.
Un mouvement qui implose de l’intérieur
La rupture entre Trump et Greene n’est pas un simple accrochage politique — c’est le symptôme d’un mouvement MAGA en pleine désintégration. Greene incarne cette frange radicale qui a longtemps cru que Trump était le seul à pouvoir sauver l’Amérique. Aujourd’hui, elle réalise que le coût de cette loyauté est trop élevé. Les électeurs républicains, frustrés par la vie chère, déçus par les défaites aux élections locales de novembre 2025, commencent à douter. Le MAGA, ce système qui fonctionnait sur la loyauté absolue, se fissure. Et Trump, incapable d’accepter la moindre critique, accélère cette implosion en attaquant ceux qui osent s’écarter de la ligne.
Il y a quelque chose de tragique dans cette rupture. Greene, cette femme qui a tout sacrifié pour Trump, qui a été ostracisée, ridiculisée, attaquée par les médias et l’establishment, découvre que la loyauté dans l’univers de Trump est à sens unique. Quand vous cessez d’être utile, quand vous osez questionner, vous êtes éliminé. C’est la loi de la jungle politique version MAGA : survivre ou disparaître. Et Greene, malgré toute sa radicalité, a fini par comprendre qu’elle ne survivrait pas en restant dans l’ombre d’un homme qui ne tolère aucune dissidence.
Le shutdown, une victoire empoisonnée
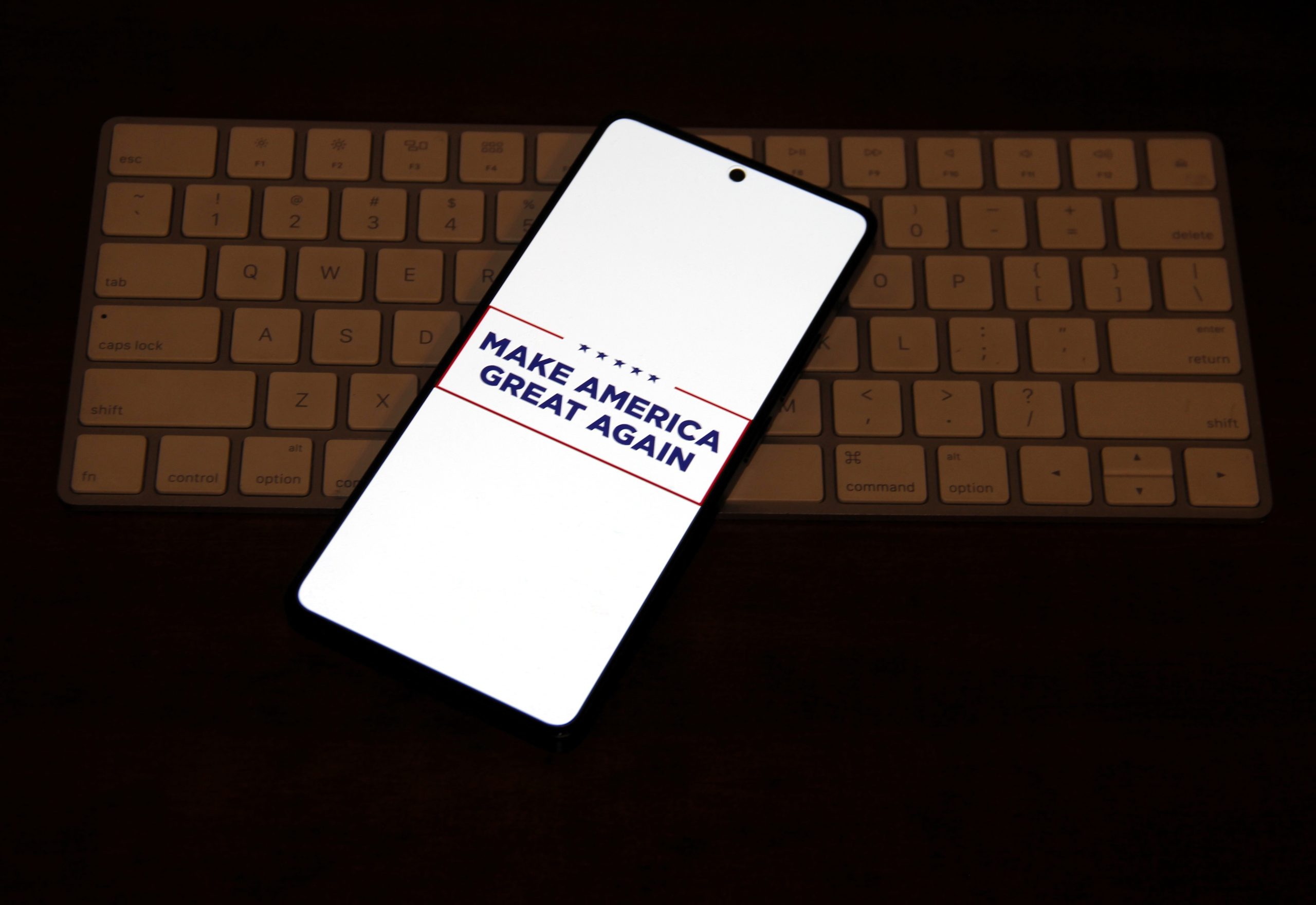
Trump se félicite, mais le terrain est miné
En novembre 2025, après le plus long shutdown de l’histoire américaine récente, Trump s’est félicité d’avoir « brisé l’unité démocrate ». Il a présenté la fin du blocage budgétaire comme une grande victoire, une preuve de sa capacité à plier le Congrès à sa volonté. Mais derrière les cris de triomphe, la réalité est bien plus sombre. Ce shutdown a profondément divisé les républicains, qui ont dû expliquer à leurs électeurs pourquoi ils refusaient de prolonger les subventions de l’Obamacare — un programme pourtant populaire auprès de millions d’électeurs de Trump. Patrick Sebastian, toujours lui, avertit que l’arrêt brutal de ces subventions constituerait un « défi politique majeur » pour le parti.
Les républicains paient le prix politique
Les stratèges républicains, dont Tony Fabrizio, principal conseiller de la campagne de Trump, avaient pourtant averti dès juillet 2025 que refuser de prolonger les subventions de l’ACA serait un risque énorme. Mais Trump, obsédé par son objectif de détruire l’Obamacare qu’il qualifie de « désastre », a ignoré ces avertissements. Résultat : les républicains modérés se retrouvent dans une position intenable face à leurs électeurs. Les démocrates, de leur côté, ont trouvé un message de campagne redoutablement efficace pour 2026 : « Les républicains, qui contrôlent l’ensemble du gouvernement, n’ont rien fait pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie. » Cette narrative pourrait coûter très cher au parti de Trump.
Une stratégie qui se retourne contre lui
Le shutdown illustre parfaitement le problème de la stratégie trumpienne : elle privilégie les coups d’éclat à court terme au détriment de la viabilité politique à long terme. Trump a obtenu sa victoire symbolique, mais à quel prix ? Les républicains ont perdu en crédibilité, les électeurs sont frustrés, et les démocrates ont trouvé une faille à exploiter. Patrick Sebastian et d’autres stratèges républicains le répètent en privé : cette approche est « une très mauvaise idée ». Trump joue avec le feu, et ce sont les élus républicains qui vont se brûler en 2026.
Les défaites électorales, un signal d'alarme

Les républicains écrasés aux élections locales
En novembre 2025, les élections locales ont été un désastre pour le parti républicain. Au New Jersey et en Virginie, les gouverneures démocrates ont remporté des victoires spectaculaires, captant une part significative des électeurs qui avaient voté pour Trump en 2024. Plus inquiétant encore : l’appui aux républicains parmi les Afro-Américains et les Latinos — une clé de la victoire de Trump en 2024 — s’est effondré. À New York, Zohran Mamdani, un démocrate, a remporté la mairie en exploitant le mécontentement populaire face au coût de la vie, un thème que Trump avait pourtant fait sien lors de sa campagne.
Le coût de la vie, l’arme des démocrates
Ironie du sort : Trump, qui avait promis de combattre l’inflation et de redonner du pouvoir d’achat aux Américains, voit aujourd’hui les démocrates s’emparer de ce sujet avec une efficacité redoutable. « Peu importe les mensonges de Trump à ce sujet, le coût de la vie avantage maintenant les démocrates », écrit un analyste dans le Journal de Montréal. Les prix continuent de grimper, l’emploi stagne, et la promesse de « renaissance industrielle » de Trump reste lettre morte. Les électeurs, qui avaient cru en ses promesses en 2024, commencent à déchanter. Et cette déception se traduit par des victoires démocrates aux élections locales.
2026, un horizon menaçant pour Trump
Les élections de mi-mandat de 2026 s’annoncent comme un test décisif pour Trump et son parti. Tous les signaux sont au rouge : bilan économique décevant, divisions internes, stratégies politiques contre-productives. Les stratèges républicains, dont Patrick Sebastian, sont conscients du danger. Mais Trump, enfermé dans sa bulle, refuse d’entendre ces avertissements. Il continue de pousser ses élus à suivre une ligne dure, quitte à les sacrifier sur l’autel de son ego. Le résultat ? Un parti affaibli, désorienté, incapable de présenter un front uni face à des démocrates revigorés et déterminés à reconquérir le pouvoir.
Quand je pense aux élections de 2026, je ressens une forme d’angoisse anticipée. Pas pour Trump, qui survivra probablement à cette débâcle grâce à son culte de la personnalité, mais pour tous ces républicains modérés qui vont payer le prix de sa folie. Ces élus qui, au fond, savent que Trump mène le parti droit dans le mur, mais qui n’osent pas s’opposer de peur d’être ostracisés. Ils vont perdre leurs sièges, leurs carrières, tout ça parce qu’ils ont choisi la loyauté aveugle plutôt que le courage politique. Et Trump, lui, continuera de tweeter depuis Mar-a-Lago, en accusant tout le monde sauf lui-même.
Les stratèges républicains sonnent l'alarme

Patrick Sebastian et les autres voix dissidentes
Patrick Sebastian n’est pas le seul stratège républicain à exprimer ses inquiétudes. Dans les coulisses du parti, les murmures se multiplient. Ces professionnels de la politique, qui ont consacré leur carrière à faire élire des républicains, voient avec effroi Trump détruire méthodiquement le capital politique du parti. « C’est une très mauvaise idée de forcer les républicains modérés à suivre une ligne aussi extrême », confie l’un d’eux sous couvert d’anonymat. « On va perdre les élections de 2026 si on continue comme ça. » Mais ces voix, aussi expertes soient-elles, peinent à se faire entendre dans un parti dominé par la personnalité écrasante de Trump.
Une fracture entre tactique et stratégie
Le problème fondamental, c’est que Trump confond tactique et stratégie. Sur le plan tactique, ses coups d’éclat fonctionnent : il domine les cycles médiatiques, fait parler de lui, mobilise sa base. Mais sur le plan stratégique, ces mêmes tactiques affaiblissent le parti à long terme. Les stratèges républicains le savent, les sondages le confirment, mais Trump refuse de l’admettre. Il préfère attaquer Greene, menacer les élus républicains, diaboliser les démocrates, plutôt que de construire une coalition solide capable de remporter les élections futures. Cette myopie politique pourrait coûter très cher au parti républicain.
Le silence complice de l’establishment
Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est le silence de l’establishment républicain. Combien d’élus, de sénateurs, de responsables du parti savent pertinemment que Trump mène le navire vers l’iceberg, mais n’osent rien dire ? Combien préfèrent garder le silence, par peur de représailles, par calcul politique, par lâcheté ? Ce silence complice est aussi responsable de la situation actuelle que les actions de Trump lui-même. Les stratèges comme Patrick Sebastian peuvent bien sonner l’alarme, si personne ne les écoute, si personne n’agit, le désastre est inévitable.
L'autoritarisme trumpien et ses limites

Un président qui gouverne par la menace
Trump gouverne par la menace et l’intimidation. Convocations à la Maison-Blanche, insultes sur les réseaux sociaux, accusations de trahison… tout est bon pour forcer les républicains à se plier à sa volonté. Cette méthode, qui a fonctionné pendant des années, atteint aujourd’hui ses limites. Les élus républicains, même les plus fidèles, commencent à réaliser que cette loyauté aveugle les mène droit vers la défaite électorale. Et certains, comme Marjorie Taylor Greene, osent enfin dire non. Ce n’est pas une révolution, pas encore, mais c’est un signe que l’emprise de Trump sur le parti commence à se fissurer.
Le Projet 2025 et la transformation autoritaire
Le Projet 2025, ce plan de plus de 900 pages visant à transformer radicalement le gouvernement américain en concentrant le pouvoir entre les mains du président, illustre les ambitions autoritaires de Trump. Les critiques de ce projet le qualifient d’« autoritaire » et de « nationaliste chrétien », affirmant qu’il vise à transformer les États-Unis en autocratie. Même certains républicains modérés expriment leurs réserves face à ce plan jugé trop extrême. Mais Trump, lui, persiste. Il veut un pouvoir absolu, sans contre-pouvoirs, sans opposition interne. Et c’est précisément cette volonté de contrôle total qui alimente les résistances au sein de son propre parti.
Les limites constitutionnelles et judiciaires
Heureusement pour la démocratie américaine, il existe encore des garde-fous. La Cour suprême a déjà jugé certains aspects du Projet 2025 anticonstitutionnels. Le Congrès, même avec une majorité républicaine, ne suit pas aveuglément toutes les directives de Trump. Et l’opinion publique, bien qu’en partie séduite par le discours trumpien, n’est pas prête à accepter une dérive autoritaire complète. Ces limites constitutionnelles et judiciaires sont autant d’obstacles sur la route de Trump. Mais cela ne l’empêche pas d’essayer, encore et encore, de les contourner.
L’autoritarisme de Trump me terrifie, je l’avoue. Non pas parce qu’il est particulièrement habile — au contraire, il est souvent maladroit, prévisible. Mais parce qu’il révèle à quel point les institutions démocratiques américaines sont fragiles. Il suffit d’un homme, d’un mouvement, d’une base radicalisée, pour mettre en péril tout l’édifice. Et le silence de ceux qui savent, de ceux qui pourraient agir, rend cette menace encore plus effrayante. L’histoire nous enseigne que les autocraties ne naissent jamais du jour au lendemain — elles s’installent progressivement, profitant de la passivité de ceux qui auraient pu résister.
Les démocrates profitent du chaos républicain

Une opposition revigorée et stratégique
Pendant que les républicains s’entre-déchirent, les démocrates profitent du chaos. Ils ont trouvé leur message pour 2026 : dénoncer l’incapacité des républicains à répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie. Ce message, simple et percutant, résonne auprès d’une population frustrée par la hausse des prix et la stagnation des salaires. Les démocrates n’ont même pas besoin d’inventer une stratégie complexe — il leur suffit de pointer du doigt les échecs de Trump et de son parti.
Les victoires électorales comme tremplin
Les victoires démocrates aux élections locales de novembre 2025 ne sont pas de simples succès isolés — elles sont le signe d’un retour en force du parti. Au New Jersey, en Virginie, à New York, les démocrates ont réussi à mobiliser leur base tout en attirant des électeurs déçus par Trump. Cette dynamique, si elle se confirme, pourrait transformer les élections de mi-mandat de 2026 en un raz-de-marée démocrate. Les stratèges républicains le savent, Patrick Sebastian le sait, mais Trump refuse de l’admettre.
L’affaire Epstein, un cadeau politique pour les démocrates
L’affaire Epstein est un cadeau inespéré pour les démocrates. Chaque fois que Trump essaie de la minimiser, chaque fois qu’il qualifie cela d’« arnaque », il ne fait que renforcer les soupçons. Les démocrates n’ont même pas besoin de forcer le trait — il suffit de laisser Trump s’enfoncer dans ses contradictions. Et quand les documents seront finalement publiés, si jamais ils le sont, les révélations pourraient porter un coup fatal à la crédibilité de Trump. Les démocrates le savent, et ils attendent patiemment que le scandale explose.
L'opinion publique se retourne

La popularité de Trump en chute libre
Les sondages sont sans appel : la popularité de Trump est en chute libre. Après une brève lune de miel post-électorale, les Américains commencent à déchanter. Le coût de la vie continue d’augmenter, les promesses de Trump ne se concrétisent pas, et les scandales s’accumulent. Même parmi les électeurs républicains, les doutes s’installent. « Nous avons affaire à un roi fou », confie un sénateur républicain anonyme. Cette phrase, aussi brutale soit-elle, résume le sentiment d’une partie croissante de l’électorat : Trump est devenu incontrôlable.
Les électeurs de Trump déçus et en colère
Les électeurs qui avaient voté pour Trump en 2024, séduits par ses promesses de redonner du pouvoir d’achat et de « rendre l’Amérique grande à nouveau », se sentent trahis. Les prix n’ont pas baissé, les salaires stagnent, et la vie quotidienne est toujours aussi difficile. Pire, ils découvrent que Trump passe plus de temps à régler ses comptes personnels, à s’attaquer à ses ennemis internes, qu’à s’occuper de leurs problèmes concrets. Cette déception se traduit par un désengagement progressif, qui pourrait coûter très cher aux républicains en 2026.
La fracture au sein de l’électorat républicain
L’électorat républicain lui-même est fracturé. D’un côté, le noyau dur MAGA, toujours fidèle à Trump malgré tout. De l’autre, les républicains modérés, ceux qui avaient voté pour lui par défaut, et qui aujourd’hui s’interrogent sur leur choix. Cette fracture est visible dans les résultats des élections locales : l’appui aux républicains parmi les Afro-Américains et les Latinos s’est effondré. Ces électeurs, qui avaient donné une chance à Trump, lui tournent aujourd’hui le dos. Et sans eux, les chances de victoire républicaine en 2026 sont minces.
Il y a quelque chose de presque poétique dans cette chute. Trump, cet homme qui a construit toute sa carrière sur l’image du gagnant invincible, se retrouve aujourd’hui abandonné par ceux-là même qui l’avaient porté au pouvoir. Les électeurs, ces gens ordinaires qu’il prétendait défendre, réalisent qu’ils ont été instrumentalisés. Et maintenant, ils se vengent — pas par des manifestations violentes, pas par des révolutions, mais simplement en votant pour d’autres. C’est une revanche silencieuse, mais dévastatrice.
Trump face à son propre héritage

Un bilan économique désastreux
Le bilan économique de Trump est un désastre. Malgré tous ses efforts pour maquiller les chiffres, la réalité est là : le coût de la vie continue de grimper, l’emploi stagne, et la « renaissance industrielle » promise reste un mirage. Les analystes économiques sont unanimes : la politique économique de Trump n’a pas tenu ses promesses. Pire, elle a aggravé certains problèmes, notamment en matière de déficit budgétaire et d’inégalités. Ce bilan catastrophique sera l’un des principaux arguments des démocrates en 2026 — et les républicains auront bien du mal à le défendre.
Les scandales qui s’accumulent
Au-delà de l’économie, Trump doit faire face à une accumulation de scandales. L’affaire Epstein, bien sûr, mais aussi les accusations de corruption, l’instrumentalisation de la justice pour punir ses opposants, les révélations sur ses pratiques commerciales douteuses… La liste est longue, et elle ne cesse de s’allonger. Chaque nouveau scandale érode un peu plus sa crédibilité, y compris auprès de ses propres électeurs. Et les démocrates, bien sûr, ne manquent pas de rappeler ces affaires à chaque occasion, entretenant une pression médiatique constante.
Une légitimité en question
La légitimité même de Trump est aujourd’hui questionnée. Ses adversaires l’accusent d’autoritarisme, de mépris des institutions, de corruption. Même certains de ses alliés commencent à douter. « Nous avons affaire à un roi fou », répète ce sénateur républicain. Cette phrase résume le malaise grandissant au sein du parti : Trump est devenu un fardeau plus qu’un atout. Et pourtant, personne n’ose vraiment s’opposer à lui, par peur de représailles. Ce paradoxe illustre la situation inextricable dans laquelle se trouve le parti républicain en novembre 2025.
Quand j’essaie d’imaginer ce que sera l’héritage de Trump dans l’histoire américaine, je vois un chaos indescriptible. Pas un chaos créatif, pas une révolution nécessaire, mais un chaos stérile, destructeur. Trump n’a rien construit de durable — il a seulement démoli. Les institutions, les alliances, les normes démocratiques… tout a été sacrifié sur l’autel de son ego. Et maintenant, alors que son règne touche peut-être à sa fin, on commence à mesurer l’ampleur des dégâts. Il faudra des années, peut-être des décennies, pour réparer ce qu’il a détruit.
La stratégie suicidaire de Trump
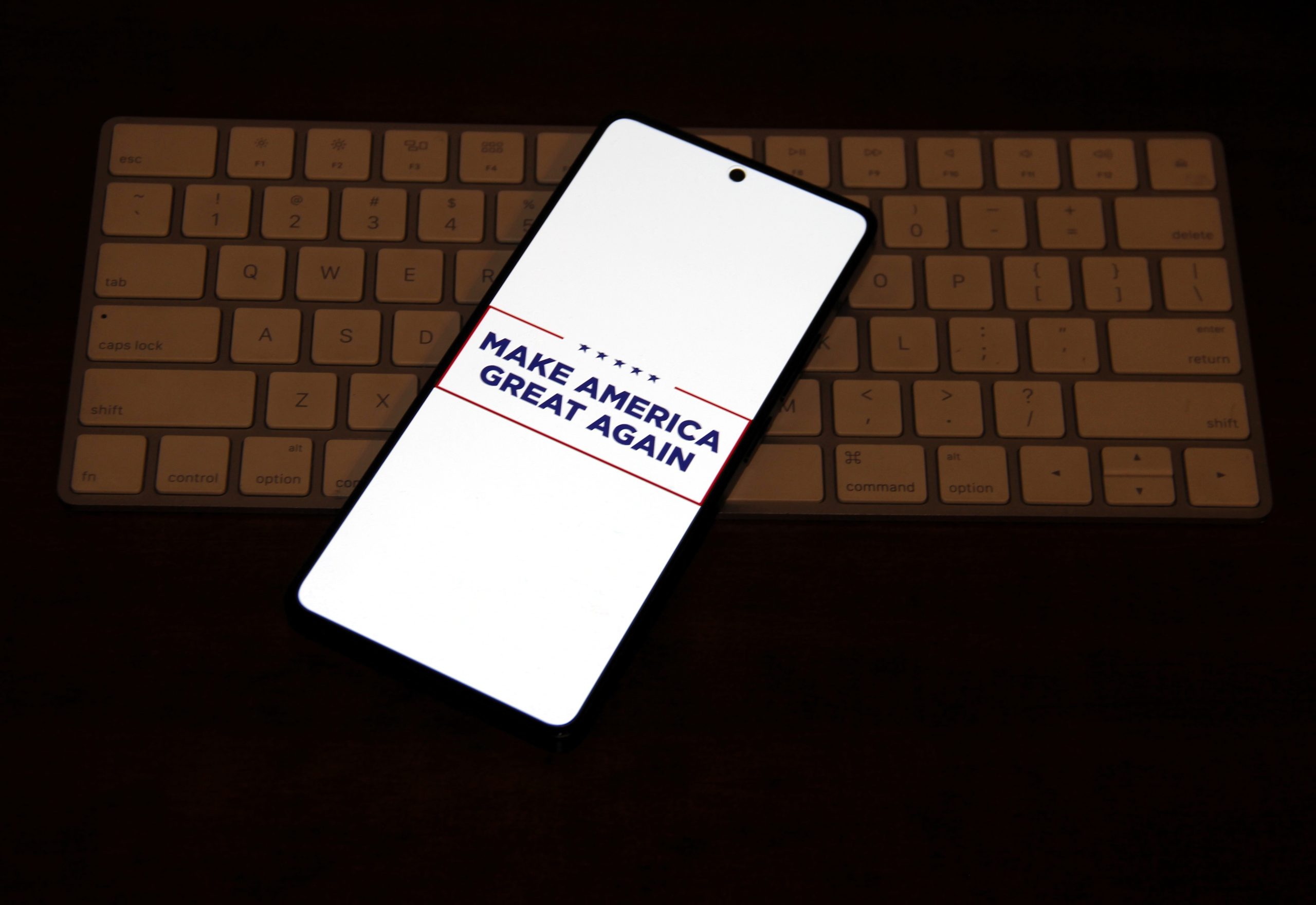
Attaquer ses propres alliés, une erreur fatale
La stratégie de Trump en novembre 2025 peut se résumer en un mot : autodestructrice. Au lieu de rassembler son parti en vue des élections de 2026, il choisit d’attaquer ses propres alliés. Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, et d’autres élus républicains qui osent exprimer le moindre doute sont immédiatement traités de « traîtres ». Cette stratégie, qualifiée de « très mauvaise idée » par Patrick Sebastian, ne fait qu’aggraver les divisions internes. Un parti divisé ne peut pas gagner d’élections — c’est une règle de base de la politique, mais Trump semble l’avoir oubliée.
La pression sur Epstein, un piège qui se referme
En essayant de bloquer la publication des documents Epstein, Trump s’est enfermé dans un piège. Plus il insiste pour que ces documents restent secrets, plus il alimente les soupçons. Plus il attaque les démocrates en les accusant de manipulation, plus il donne de crédibilité à l’affaire. Les stratèges républicains le savent : cette stratégie est contre-productive. Mais Trump, obsédé par l’idée de contrôler le récit, refuse d’écouter. Résultat : il transforme un dossier juridique en scandale politique majeur, donnant ainsi un avantage considérable aux démocrates.
Un parti au bord de l’implosion
Le parti républicain de novembre 2025 est au bord de l’implosion. Les divisions internes sont béantes, les stratégies sont incohérentes, et la direction du parti est absente. Trump, qui devrait être le leader capable de rassembler les troupes, passe son temps à attaquer, à diviser, à détruire. Les républicains modérés se sentent abandonnés, les radicaux sont frustrés, et les stratèges tirent la sonnette d’alarme. « C’est une très mauvaise idée », répètent-ils en boucle. Mais personne ne les écoute. Et le parti continue de sombrer.
Je me demande parfois si Trump réalise ce qu’il est en train de faire. Est-ce qu’il voit que sa stratégie mène le parti droit dans le mur ? Est-ce qu’il s’en soucie seulement ? Ou est-ce que, au fond, Trump ne pense qu’à lui-même, à sa propre survie politique, quitte à sacrifier tous ceux qui l’ont soutenu ? Je penche pour la seconde hypothèse. Trump n’est pas un stratège visionnaire — c’est un survivant égocentrique qui ne pense qu’à court terme. Et ceux qui le suivent aveuglément vont payer le prix de cette myopie. C’est triste, c’est prévisible, et c’est inévitable.
Conclusion

En novembre 2025, Donald Trump est un homme isolé, trahi par ses propres stratégies, abandonné par ses alliés les plus fidèles. « Une très mauvaise idée » : ces mots d’un stratège républicain résonnent comme un avertissement que personne n’a voulu entendre. Trump a choisi la confrontation plutôt que la conciliation, la menace plutôt que le dialogue, l’ego plutôt que l’intérêt du parti. Et maintenant, il en paie le prix. Marjorie Taylor Greene, cette icône MAGA qui l’a soutenu pendant des années, l’a lâché. Les républicains modérés, terrorisés à l’idée de perdre leurs sièges en 2026, commencent à s’émanciper. Les démocrates, revigorés par leurs victoires locales, se préparent à reprendre le pouvoir. Et l’opinion publique, lassée des scandales et des promesses non tenues, se détourne.
L’affaire Epstein, ce dossier que Trump qualifie d’« arnaque », pourrait bien être le coup de grâce. Chaque tentative de bloquer la publication des documents ne fait qu’alimenter les soupçons, transformant un scandale juridique en catastrophe politique. Les stratèges républicains, dont Patrick Sebastian, ne cessent de répéter que cette stratégie est suicidaire. Mais Trump, enfermé dans sa logique de contrôle absolu, refuse d’écouter. Il préfère convoquer des élus à la Maison-Blanche, les menacer, les insulter sur Truth Social, quitte à détruire ce qui reste de cohésion au sein de son parti. Le shutdown, présenté comme une victoire, s’avère être un poison qui affaiblit les républicains. Les défaites électorales de novembre 2025 ne sont qu’un avant-goût de ce qui attend le parti en 2026.
Ce qui se joue en ce moment dépasse la simple politique partisane — c’est l’effondrement d’un mouvement qui avait tout misé sur un homme. Le MAGA, ce système qui fonctionnait sur la loyauté aveugle et la peur, est en train d’imploser. Les fissures sont partout : entre Trump et Greene, entre Trump et les républicains modérés, entre Trump et ses propres stratèges. Et au milieu de ce chaos, il y a ces millions d’Américains qui avaient cru en ses promesses et qui découvrent aujourd’hui qu’ils ont été trompés. Le coût de la vie continue d’augmenter, les emplois stagnent, et la « renaissance industrielle » promise reste un mirage. Les électeurs qui avaient donné leur confiance à Trump en 2024 lui tournent aujourd’hui le dos, et cette désertion pourrait bien être fatale pour le parti républicain.
L’histoire retiendra probablement novembre 2025 comme le moment où la stratégie de Trump a commencé à se retourner contre lui de manière irréversible. Ses tactiques, qui avaient si bien fonctionné pendant des années, se révèlent être des armes à double tranchant. En attaquant ses propres alliés, en s’enfonçant dans l’affaire Epstein, en refusant d’écouter les avertissements de ses stratèges, Trump a creusé sa propre tombe politique. Patrick Sebastian et les autres stratèges républicains avaient raison : c’était « une très mauvaise idée ». Mais maintenant, il est trop tard. Le mal est fait, les ponts sont brûlés, et le parti républicain se dirige tout droit vers une catastrophe électorale en 2026. Trump, cet homme qui se voulait invincible, découvre que même les rois finissent par tomber — surtout quand ils sont fous.
Source : alternet
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.