Quand on évoque les animaux les plus dangereux d’Amérique, les images de requins, d’ours ou de serpents à sonnettes surgissent presque instinctivement. Pourtant, la réalité, chiffres à l’appui, est bien moins spectaculaire et beaucoup plus proche de nous. Une étude récente vient bousculer nos préjugés en révélant que le véritable péril ne se tapit pas dans les forêts profondes ou les eaux troubles, mais bien souvent, juste au-dessus de nos têtes.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes
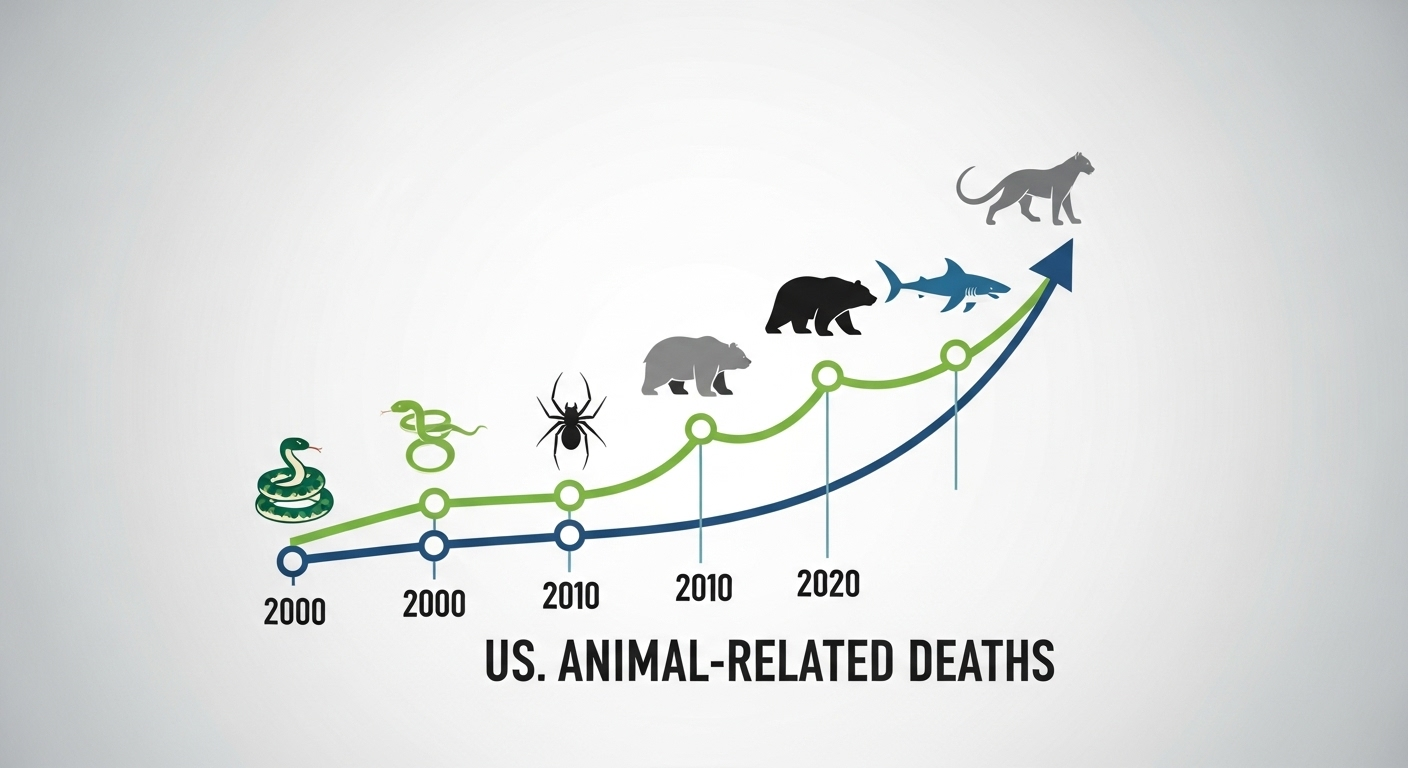
Les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains sont formelles : entre 2018 et 2023, 1 604 personnes ont perdu la vie suite à une rencontre avec un animal. Le chiffre peut sembler modeste rapporté à la population, mais c’est sa progression qui alerte. On est passé de 227 décès en 2018 à 313 en 2023. C’est une hausse de 38 % en à peine cinq ans, une tendance qui intrigue les chercheurs.
Le véritable coupable : un insecte bien connu

Oubliez les crocs et les griffes. Le danger numéro un, responsable de près d’un tiers des décès (31 %, soit 497 victimes), vient du ciel. Frelons, guêpes et abeilles constituent la menace la plus sérieuse pour l’homme sur le sol américain. Le plus souvent, la cause est une réaction allergique violente, un choc anaphylactique. À côté, les serpents venimeux et les araignées font pâle figure, avec respectivement 30 et 26 décès sur la même période.
Les mammifères, un danger familier et sous-estimé

Juste derrière ce podium inattendu, on retrouve les mammifères, impliqués dans 28,6 % des cas. La catégorie est hétéroclite. On y trouve bien sûr quelques attaques d’ours (26) ou de cougars (2), mais l’essentiel des drames provient d’animaux beaucoup plus proches de nous. Le bétail ou les chevaux sont souvent en cause. Et puis il y a les chiens, dont le bilan s’est particulièrement alourdi ces dernières années, avec 420 décès recensés.
L'effet pervers de la pandémie sur les attaques de chiens

L’explosion du nombre d’attaques de chiens n’est pas un hasard. Les chercheurs de l’étude, publiée dans *Environmental Health Insights*, pointent directement du doigt la période de la pandémie de COVID-19. « Cette hausse est probablement liée à la vague d’adoptions d’animaux et à l’augmentation du temps passé à la maison », expliquent-ils. Plus d’interactions, parfois avec des maîtres peu expérimentés, ont mathématiquement augmenté les risques d’accidents.
Quand le climat s'en mêle

Mais comment expliquer cette tendance de fond, au-delà de l’effet conjoncturel de la pandémie ? Le réchauffement climatique est l’autre grand suspect. Les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes notamment dans le sud des États-Unis, modifient le comportement des animaux. Elles étendent leur habitat et augmentent leur période d’activité. Ce n’est sans doute pas une coïncidence si près de la moitié des décès (46,8 %) ont été enregistrés dans le Sud, contre à peine 10 % dans le Nord-Est.
repenser notre cohabitation avec le vivant

Ce tableau brosse un portrait complexe où nos modes de vie et les bouleversements environnementaux s’entremêlent pour redéfinir les risques. Il ne s’agit pas de sombrer dans la psychose, le risque individuel restant très faible. Mais ces chiffres nous rappellent que le danger n’est pas toujours là où on l’attend. Face à cette réalité, les auteurs de l’étude insistent sur une chose : la prévention, par l’éducation du public et une gestion plus responsable de nos animaux de compagnie.
Selon la source : geo.fr
TOUTES LES LIGNES ONT UN POINT COMMUN . INUTILE DE DEVINER
POUR L’INTELLIGENCE MOYENNE.