Un gouvernement fantôme qui meurt avant de naître
Sébastien Lecornu vient d’entrer dans l’Histoire par la petite porte — celle des records d’humiliation politique. Quatorze heures et vingt-six minutes. C’est tout ce qu’aura duré son gouvernement, du dimanche soir 5 octobre au lundi matin 6 octobre 2025. Un gouvernement-éclair qui n’aura même pas eu le temps de tenir son premier Conseil des ministres. Plus éphémère que le second gouvernement Queuille de 1949 qui avait, lui, tenu deux jours entiers. La Ve République, cette construction gaulliste supposée inébranlable, vient de produire le gouvernement le plus bref de toute l’histoire de France, tous régimes confondus.
Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur reconduit, s’insurge publiquement contre une équipe qui « ne reflète pas la rupture promise ». Les Républicains convoquent une réunion d’urgence. Le retour controversé de Bruno Le Maire, tenu pour responsable du marasme budgétaire, achève d’enflammer une situation déjà explosive. Et pendant ce temps, la machine institutionnelle française se disloque sous nos yeux, incapable de produire la moindre stabilité gouvernementale depuis plus d’un an.
L’arithmétique de l’impossible
L’Assemblée nationale fragmentée en trois blocs irréductibles — gauche, centre-droit, extrême droite — refuse tout compromis. Aucune majorité ne se dessine. Le Nouveau Front Populaire reste arc-bouté sur ses positions, exigeant un Premier ministre de gauche et la suspension immédiate de la réforme des retraites. Marine Le Pen et Jordan Bardella promettent de censurer « tout » gouvernement qui ne plierait pas devant leurs conditions. Au centre, les macronistes se divisent : Gabriel Attal refuse une présidentielle anticipée quand Édouard Philippe l’appelle de ses vœux.
Cette paralysie institutionnelle n’est pas qu’un jeu politique parisien. Elle étouffe littéralement la capacité d’action de l’État. Pas de budget 2026 en vue — alors que le déficit public dépasse déjà 5,4% du PIB et que Fitch vient d’abaisser la note de la France. Pas de réformes possibles sur l’industrialisation, le numérique, la cybersécurité, le narcotrafic. Pas de textes votés jusqu’en septembre 2027, dans l’hypothèse optimiste d’une nouvelle assemblée alignée sur le gouvernement.
Les tentatives désespérées de survie
Depuis la démission-surprise de lundi matin, Sébastien Lecornu multiplie les consultations d’urgence. Mardi et mercredi, il reçoit socialistes, écologistes, communistes dans une course contre la montre. L’objectif affiché : trouver un accord minimal sur le budget 2026 pour « éloigner les perspectives d’une dissolution » de l’Assemblée nationale. Tous semblent s’accorder sur une cible de déficit public « en dessous de 5% », entre 4,7 et 5% pour 2026. Mais les concessions réciproques restent à définir, et chaque camp campe sur ses positions maximalistes.
Emmanuel Macron : l'homme le plus détesté de France

L’impopularité historique qui défie l’entendement
Les chiffres sont impitoyables. Emmanuel Macron chute à 14% de confiance selon le baromètre Elabe d’octobre 2025, égalant le record d’impopularité de François Hollande en novembre 2016. Pire : 82% des Français lui témoignent leur défiance, dont 59% « pas du tout » — un niveau de rejet qui dépasse même celui des Gilets jaunes de décembre 2018. En deux mois seulement, le Président a perdu 7 points, et 13 points depuis mars 2025. Même au plus fort de sa première crise, il n’était jamais tombé aussi bas.
L’effondrement est encore plus spectaculaire dans son propre camp. Seuls 38% de ses électeurs du premier tour 2022 lui accordent encore leur confiance — un plancher historique qui représente une division par deux en six mois. Parmi ses électeurs du second tour, la confiance tombe à 28%. À titre de comparaison, François Hollande à son étiage bénéficiait encore de 35% de soutien chez ses électeurs du premier tour. Macron fait donc pire que Hollande sur ce critère décisif de fidélité électorale.
Le camp présidentiel en décomposition avancée
L’implosion ne se limite pas aux sondages. Édouard Philippe, ancien Premier ministre et figure majeure du macronisme, vient de franchir le Rubicon. Sur RTL mardi 7 octobre, il appelle Emmanuel Macron à « organiser une élection présidentielle anticipée » après le vote du budget. « L’État n’est plus tenu », déclare-t-il sans ambages. « Face à l’affaissement de l’État, face à cette mise en cause de l’autorité de l’État, la sortie de crise, c’est sur lui qu’elle repose ». Une déclaration qui sème la stupeur au sein du camp présidentiel et brise un tabou majeur.
Gabriel Attal, président de Renaissance, tente de limiter les dégâts en affirmant qu’ils ne « mêleront jamais leurs voix à ceux qui appellent à la démission du président ». Mais le mal est fait. David Lisnard, maire de Cannes, estime que « l’intérêt de la France commande qu’Emmanuel Macron programme sa démission ». Éric Coquerel déclare sur France Inter qu’Emmanuel Macron devrait « comprendre, au nom de l’intérêt général, qu’il doit démissionner ». L’étau se resserre de toutes parts sur un Président désormais isolé.
Les motions de destitution qui se multiplient
La France Insoumise ne désarme pas. Mercredi 8 octobre, le Bureau de l’Assemblée nationale examine la troisième motion de destitution déposée contre Emmanuel Macron — un record sous la Ve République. 104 députés de gauche (LFI, Écologistes, Socialistes, GDR) signent cette proposition de résolution sur le fondement de l’article 68 de la Constitution, invoquant un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Mais comme les fois précédentes, le RN s’abstient, permettant au Bureau de déclarer la motion irrecevable par 10 voix contre, 5 pour et 5 abstentions.
La cascade des gouvernements morts-nés

De Barnier à Lecornu : l’accélération fatale
Depuis la dissolution de juin 2024, la France bat tous les records d’instabilité gouvernementale. Gabriel Attal démissionne le 16 juillet et expédie les affaires courantes pendant 56 jours — un record historique. Michel Barnier lui succède en septembre mais chute trois mois plus tard, censuré le 4 décembre 2024 — première censure depuis 1962. François Bayrou prend le relais en décembre mais tombe au bout de neuf mois après avoir perdu un vote de confiance qu’il avait lui-même provoqué. Et maintenant Lecornu, qui implose avant même d’exister.
Cette accélération révèle une dégradation systémique. Chaque gouvernement dure moins longtemps que le précédent. Chaque chute aggrave la crise de légitimité. L’opinion publique, les marchés, les partenaires européens perdent confiance dans la capacité française à gouverner. Les spreads obligataires se creusent, les investissements se reportent, l’autorité de l’État s’effrite jour après jour dans une spirale qui semble incontrôlable.
L’impossible équation budgétaire
Au cœur de cette crise se niche un piège budgétaire aux mâchoires de plus en plus serrées. Le déficit public français atteint 5,4% du PIB, très au-dessus des 3% autorisés par les règles européennes. Fitch vient d’abaisser la note du pays à A+, pointant les doutes sur la capacité de la France à redresser ses comptes. Bruxelles renforce sa surveillance et menace de sanctions. Le projet de budget 2026 doit théoriquement être présenté avant le 13 octobre pour respecter les 70 jours de débat parlementaire. Mais quel gouvernement pour le porter ? Quel parlement pour le voter ?
Sans budget approuvé, l’État devra recourir à des mesures transitoires : prolonger le budget 2025, voter une loi spéciale comme en début d’année. Mais ces palliatifs ne règlent rien du problème de fond. Ils ne font que repousser l’échéance en aggravant l’incertitude. Les économistes alertent : une paralysie institutionnelle durable compromettra la croissance et compliquera les efforts de stabilisation des finances publiques. Le ratio dette/PIB français reste l’un des plus élevés d’Europe.
L’Europe inquiète mais impuissante
Les partenaires européens observent avec une inquiétude croissante l’enlisement français. La France est la deuxième économie de l’UE — son effondrement politique pourrait affecter les perspectives de croissance de toute la zone euro et compliquer les négociations du budget européen à long terme de 2000 milliards d’euros. Mais que peuvent faire Bruxelles ou Berlin face à une crise institutionnelle purement française ? Les règles budgétaires européennes créent une pression externe, mais elles ne peuvent pas fabriquer une majorité parlementaire à Paris.
La Ve République à l'agonie

Les institutions qui craquent de toutes parts
Cette crise révèle les failles structurelles d’un système institutionnel conçu pour d’autres temps. La Ve République reposait sur l’existence d’une majorité présidentielle claire, capable de soutenir l’action gouvernementale. Mais que se passe-t-il quand cette majorité n’existe plus ? Quand l’Assemblée se fragmente en blocs incompatibles ? Le système gaullien n’avait pas prévu cette configuration et se trouve totalement désarmé. Les dissolution successives ne règlent rien — elles ne font qu’aggraver la fragmentation.
L’article 49.3, qui permettait traditionnellement de passer en force, ne fonctionne plus dans une assemblée où toutes les oppositions peuvent s’unir pour censurer. L’article 68 sur la destitution présidentielle reste lettre morte tant que le RN refuse de jouer le jeu. Le président ne peut pas dissoudre avant juillet 2025 — un an après les dernières législatives. Tous les mécanismes de régulation sont grippés, toutes les soupapes de sécurité bloquées.
La comparaison historique qui fait frémir
Les chroniqueurs évoquent de plus en plus souvent le spectre de la IVe République — cette « mal-aimée » qui a enchaîné les crises gouvernementales de 1946 à 1958. L’instabilité chronique, l’impuissance face aux défis extérieurs, la paralysie institutionnelle : les similitudes sont troublantes. Mais la situation actuelle présente des différences majeures. En 1958, Charles de Gaulle incarnait une alternative crédible. En 2025, qui pourrait jouer ce rôle ? Marine Le Pen ? Jean-Luc Mélenchon ? L’offre politique n’a jamais été aussi fragmentée, aussi radicalisée.
L’historien Jean Garrigues qualifie cette crise d' »inédite » sous la Ve République, estimant qu’elle ne justifierait pas encore un changement de régime. Mathias Bernard parle d’une « crise très rare dans l’histoire politique » dont « une sortie de crise semble difficile à trouver ». Ces précautions académiques masquent mal l’ampleur du séisme institutionnel en cours. Quand un régime politique ne parvient plus à produire de gouvernements stables, quand ses institutions se bloquent les unes les autres, c’est bien sa survie même qui se trouve questionnée.
Les scénarios de sortie de crise tous impossibles
Emmanuel Macron fait face à un trilemme insoluble. Première option : nommer un Premier ministre de gauche, mais cela signifierait renier toute sa politique et accepter la suspension de ses réformes phares. Deuxième option : dissoudre à nouveau l’Assemblée, mais il ne peut pas le faire avant juillet 2025, et rien ne garantit qu’une nouvelle élection produise une majorité plus claire. Troisième option : démissionner pour provoquer une présidentielle anticipée, mais il s’y refuse catégoriquement et ses soutiens restent mobilisés contre cette éventualité.
Le peuple français face à l'impuissance de ses élites
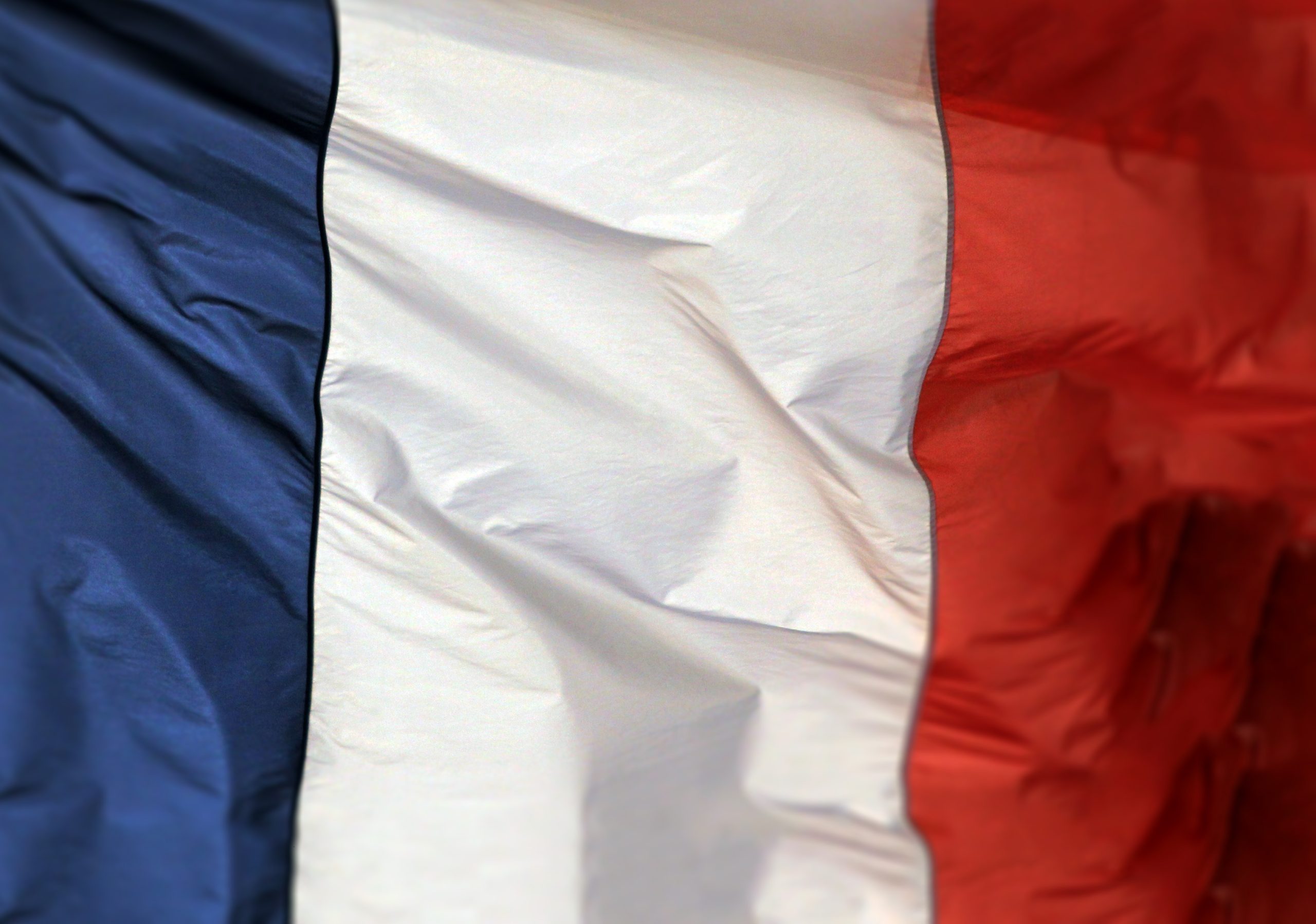
La colère qui monte dans le pays
Pendant que les politiques se déchirent dans leurs palais parisiens, la France réelle subit les conséquences de cette paralysie. Les réformes nécessaires sont reportées sine die. Les grands projets d’investissement restent dans les cartons. L’industrie française perd du terrain face à la concurrence internationale faute de cap politique clair. La sécurité se dégrade dans les quartiers difficiles faute de moyens budgétaires nouveaux. L’immigration continue de poser des défis non résolus faute de consensus gouvernemental.
Les sondages révèlent une défiance généralisée envers la classe politique. 70% des Français souhaitent le départ d’Emmanuel Macron selon les enquêtes récentes. Mais ils ne font pas davantage confiance aux oppositions, perçues comme incapables de proposer des solutions crédibles. Cette double défiance — envers le pouvoir et envers l’opposition — crée un vide politique extrêmement dangereux dans une démocratie. Quand plus personne ne croit en la capacité du système à se réformer, les tentations autoritaires grandissent.
L’économie française dans la tourmente
Les conséquences économiques de cette instabilité se font déjà sentir. Les marchés financiers sanctionnent l’incertitude politique française : les rendements obligataires augmentent, les actions chutent à chaque annonce de crise gouvernementale. Les investisseurs internationaux reportent leurs projets en attendant des jours meilleurs. La compétitivité française se dégrade face à des pays comme l’Allemagne ou l’Italie qui, malgré leurs propres difficultés, parviennent à maintenir une certaine stabilité politique.
Le « décrochage est enclenché » selon les économistes. Sans budget voté à temps, sans réformes structurelles, sans vision à long terme, l’économie française risque de perdre définitivement son rang parmi les grandes puissances mondiales. Les entreprises délocalisent, les talents s’expatrient, l’innovation se tarit faute d’un environnement politique prévisible. C’est tout le modèle français — cette synthèse unique entre économie de marché et protection sociale — qui se trouve remis en cause par l’instabilité chronique.
L’isolement international qui se profile
Sur la scène internationale, la France commence à perdre sa voix. Comment peser dans les négociations européennes quand on ne sait pas qui sera Premier ministre la semaine suivante ? Comment défendre des positions géopolitiques cohérentes quand le gouvernement change tous les trois mois ? Nos partenaires — Allemagne, Italie, Espagne — prennent progressivement leurs distances avec un pays devenu imprévisible. L’influence française au sein de l’UE s’amenuise à mesure que notre crédibilité politique s’effrite.
L'horizon bouché d'une crise sans fin

Les 48 heures qui peuvent tout changer ou rien du tout
Emmanuel Macron a accordé 48 heures à Sébastien Lecornu pour « poursuivre les discussions avec les forces politiques » et trouver un compromis salvateur. Mais ces ultimes négociations ressemblent davantage à un baroud d’honneur qu’à une vraie tentative de sortie de crise. Les socialistes maintiennent leurs exigences sur les retraites. Les écologistes campent sur leurs positions environnementales. Les communistes réclament plus de justice sociale. Chaque parti a ses lignes rouges intangibles, rendant tout compromis mathématiquement impossible.
Lecornu s’exprimera au 20H de France 2 mercredi soir pour faire le bilan de ses consultations. Mais que pourra-t-il annoncer de concret ? Un accord de façade sur le budget qui explosera dès le premier amendement controversé ? Une coalition de circonstance qui implosera au premier désaccord ? L’exercice relève plus de la communication de crise que de la recherche de solutions durables. Emmanuel Macron, lui, ne s’exprimera pas — signe qu’il n’a probablement rien de positif à annoncer.
Le compte à rebours vers juillet 2025
Dans l’hypothèse où aucun compromis ne se dessine, la France entrerait dans une période d’hibernation politique jusqu’en juillet 2025 — date à partir de laquelle Emmanuel Macron pourra à nouveau dissoudre l’Assemblée. Neuf mois de paralysie institutionnelle, de gouvernements techniques, de budgets prolongés. Neuf mois pendant lesquels aucune réforme majeure ne pourra être votée, aucune vision d’avenir ne pourra être portée. Un interminable tunnel qui risque d’achever de décrédibiliser le système politique français.
Mais même une dissolution en juillet 2025 ne garantirait rien. Pourquoi les Français voteraient-ils différemment dans neuf mois ? Pourquoi l’offre politique se clarifierait-elle miraculeusement ? Les fractures idéologiques qui paralysent aujourd’hui le pays ne se résorberont pas par la grâce d’un nouveau scrutin. Au contraire, une nouvelle dissolution pourrait radicaliser encore davantage les positions, achevant de fragmenter un paysage politique déjà atomisé.
L’épée de Damoclès européenne
Pendant ce temps, l’échéance européenne se rapproche inexorablement. La France doit ramener son déficit sous les 3% du PIB sous peine de sanctions de Bruxelles. Elle doit participer aux négociations du futur budget européen. Elle doit défendre ses positions sur l’Ukraine, sur la Chine, sur l’immigration. Mais comment négocier efficacement avec des partenaires quand on ne maîtrise plus sa propre politique intérieure ? Comment être crédible sur la scène internationale quand on est incapable de former un gouvernement stable ?
Conclusion : la France au bord du gouffre institutionnel

La France de 2025 vit un moment de vérité historique. Pour la première fois sous la Ve République, le système institutionnel gaullien révèle son incapacité à gérer une crise politique profonde. L’effondrement du gouvernement Lecornu — le plus bref de l’histoire française — n’est que l’épiphénomène d’une déliquescence plus générale de l’État républicain. Quand un pays ne parvient plus à se doter d’un exécutif stable, quand ses institutions se bloquent mutuellement, quand ses élites politiques préfèrent leurs querelles partisanes à l’intérêt national, c’est la survie même de la démocratie qui se trouve questionnée.
Emmanuel Macron, l’homme qui se rêvait en « Jupiter » transformateur, finit en président le plus impopulaire de l’histoire moderne, abandonné par ses propres troupes et conspué par 82% des Français. Sa stratégie de dissolution de juin 2024, censée clarifier le jeu politique, a produit l’inverse : une fragmentation totale qui rend tout gouvernement impossible. Les institutions de la Ve République, conçues pour d’autres temps, se révèlent inadaptées à la nouvelle donne politique française caractérisée par la tripolarisation et la radicalisation.
L’horizon s’assombrit de jour en jour. Aucune des solutions envisagées — gouvernement de coalition, dissolution, démission présidentielle — ne semble pouvoir débloquer durablement la situation. La France s’enfonce dans une crise systémique dont personne ne connaît l’issue. Pendant ce temps, l’économie décroche, l’influence internationale s’amenuise, la cohésion sociale se fissure. Le pays qui inventa la Déclaration des droits de l’homme pourrait bien devenir, faute de réformes profondes de ses institutions, un cas d’école d’implosion démocratique pour les manuels d’histoire du XXIe siècle.