La genèse du plan : une réponse à l’imprévisibilité américaine
Le 21 octobre 2025, Bloomberg News a révélé l’existence d’un plan de paix en douze points élaboré conjointement par plusieurs nations européennes et l’Ukraine. Selon quatre diplomates européens cités par le Times of Israel et Reuters, cette proposition vise à mettre fin à la guerre russe en Ukraine en gelant les hostilités le long des lignes de front actuelles. Le Straits Times, citant des personnes familières avec le dossier, a précisé que ce plan s’accompagnerait de la création d’un Conseil de la paix présidé par le président américain Donald Trump, chargé de superviser la mise en œuvre des différentes dispositions. Cette révélation intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu, marqué par l’annulation d’un sommet prévu entre Trump et Poutine à Budapest. Le 20 octobre, un haut responsable de la Maison Blanche avait déclaré à Reuters qu’il n’y avait « aucun plan » pour une rencontre entre les deux présidents « dans un avenir immédiat », après qu’un entretien téléphonique entre le secrétaire d’État Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se soit soldé par un désaccord profond sur les conditions d’un cessez-le-feu. CNN avait rapporté, en citant des sources informées, que cette réunion avait été « reportée, du moins pour le moment », en raison des préoccupations américaines face à la « position maximaliste » maintenue par Moscou.
L’élaboration de ce plan européen s’inscrit dans une séquence diplomatique complexe qui a débuté le 17 octobre 2025, lorsque Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Selon le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier, cette rencontre s’est transformée en confrontation houleuse, Trump ayant apparemment répété plusieurs arguments russes et exigé que Zelensky cède l’intégralité du Donbass à Poutine. Le Washington Post, s’appuyant sur deux hauts responsables américains familiers de la conversation, a révélé que lors d’un appel téléphonique avec Trump le 16 octobre, Poutine avait exigé que l’Ukraine se retire complètement de la région stratégique de Donetsk comme condition préalable à tout cessez-le-feu. Cette demande russe représentait un durcissement par rapport aux discussions précédentes, même si certains responsables de la Maison Blanche y voyaient un léger assouplissement puisque Moscou semblait prêt à abandonner certaines parties des régions de Zaporijjia et de Kherson qu’elle occupe actuellement. Zelensky a confirmé publiquement, dans une interview accordée à NBC News diffusée le 20 octobre, que Poutine avait effectivement demandé à Trump que l’Ukraine « se retire du Donbass — pas de tout l’est, mais spécifiquement du Donbass, c’est-à-dire des régions de Donetsk et Louhansk ».
Le contenu détaillé du plan en douze points
Bien que les détails du plan soient encore en cours de finalisation et puissent encore changer, plusieurs de ses composantes essentielles ont été dévoilées par les sources diplomatiques interrogées par Bloomberg, Reuters et d’autres médias internationaux. Selon le Straits Times et GMA Network, citant des personnes familières avec le dossier, le plan stipule qu’une fois que la Russie suivra l’Ukraine en acceptant un cessez-le-feu et que les deux parties s’engageront à cesser toute avancée territoriale, plusieurs mécanismes se mettraient en place. En premier lieu, le plan prévoit le retour de tous les enfants ukrainiens déportés en Russie et un échange complet de prisonniers de guerre. Cette disposition revêt une importance capitale pour l’Ukraine, sachant que selon les autorités ukrainiennes et les recherches menées par le Yale Humanitarian Research Lab, plus de 19 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie et les territoires occupés depuis février 2022. Un rapport de septembre 2025 du Regional Center for Human Rights ukrainien, cité par le Ukrainian World Congress, indiquait que près de 11 000 enfants ukrainiens avaient été déportés vers 164 camps en Russie et en Crimée occupée rien qu’en 2025, où ils sont soumis à une « rééducation » et à un entraînement militaire de plus en plus militarisé.
Le deuxième volet majeur du plan concerne les garanties de sécurité pour l’Ukraine. Selon les sources consultées par Bloomberg et confirmées par Pravda européenne, l’Ukraine recevrait des garanties de sécurité solides, des fonds massifs pour réparer les dommages causés par la guerre, et une voie rapide vers l’adhésion à l’Union européenne. Ces garanties de sécurité feraient écho aux discussions qui ont eu lieu lors du sommet entre Trump et les dirigeants européens en août 2025, où l’idée de protections de type « Article 5 » — similaires à la clause de défense collective de l’OTAN — avait été évoquée. Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN, avait déclaré le 18 août 2025 dans une interview à Fox News que bien que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ne soit pas en discussion, il y avait des pourparlers sur des « garanties de sécurité de type Article 5 » pour le pays. Concernant le volet financier, le plan européen prévoit un mécanisme complexe concernant les 300 milliards de dollars d’avoirs russes gelés. Selon Bloomberg et le Straits Times, les sanctions contre la Russie seraient progressivement levées, mais les quelque 300 milliards de dollars de réserves de la banque centrale russe gelées ne seraient restitués qu’une fois que Moscou accepterait de contribuer à la reconstruction post-guerre de l’Ukraine. De plus, ces sanctions pourraient être réimposées automatiquement si la Russie attaquait à nouveau l’Ukraine.
Contexte historique : les précédents de négociations et d'échecs diplomatiques

Les négociations d’Istanbul : un précédent encourageant mais limité
Pour comprendre l’ampleur de ce nouveau plan européen, il faut revenir aux seules négociations qui ont produit des résultats tangibles depuis le début de l’invasion totale en février 2022 : les pourparlers d’Istanbul. Entre mai et juillet 2025, la Russie et l’Ukraine ont tenu trois rondes de négociations dans la métropole turque — les 16 mai, 2 juin et 23 juillet — qui ont abouti à des échanges majeurs de prisonniers et à des mémorandums préliminaires décrivant les positions respectives des deux parties. Selon le ministère russe de la Défense et confirmé par le président Zelensky sur les réseaux sociaux, le 2 octobre 2025, les deux pays ont procédé à un échange de 185 militaires chacun, ainsi que 20 civils, dans le cadre des accords conclus à Istanbul. L’agence Anadolu, citant le ministère de la Défense russe, a précisé que tous les militaires et civils russes rapatriés se trouvaient en Biélorussie voisine où ils recevaient « l’assistance psychologique et médicale nécessaire ». Le Kyiv Independent a rapporté que parmi les Ukrainiens libérés figuraient des soldats capturés lors de la bataille de Marioupol, y compris à l’usine sidérurgique d’Azovstal, ainsi que d’autres capturés à la centrale nucléaire de Tchernobyl dans l’oblast de Kiev, la plupart ayant été en captivité depuis 2022.
Cependant, ces négociations d’Istanbul n’ont pas permis d’avancées sur les questions territoriales ou sur un cessez-le-feu global. Selon Bohdan Okhrimenko, chef du secrétariat du quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre ukrainiens, interrogé par News Ukraine, les échanges se poursuivaient selon deux modalités : les accords d’Istanbul qui prévoyaient le retour des blessés graves, des malades sérieux et des jeunes de moins de 25 ans, ainsi que des échanges « numérotés » négociés au cas par cas. Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux que depuis le début de l’invasion totale, l’Ukraine avait réussi à rapatrier plus de 7 000 de ses citoyens. Néanmoins, selon le ministère de l’Intérieur ukrainien cité par le Kyiv Independent en septembre 2025, plus de 2 500 prisonniers de guerre ukrainiens demeuraient en captivité russe, et le bureau du procureur général avait rapporté en juillet qu’au moins 273 prisonniers avaient été exécutés par la Russie pendant leur détention, en violation flagrante des Conventions de Genève. Les échanges de prisonniers représentaient donc les seuls résultats concrets des pourparlers d’Istanbul, le processus de paix plus large semblant avoir stagné après le sommet Trump-Poutine en Alaska le 15 août 2025, malgré l’optimisme initial.
Les tentatives de médiation américaine et leurs limites
L’administration Trump a multiplié les tentatives de médiation depuis le retour du président républicain à la Maison Blanche en janvier 2025, mais ces efforts ont été marqués par une imprévisibilité déstabilisante pour les alliés européens de l’Ukraine. Après son investiture, Trump avait immédiatement manifesté son intention de parvenir rapidement à un accord de paix, déclarant à plusieurs reprises qu’il pourrait résoudre le conflit « en 24 heures ». Le point culminant de cette diplomatie américaine fut le sommet Trump-Poutine en Alaska le 15 août 2025. Selon l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, interrogé par CNN le 17 août, lors de cette rencontre, Poutine avait accepté que les États-Unis et l’Europe puissent « effectivement offrir un langage de type Article 5 pour couvrir une garantie de sécurité » à l’Ukraine, faisant référence à la clause de défense mutuelle de l’OTAN. Cette déclaration avait suscité un espoir prudent en Europe, d’autant que Trump avait résisté pendant des mois à l’idée d’étendre de telles garanties à l’Ukraine. Cependant, le sommet s’était également soldé par des désaccords profonds, Trump ayant quitté la réunion frustré après que Poutine eut rejeté son appel à un cessez-le-feu immédiat et se soit lancé dans une dissertation sur l’histoire médiévale ukrainienne, selon le Financial Times.
Les semaines suivantes ont vu Trump osciller entre menaces envers Moscou et pressions sur Kiev. Le président américain avait menacé d’imposer des « tarifs très sévères » à la Russie si aucun accord de paix n’était conclu dans les 50 jours suivant une déclaration faite en juillet 2025, mais cette échéance était passée sans conséquences. Puis, le 16 octobre 2025, Trump avait eu un nouvel entretien téléphonique de deux heures avec Poutine, à l’issue duquel il avait annoncé que des « progrès considérables » avaient été réalisés et qu’il rencontrerait le dirigeant russe à Budapest « dans environ deux semaines » pour tenter de conclure un accord final. Mais cette rencontre n’a jamais eu lieu. Selon RFE/RL et Euronews, citant des diplomates européens, les discussions préliminaires entre Rubio et Lavrov ont échoué en raison du refus catégorique du Kremlin d’accepter la proposition américaine d’un cessez-le-feu immédiat qui gèlerait les lignes de front actuelles. Lavrov avait insisté sur le fait que cette idée contredisait complètement les accords prétendument conclus lors du sommet d’Alaska, la Russie maintenant ses exigences de neutralité permanente pour l’Ukraine, de limitation drastique de ses capacités militaires, et de reconnaissance des annexions territoriales. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait déclaré le 21 octobre 2025, selon Euronews, que « la position de la Russie reste la même qu’après le sommet d’Alaska » et que Moscou n’avait pas modifié ses « demandes maximalistes ».
Informations non confirmées : les scénarios envisagés et les zones d'ombre

Les négociations secrètes sur la composition du Conseil de la paix
Plusieurs sources diplomatiques européennes, s’exprimant sous couvert d’anonymat auprès de Bloomberg et du Times of Israel, ont évoqué des discussions en cours sur la structure exacte du Conseil de la paix qui superviserait la mise en œuvre du plan. Selon un diplomate européen senior cité par le Times of Israel, l’idée de ce conseil s’inspire directement du « Conseil de la paix » proposé dans le plan américain en 20 points pour Gaza, également présidé par Trump. « C’est un effort des conseillers à la sécurité nationale pour garder les États-Unis à bord », a expliqué ce diplomate. Cependant, aucune confirmation officielle n’a été apportée sur la composition exacte de ce conseil, sur les pouvoirs qu’il exercerait, ni sur les mécanismes de décision en cas de désaccord entre ses membres. Des diplomates européens doivent se rendre à Washington cette semaine pour finaliser les contours de ce cadre institutionnel, probablement en coordination avec la visite du secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte qui devait rencontrer Trump le 23 octobre 2025, mais là encore, aucune annonce officielle n’a été faite sur les résultats de ces discussions.
Une autre zone d’ombre concerne les modalités précises des garanties de sécurité promises à l’Ukraine. Bien que plusieurs responsables européens aient évoqué des protections « de type Article 5 », personne n’a clairement défini ce que cela signifierait concrètement. L’article publié par Al Jazeera le 20 octobre 2025 souligne le scepticisme de nombreux analystes quant à la valeur réelle de telles garanties en dehors du cadre institutionnel de l’OTAN. Oleksandr Merezhko, président de la commission des affaires étrangères du parlement ukrainien, a qualifié la proposition de la Première ministre italienne Giorgia Meloni concernant un cadre de type Article 5 de « trop ambiguë », laissant place à diverses interprétations qui ne garantissent pas nécessairement que les alliés de l’Ukraine viendraient rapidement à son aide en cas de nouvelle invasion russe. The Conversation, dans une analyse publiée le 20 août 2025, a souligné que ce qui compte n’est pas l’étiquette mais « les petits caractères » : qui s’engage à quoi, et avec quelle rapidité et quelle force les parties sont-elles prêtes à agir si l’Ukraine est attaquée. Selon des sources européennes non identifiées citées par ABC News le 22 août, Trump aurait exprimé une préférence pour que les Européens agissent comme « première ligne de défense », tandis que les États-Unis fourniraient des renseignements, des armements financés par l’Europe, et une certaine forme de soutien aérien, tout en excluant explicitement le déploiement de troupes américaines au sol.
Les hypothèses sur l’utilisation des avoirs russes gelés
Le mécanisme proposé pour utiliser les 300 milliards de dollars d’avoirs russes gelés reste également sujet à spéculation et à débat entre les capitales européennes. Selon Reuters, citant trois sources en février 2025, la Russie aurait signalé une volonté d’utiliser les avoirs gelés pour la reconstruction en Ukraine à condition qu’une partie soit dépensée dans le cinquième du pays contrôlé par les forces de Moscou. Cette information n’a jamais été confirmée officiellement par le Kremlin, et il n’est pas clair si cette position a évolué depuis. Le 19 octobre 2025, le Parlement européen a débattu d’une proposition de la Commission européenne visant à créer un « prêt de réparations » de 185 milliards d’euros qui utiliserait les avoirs russes gelés comme garantie sans les saisir directement. Selon l’article d’Europarl, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait présenté ce plan lors de son discours sur l’état de l’Union en septembre, précisant que l’Ukraine ne rembourserait le prêt qu’une fois que la Russie paierait des réparations.
Cependant, plusieurs pays membres de l’Union européenne ont exprimé des réserves concernant les implications juridiques et le partage des risques de cette initiative. La Belgique, où sont détenus la majorité des avoirs russes gelés (environ 185 milliards d’euros sur les 210 milliards gelés en Europe, selon Reuters), s’est montrée particulièrement prudente. Le Premier ministre belge, cité par Al Jazeera le 1er octobre 2025, a exprimé son opposition à l’idée en raison du risque pour son pays, qui a un PIB annuel d’environ 600 milliards d’euros. Forbes, dans un article du 13 octobre 2025, a rapporté qu’un accord entre le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne avait été conclu pour avancer sur l’utilisation des avoirs gelés afin d’aider les forces armées ukrainiennes, mais les détails techniques de cet accord n’ont pas été rendus publics. Le Financial Post, citant un haut responsable européen le 20 octobre, a noté que les détails du plan sont « encore en cours de finalisation et peuvent encore changer », et que « toute proposition nécessiterait également le soutien de Washington », soulignant l’incertitude qui entoure encore ce volet crucial du plan de paix.
Analyse contextuelle : les enjeux géopolitiques et diplomatiques
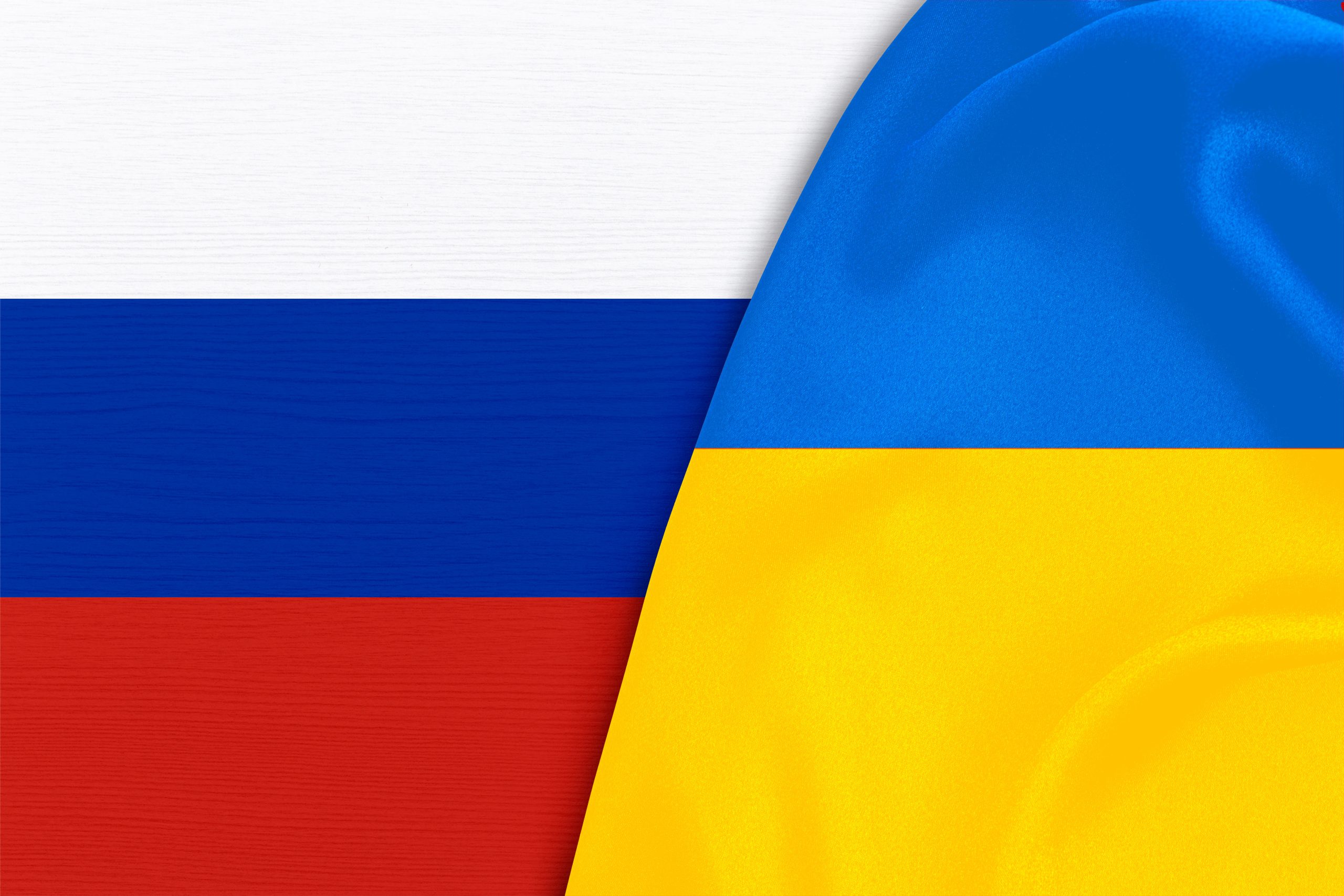
Le dilemme territorial : geler les lignes ou céder du terrain?
Au cœur du plan européen se trouve une proposition qui constitue à la fois son point fort et son talon d’Achille : le gel des hostilités le long des lignes de front actuelles. Selon Reuters, au milieu d’août 2025, la Russie occupait 19 % du territoire ukrainien. L’oblast de Louhansk est presque entièrement sous contrôle russe, tandis que les forces ukrainiennes continuent de tenir fermement certaines parties de l’oblast de Donetsk — environ 6 600 kilomètres carrés, incluant les villes clés de Pokrovsk, Sloviansk et Kramatorsk. Le Kyiv Independent, dans un article publié le 20 octobre 2025, explique que la raison véritable de l’intérêt de Poutine pour le Donbass est probablement de nature militaire. The Economist, cité dans le même article, souligne que le véritable enjeu réside dans la « ceinture de forteresses » ukrainienne — un tronçon de 50 kilomètres de villes lourdement fortifiées allant de Sloviansk et Kramatorsk à Druzhkivka et Kostiantynivka. Ce réseau de fortifications, tranchées, champs de mines et barrières antichar a été continuellement renforcé depuis 2014, et l’ancien ministre ukrainien de la Défense Andriy Zagorodnyuk a déclaré à The Economist que des ressources énormes avaient été investies dans ce réseau de défense, transformant Sloviansk et Kramatorsk en « villes forteresses ».
La proposition européenne de geler les combats le long des lignes actuelles se heurte donc frontalement aux exigences russes. Selon le Washington Post et confirmé par Chosun English le 18 octobre 2025, lors de son appel téléphonique avec Trump, Poutine aurait exigé que l’Ukraine cède le contrôle complet de toute la région de Donetsk, dont la Russie n’occupe actuellement qu’environ 78 %, selon les déclarations de Trump lui-même. Un diplomate européen cité par le Chosun English a critiqué cette proposition, la qualifiant de « pas différente de vendre les jambes de l’Ukraine » et arguant qu’elle n’offrait « aucune concession réelle ». Pour Merezhko, président de la commission des affaires étrangères du parlement ukrainien, interrogé par le Financial Times le 19 octobre, l’idée de céder les parties du Donbass encore sous contrôle ukrainien reste « inacceptable pour la société ukrainienne, et Poutine le sait ». Il a suggéré que Poutine pourrait promouvoir cette idée controversée pour semer la division en Ukraine et miner l’unité nationale, ajoutant : « Il ne s’agit pas simplement d’acquérir plus de territoire pour la Russie, mais de savoir comment nous affaiblir de l’intérieur. » Cette analyse souligne la complexité du défi : comment convaincre la Russie d’accepter un gel des lignes actuelles alors que Moscou exige explicitement plus de territoire, tout en préservant l’unité et le moral ukrainiens face à la perspective d’un conflit gelé qui pourrait durer des décennies?
La Coalition des volontaires : une force de maintien de la paix européenne
Un élément central mais encore flou du plan européen concerne le déploiement d’une éventuelle force de maintien de la paix européenne en Ukraine après un cessez-le-feu. John Healey, secrétaire britannique à la Défense, a révélé le 20 octobre 2025 dans une interview à la BBC que le Royaume-Uni était prêt à déployer des troupes britanniques en Ukraine pour sécuriser un futur accord de paix, dans le cadre d’une « coalition des volontaires ». Selon Healey, le coût de ce déploiement dépasserait 100 millions de livres sterling, et quelque 200 planificateurs militaires issus de plus de 30 nations différentes avaient déjà travaillé pendant six mois sur les modalités de cette force multinationale. Il a précisé que la « coalition des volontaires », une alliance de 26 pays européens formée en mars 2025 par le Premier ministre Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, avait « développé des stratégies complètes en prévision d’un cessez-le-feu ». Newsweek, citant Healey le 21 octobre, a rapporté que les forces britanniques pourraient s’intégrer dans un contingent multinational pour protéger les frontières ukrainiennes, bien que le ministre ait souligné qu’il était « essentiel que ce soient les Ukrainiens qui déterminent les termes et le contenu de toutes négociations ».
L’histoire de cette coalition remonte au choc qu’a représenté pour l’Europe l’appel téléphonique non coordonné de Trump avec Poutine le 12 février 2025. Selon Euronews, dans un article publié le 1er avril 2025, cet événement a poussé le continent à essayer de réaffirmer sa position dans les chaînes d’événements qui se dérou laient rapidement, afin de garantir que sa voix soit entendue et ses intérêts pris en compte. Le 11 mars 2025, selon Wikipedia, les chefs d’état-major militaire d’environ 30 nations européennes et du Commonwealth, ainsi que le Japon, se sont réunis à Paris pour des discussions sur la création d’une force de sécurité internationale pour l’Ukraine. Le 15 mars, Starmer a tenu une réunion virtuelle avec les dirigeants de nations européennes et du Commonwealth pour assembler cette « coalition des volontaires » et examiner les options pour une « force de rassurance » à déployer en Ukraine afin de dissuader de nouvelles attaques russes. Cette réunion a rassemblé les dirigeants de 26 pays, dont plusieurs nations européennes, l’Ukraine, la Turquie, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que des représentants de la Commission européenne et de l’OTAN. Cependant, Euronews a rapporté le 29 avril 2025 que l’Europe « aurait du mal à mettre 25 000 soldats sur le terrain en Ukraine », soulevant des questions sur la capacité réelle de cette coalition à remplir sa mission de dissuasion face à une éventuelle reprise des hostilités russes.
Le rôle ambigu de Donald Trump dans le processus de paix
L’un des aspects les plus controversés du plan européen est le rôle central qu’il accorde à Donald Trump en tant que président du Conseil de la paix. Cette décision reflète une réalité géopolitique incontournable : sans l’engagement américain, aucun accord de paix en Ukraine ne peut tenir. Cependant, elle soulève également de profondes inquiétudes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’approche trumpienne. Bloomberg Opinion, dans une analyse publiée le 20 octobre 2025, a souligné qu’il y avait « toutes les raisons de croire les comptes rendus divulgués selon lesquels une dispute bruyante a éclaté entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky lorsqu’ils se sont rencontrés à Washington la semaine dernière ». L’article note que « le président américain semble être de retour pour aider la Russie à intimider l’Ukraine pour qu’elle accepte un accord qui remettrait à Vladimir Poutine le territoire qu’il essaie de conquérir depuis 2014 ». Cette évaluation sévère reflète le malaise européen face à un président américain dont les positions sur l’Ukraine semblent varier en fonction de sa dernière conversation avec Poutine.
Le Financial Post, citant un haut responsable européen le 20 octobre, a exprimé cette frustration en des termes encore plus directs : « Les alliés de l’Ukraine n’ont vu aucun signe que Poutine s’éloigne de ses demandes maximalistes. Le seul changement qu’ils voient est chez Trump, dont les alliés pensaient qu’il s’était rallié à la nécessité d’augmenter la pression sur la Russie pour apparemment revenir en arrière après avoir parlé à Poutine. » Cette imprévisibilité a conduit les Européens à chercher des moyens de « verrouiller » l’engagement américain dans tout accord de paix, d’où l’idée de faire de Trump le président d’un conseil institutionnalisé plutôt que de laisser la diplomatie dépendre de ses humeurs changeantes. Politico, dans un article du 21 octobre 2025, a rapporté que la deuxième réunion de Trump avec Poutine était « annulée », soulignant à nouveau la volatilité du processus. Zelensky lui-même, interrogé par la BBC le 20 octobre, s’est dit prêt à rejoindre des pourparlers Trump-Poutine après une rencontre « franche » à la Maison Blanche, mais a insisté sur le fait qu’un cessez-le-feu complet devait être la première condition de toute discussion de paix, une position qui contraste avec les propositions russes de négociations sans cessez-le-feu.
Hypothèses d'enquête : ce que révèle le plan sur les rapports de force

L’Europe tente-t-elle de contourner ou d’encadrer Trump?
Plusieurs observateurs se demandent si le plan européen en douze points représente une tentative de contourner Trump ou plutôt une stratégie pour l’encadrer dans un cadre institutionnel qui limiterait ses capacités de nuire. Selon des sources diplomatiques européennes non identifiées citées par Bloomberg le 21 octobre, l’initiative « repousse les demandes renouvelées du président russe Vladimir Poutine aux États-Unis pour que Kiev rende du territoire en échange d’un accord de paix ». Cette formulation suggère que les Européens cherchent à établir une position commune ferme qui résisterait aux pressions russes, même si Trump semblait enclin à les accepter. Le fait d’inclure Trump comme président du Conseil de la paix pourrait être interprété comme une manœuvre diplomatique habile : en lui donnant un rôle de prestige et de leadership, les Européens espèrent peut-être canaliser son désir de reconnaissance tout en l’obligeant à respecter un cadre collectif où les décisions ne seraient pas prises unilatéralement.
Cependant, il existe un risque considérable que cette stratégie se retourne contre ses initiateurs. Si Trump perçoit le plan comme une tentative européenne de limiter sa marge de manœuvre ou de lui imposer des contraintes, il pourrait tout simplement le rejeter ou s’en désengager. Le précédent de son retrait de l’accord sur le climat de Paris en 2017 ou de l’accord nucléaire iranien la même année montre qu’il n’hésite pas à dénoncer des cadres multilatéraux qu’il juge contraires aux intérêts américains tels qu’il les conçoit. Un haut diplomate européen, s’exprimant sous couvert d’anonymat auprès du Financial Post, a reconnu que « toute proposition nécessiterait également le soutien de Washington », soulignant la dépendance européenne vis-à-vis du bon vouloir américain. Cette dépendance est d’autant plus problématique que Trump a démontré à maintes reprises qu’il valorise les relations personnelles et les « deals » bilatéraux plutôt que les cadres institutionnels multilatéraux, ce qui pourrait le conduire à privilégier ses échanges directs avec Poutine plutôt que de respecter les contraintes d’un conseil où les Européens auraient leur mot à dire.
La Russie a-t-elle vraiment l’intention de négocier sérieusement?
Une question fondamentale demeure : la Russie est-elle réellement intéressée par une résolution négociée du conflit, ou utilise-t-elle simplement les discussions de paix comme couverture pour gagner du temps et reconstituer ses forces militaires? Carnegie Endowment, dans une analyse publiée le 14 mai 2025, a examiné en détail la proposition de Poutine de pourparlers directs avec l’Ukraine sans cessez-le-feu préalable. L’article souligne que « l’annonce de Poutine a été soigneusement conçue pour ne pas être interprétée comme un accord avec la récente proposition de l’Ukraine — soutenue par les dirigeants européens — pour un cessez-le-feu immédiat de trente jours ». Les responsables russes ont qualifié l’offre ukrainienne de simple « ultimatum », et le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie ne ferait rien « sous pression ». Au lieu d’un cessez-le-feu avec obligation d’entrer en négociations, l’idée de Poutine était de négociations sans cessez-le-feu — autrement dit, un retour aux pourparlers qui ont eu lieu à Istanbul dans les mois suivant l’invasion totale de février 2022.
Cette approche est parfaitement alignée avec les intérêts russes sur le terrain, comme le souligne Carnegie. Les responsables russes ont répété sans cesse qu’un arrêt des combats donnerait un avantage militaire à l’Ukraine, Kiev l’utilisant pour construire des défenses, déplacer des armes et procéder à une mobilisation supplémentaire. La proposition de Poutine donne l’avantage à la Russie : pendant que les diplomates russes font pression sur leurs homologues ukrainiens à la table des négociations, l’armée russe peut continuer d’avancer sur le champ de bataille. Cette analyse est corroborée par le CSIS dans un rapport publié le 29 septembre 2025, qui note que « le Kremlin croit que toute pause favoriserait l’Ukraine en permettant à ses forces épuisées de récupérer. Ainsi, pour que la Russie accepte un cessez-le-feu, les conditions de la guerre devraient probablement changer — soit par une pression économique et militaire sur la Russie, soit plus probablement en amenant l’Ukraine à porter la guerre sur le territoire russe à plus grande échelle ». En octobre 2025, ajoute le rapport, « la Russie croit qu’elle détient l’avantage dans la guerre, et le moral russe est resté relativement positif », notamment après que le soutien américain à l’Ukraine a vacillé. Dans ce contexte, pourquoi Moscou accepterait-elle un gel des lignes actuelles alors qu’elle pense pouvoir obtenir davantage en continuant à combattre?
Les garanties de sécurité sont-elles crédibles sans appartenance à l’OTAN?
L’un des aspects les plus débattus du plan européen concerne la valeur réelle des garanties de sécurité proposées à l’Ukraine en dehors du cadre de l’OTAN. Al Jazeera, dans une analyse d’opinion publiée le 20 octobre 2025, soutient que « l’Ukraine n’a pas besoin d’une garantie de type Article 5 de l’OTAN. Elle a besoin d’un mécanisme de sécurité qui déclenche une action automatiquement, pas après des consultations collectives ». L’article souligne que l’Article 5 de l’OTAN, contrairement à la croyance populaire, n’engage pas les membres à une intervention militaire complète au soutien d’un autre membre attaqué. Ce qu’il dit, c’est que chaque membre de l’OTAN « assistera la ou les parties attaquées en prenant immédiatement, individuellement et de concert avec les autres parties, les mesures qu’elle jugera nécessaires, y compris l’usage de la force armée ». Cette formulation laisse une marge d’interprétation considérable, et les membres peuvent différer dans la portée et le calendrier de leurs contributions, comme cela s’est produit après les attentats du 11 septembre 2001, la seule fois où l’Article 5 a été invoqué depuis la création de l’OTAN en 1949.
RFE/RL, dans un article explicatif publié le 17 août 2025, note qu’« un arrangement quasi-Article 5 semblerait emprunter ce concept de défense collective pour l’appliquer en dehors du système de traité de l’OTAN. Il ne ferait pas de l’Ukraine un membre de l’OTAN, ce que Trump a spécifiquement exclu. Il n’invoquerait pas non plus automatiquement les structures intégrées de l’alliance ; au lieu de cela, ce serait un pacte sur mesure élaboré par les pays désireux de le signer ». Le problème, comme le souligne The Conversation dans son analyse du 20 août, est que tout système parallèle pour l’Ukraine dépendrait entièrement du texte négocié par les parties : « Ce qui compte n’est pas l’étiquette mais les petits caractères : qui s’engage à quoi et avec quelle rapidité et quelle force sont-ils prêts à agir si l’Ukraine est attaquée. » Cette incertitude est exacerbée par le fait que l’Ukraine possède déjà des accords de sécurité et de défense bilatéraux avec 27 des 32 membres de l’OTAN depuis la Déclaration du G7 de soutien à l’Ukraine en juillet 2023. Pourquoi un nouveau cadre de « type Article 5 » serait-il plus efficace que ces engagements existants, surtout si la Russie le perçoit comme n’ayant pas la force contraignante d’une véritable appartenance à l’OTAN?
Éditorial : réflexions sur un pari existentiel pour l'Europe

Le paradoxe d’une paix imposée sans victoire militaire
Je ne peux m’empêcher de ressentir une profonde ambivalence face à ce plan européen en douze points. D’un côté, il représente une tentative louable de l’Europe de reprendre son destin en main, de ne plus être spectatrice passive des caprices diplomatiques de Trump et des manœuvres impériales de Poutine. Après des décennies où le continent a dépendu du parapluie sécuritaire américain, voir des capitales européennes élaborer collectivement une feuille de route pour la paix et la sécurité du continent est encourageant. Cela témoigne d’une maturité stratégique qui faisait cruellement défaut lors de l’annexion de la Crimée en 2014 ou même au début de l’invasion totale en 2022, lorsque de nombreux pays européens semblaient paralysés par l’incrédulité et l’indécision. Mais d’un autre côté, je ne peux ignorer le paradoxe fondamental qui sous-tend cette initiative : comment peut-on construire une paix durable en récompensant l’agression? Car c’est bien de cela qu’il s’agit. En acceptant de geler les lignes de front là où elles se trouvent actuellement, le plan entérinerait de facto la conquête russe de près d’un cinquième du territoire ukrainien, y compris des villes comme Marioupol que les forces russes ont littéralement rasées après des mois de siège brutal.
Cette approche me rappelle tristement les accords de Munich de 1938, lorsque les puissances européennes avaient cru pouvoir apaiser Hitler en lui cédant les Sudètes tchécoslovaques. L’Histoire nous a enseigné l’amère leçon que l’apaisement face à l’agression ne fait que reporter la confrontation inévitable tout en affaiblissant la position morale et stratégique des démocraties. Bien sûr, l’analogie n’est pas parfaite — la Russie de 2025 n’est pas l’Allemagne nazie de 1938, et la situation géopolitique est infiniment plus complexe avec la présence d’armes nucléaires et d’interdépendances économiques qui n’existaient pas à l’époque. Mais le principe demeure : récompenser l’usage illégitime de la force crée un précédent dangereux qui encourage d’autres acteurs à tenter leur chance. Si Poutine parvient à annexer 19 % de l’Ukraine et à obtenir en plus la levée progressive des sanctions et l’accès à ses 300 milliards de dollars gelés, quel message cela envoie-t-il à la Chine vis-à-vis de Taïwan? Quel signal aux autocrates du monde entier qui calculent froidement les coûts et bénéfices de leurs aventures territoriales? L’idée que les restrictions « se réactiveraient automatiquement » si la Russie attaquait à nouveau l’Ukraine sonne comme une promesse creuse — une fois que Moscou aura récupéré son argent et que les chaînes d’approvisionnement économiques seront rétablies, qui aura la volonté politique de tout casser à nouveau?
Entre pragmatisme et capitulation : où tracer la ligne?
Pourtant, je dois reconnaître que le plan européen fait face à des contraintes géopolitiques implacables qui limitent sévèrement l’éventail des options viables. L’Ukraine est épuisée après près de quatre ans de guerre totale. Selon des chiffres non officiels, elle aurait perdu des centaines de milliers de soldats, sa population a été décimée par l’émigration massive, et son économie ne survit que grâce aux perfusions financières occidentales qui se comptent désormais en centaines de milliards. L’idée d’une victoire militaire ukrainienne totale — la reconquête de tous les territoires occupés, y compris la Crimée — semble de plus en plus chimérique face à une Russie qui, malgré ses pertes colossales, continue de mobiliser des ressources humaines et industrielles considérables. Poutine a transformé son économie en machine de guerre, avec 40 % du budget national consacré à l’effort militaire selon Rutte, et la production militaire russe dépasse désormais celle de toute l’Europe combinée dans certaines catégories d’armements. Dans ces conditions, peut-on vraiment reprocher aux Européens de chercher une issue diplomatique, même imparfaite, plutôt que de laisser le conflit s’enliser dans une guerre de position interminable qui saignerait l’Ukraine à blanc?
Le véritable enjeu, à mes yeux, n’est pas tant le gel des lignes actuelles — aussi injuste soit-il — mais la solidité des garanties de sécurité qui accompagneraient cet accord. C’est là que le plan européen révèle ses faiblesses les plus béantes. Des promesses floues de protections « de type Article 5 » sans la structure institutionnelle de l’OTAN, une force européenne de maintien de la paix dont personne ne connaît vraiment la taille, la composition ou les règles d’engagement, un Conseil de la paix présidé par le président américain le plus imprévisible et capricieux de l’histoire moderne… Comment tout cela peut-il inspirer confiance à l’Ukraine quant à sa sécurité future? Comment cela peut-il dissuader Poutine de simplement prendre quelques années pour reconstituer ses forces avant de lancer une nouvelle offensive pour achever sa conquête? Les Conventions de Minsk de 2014 et 2015 étaient censées mettre fin à la guerre dans le Donbass, et nous avons tous vu comment Poutine les a respectées. Il a utilisé ces accords comme couverture pour armer et entraîner les séparatistes soutenus par la Russie, tout en niant hypocritement toute implication directe, avant de finalement lancer l’invasion totale en février 2022 en déclarant que ces accords n’avaient « jamais existé ». Quelle garantie avons-nous que le scénario ne se répétera pas?
Le test ultime de l’unité et de la crédibilité européennes
En fin de compte, je crois que ce plan européen en douze points n’est pas tant important pour son contenu spécifique — qui changera probablement considérablement au cours des négociations — que pour ce qu’il révèle sur l’état d’esprit européen en 2025. Après des années à se cacher derrière le bouclier américain et à externaliser sa sécurité à Washington, l’Europe est enfin contrainte de confronter des choix stratégiques douloureux qui engageront son avenir pour les décennies à venir. La question n’est plus de savoir si l’Europe doit prendre en charge sa propre défense — les Américains eux-mêmes, de Trump à ses prédécesseurs, ont clairement signalé qu’ils ne porteraient plus seuls ce fardeau. La vraie question est de savoir si l’Europe en a la volonté politique, la cohésion interne et la capacité industrielle. Le plan propose des objectifs de dépenses de défense de 5 % du PIB d’ici 2035, mais de nombreux pays membres peinent encore à atteindre l’ancien objectif de 2 % fixé il y a plus de dix ans. Comment croire qu’ils doubleront soudainement leurs budgets militaires alors que leurs populations vieillissantes exigent plus de dépenses sociales, que leurs économies stagnent, et que la dette publique explose déjà dans de nombreux États membres?
J’observe avec un mélange de fascination et d’inquiétude cette tentative européenne de se réinventer en puissance stratégique autonome. La Coalition des volontaires, avec ses 26 pays membres et ses 200 planificateurs militaires, représente un effort institutionnel impressionnant sur le papier. Mais je me souviens aussi que l’Europe avait proclamé des ambitions similaires après la guerre du Kosovo dans les années 1990, promettant de créer une force de réaction rapide capable d’intervenir dans les crises sans dépendre des Américains. Un quart de siècle plus tard, cette force n’a jamais vraiment vu le jour, et lorsque la Libye a implosé en 2011, l’Europe a dû supplier Washington d’intervenir après seulement quelques jours d’opérations autonomes qui avaient épuisé ses stocks de munitions de précision. Qu’est-ce qui a changé depuis pour que cette fois soit différente? La menace russe est certainement plus proche et plus tangible qu’elle ne l’était dans les années 1990 ou 2000, ce qui pourrait effectivement galvaniser la volonté politique européenne. Mais la fragmentation politique interne au sein de l’Union européenne, avec la montée des partis populistes dans de nombreux pays et les tensions persistantes entre Est et Ouest, Nord et Sud, ne facilite pas l’émergence d’une stratégie commune cohérente. Le plan européen en douze points sera-t-il le catalyseur d’une véritable autonomie stratégique européenne, ou n’est-il qu’une illusion de plus qui s’évanouira dès que les intérêts nationaux divergents se heurteront aux difficiles compromis nécessaires?
Conclusion

En ce mardi 21 octobre 2025, alors que les détails du plan européen en douze points commencent à filtrer dans la presse internationale, je me retrouve à contempler une Europe à la croisée des chemins. D’un côté s’ouvre la possibilité, aussi fragile soit-elle, d’une paix négociée qui mettrait fin aux souffrances quotidiennes de millions d’Ukrainiens pris au piège d’une guerre qui semble ne jamais devoir finir. De l’autre côté se profile le spectre d’une capitulation déguisée qui récompenserait l’agression russe et créerait un précédent catastrophique pour l’ordre international fondé sur des règles que l’Occident prétend défendre. Entre ces deux extrêmes se trouve un espace étroit et précaire où la diplomatie tente de naviguer, armée de garanties de sécurité dont personne ne connaît vraiment la valeur, de promesses financières dont les modalités restent à définir, et de l’espoir vacillant que Donald Trump, cet homme imprévisible élevé au rang de président d’un Conseil de la paix, ne torpillera pas l’ensemble de l’édifice lors de son prochain coup de téléphone avec Poutine.
Ce qui est certain, c’est que les prochaines semaines seront déterminantes. La rencontre prévue de la Coalition des volontaires à Londres le 25 octobre, à laquelle Zelensky doit participer selon Macron, offrira une première opportunité de jauger l’unité réelle des alliés de l’Ukraine. Les discussions entre diplomates européens et responsables américains à Washington cette semaine révéleront si Trump est prêt à s’engager dans le cadre institutionnel proposé ou s’il préfère continuer sa diplomatie solitaire et erratique avec Moscou. Et surtout, la réaction russe au plan — lorsque Moscou daignera répondre officiellement plutôt que par les déclarations évasives de Peskov — dira si Poutine considère cette initiative comme une base de discussion ou comme un obstacle supplémentaire à ses objectifs maximalistes. Pour l’instant, toutes les déclarations du Kremlin suggèrent que Moscou n’a aucune intention d’assouplir ses exigences territoriales ni d’accepter un gel des lignes actuelles qui le priverait du Donbass entier. Dans ce cas, le plan européen en douze points risque de rejoindre la longue liste des initiatives diplomatiques bien intentionnées mais finalement stériles qui jalonnent l’histoire de ce conflit. À moins qu’un changement radical ne se produise — une défaite militaire russe significative, un effondrement économique à Moscou, ou une improbable prise de conscience de Poutine que la poursuite de la guerre lui coûtera plus qu’elle ne lui rapportera — la perspective d’une paix véritable et durable en Ukraine semble aussi éloignée aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a trois ans, malgré tous les plans, toutes les conférences et toutes les promesses des diplomates occidentaux.
Note de transparence rédactionnelle

Ce texte s’appuie sur des informations provenant de multiples sources journalistiques internationales, dont Bloomberg News, Reuters, le Financial Times, le Washington Post, le Straits Times, le Times of Israel, Al Jazeera, la BBC, Euronews, le Kyiv Independent, et d’autres médias réputés, ainsi que sur des déclarations officielles de responsables gouvernementaux et d’organisations internationales. Une distinction claire a été maintenue tout au long de l’article entre les faits vérifiés et rapportés par ces sources — notamment concernant l’existence du plan en douze points, les déclarations de diplomates européens, les positions officielles de la Russie et de l’Ukraine, et les développements récents des négociations — et les analyses interprétatives, les hypothèses d’enquête sur les motivations non confirmées des acteurs, ainsi que les réflexions éditoriales personnelles présentées dans les sections désignées. Les informations concernant les exigences russes lors de l’appel Trump-Poutine du 16 octobre, les détails du plan européen en douze points, et les discussions sur la Coalition des volontaires proviennent de sources diplomatiques anonymes et n’ont pas toutes été confirmées officiellement par les gouvernements concernés. Cet article sera mis à jour si de nouvelles informations officielles modifient substantiellement les éléments présentés ou si les négociations aboutissent à des développements concrets.