Le déjeuner explosif avec Zelensky le 18 octobre
Le vendredi 18 octobre 2025, un jour après son appel avec Poutine, Trump a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour ce qui était censé être un déjeuner de travail amical. Selon plusieurs sources présentes ou informées des discussions, l’atmosphère est rapidement devenue acrimonieuse lorsque Trump a insisté pour que l’Ukraine fasse des concessions territoriales massives à la Russie. Plusieurs témoins ont révélé que Trump avait poussé le leader ukrainien à céder les régions orientales de Donetsk et Louhansk — collectivement connues sous le nom de Donbas — dans le cadre d’un arrangement potentiel avec la Russie. Cette proposition reprenait presque mot pour mot ce que Poutine avait suggéré à Trump lors de leur conversation téléphonique la veille : l’Ukraine abandonnerait le Donbas en échange de… rien. Pas de garanties de sécurité réelles. Pas d’adhésion à l’OTAN. Pas de compensations territoriales ailleurs. Juste une capitulation pure et simple déguisée en compromis. Les tensions ont éclaté au grand jour durant ce déjeuner. Zelensky, qui a vu son pays bombardé quotidiennement pendant près de quatre ans, qui a perdu des dizaines de milliers de soldats et de civils, qui a vu des villes entières réduites en ruines, a caractérisé la conversation comme « franche » — un euphémisme diplomatique pour dire qu’il a refusé catégoriquement. Trump aurait menacé Zelensky d' »anéantissement » s’il ne cédait pas aux demandes de Poutine, une déclaration qui inverse complètement les rôles : c’est la Russie qui menace d’anéantir l’Ukraine, pas l’inverse, mais Trump semble avoir adopté la perspective russe comme si c’était la sienne.
Les lignes rouges de Zelensky que Trump ne peut pas franchir
Zelensky a expliqué publiquement pourquoi il refuse les propositions actuelles de Trump. Premièrement, céder le Donbas laisserait l’Ukraine dangereusement exposée à de futures attaques russes. Sans défenses naturelles ou garanties de sécurité solides, rien n’empêcherait Poutine de reprendre l’offensive quelques années plus tard pour s’emparer de Kiev ou d’Odessa. Deuxièmement, accepter ces termes équivaudrait à valider l’agression militaire comme méthode légitime de conquête territoriale — un précédent catastrophique pour l’ordre international qui encouragerait toutes les puissances régionales à envahir leurs voisins plus faibles. Troisièmement, politiquement, aucun leader ukrainien ne pourrait survivre à une telle capitulation. Le peuple ukrainien a enduré des souffrances inimaginables pour défendre son pays ; leur dire maintenant que tout cela était pour rien, que Poutine obtient ce qu’il voulait de toute façon, déclencherait probablement un soulèvement populaire. Dans son allocution quotidienne mardi 21 octobre, Zelensky a souligné le lien direct entre la position américaine et l’intransigeance russe : « Dès que la question des capacités à longue portée s’est un peu éloignée pour nous — pour l’Ukraine — la Russie est automatiquement devenue moins intéressée par la diplomatie. » En d’autres termes, lorsque Trump a retiré la menace de fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk capables de frapper profondément en territoire russe, Poutine a immédiatement compris qu’il n’avait plus besoin de faire semblant de négocier. Le bâton avait disparu, ne laissant que des carottes molles et sans intérêt pour Moscou.
Le cycle familier de manipulation que Trump ne reconnaît pas
CNN a brillamment résumé le schéma répétitif qui définit les tentatives de Trump pour résoudre le conflit ukrainien : Poutine répond lorsque Trump semble prêt à imposer des conséquences pour l’obstination russe. Ensuite, le président américain fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle cède des territoires. Puis le processus heurte un nouveau mur, laissant Trump frustré. Trump revient alors à sa position antérieure selon laquelle les hostilités devraient cesser aux lignes de front actuelles, avant de recommencer le cycle. « Le reste est difficile parce que si vous commencez à dire ‘Vous prenez ceci, prenez cela' », a déclaré Trump aux journalistes à bord d’Air Force One dimanche, une admission involontaire que son approche simpliste se heurte aux réalités géopolitiques complexes. Ce cycle de drame est devenu trop familier. Il y a moins de deux semaines, Trump avait brandi la possibilité d’envoyer des missiles Tomahawk à l’Ukraine, décrivant le Kremlin comme un « tigre de papier » et avertissant que l’économie russe était au bord de l’effondrement. Puis, des heures avant sa réunion avec Zelensky, Trump a parlé pendant plus de deux heures avec Poutine et a complètement changé de ton, adoptant les points de discussion du Kremlin presque mot pour mot. Cette susceptibilité à l’influence du dernier interlocuteur — ce que les collaborateurs de Trump appellent en privé « être le dernier dans la pièce » — signifie que la politique américaine change au gré des conversations de Trump, sans cohérence stratégique.
Les exigences russes inacceptables

Le Donbas complet : même les territoires non conquis
La position russe, telle qu’exposée dans le « non-paper » envoyé aux États-Unis et réaffirmée par Lavrov lors de sa conversation avec Rubio, est d’une audace stupéfiante. Moscou exige le contrôle total des régions de Louhansk et Donetsk — collectivement connues sous le nom de Donbas — y compris les parties substantielles que l’armée russe n’a pas réussi à capturer après trois ans de guerre intensive. Cela signifie que Poutine veut que l’Ukraine lui cède gratuitement ce qu’il n’a pas pu prendre par la force des armes. C’est comme si un général perdant une bataille exigeait la victoire totale comme condition préalable à un cessez-le-feu. La logique derrière cette demande absurde révèle la mentalité impériale russe : Poutine considère ces territoires comme appartenant légitimement à la Russie, indépendamment de qui y vit actuellement ou de qui les contrôle militairement. Dans sa vision du monde, l’Ukraine n’a aucun droit légitime d’exister en tant qu’État indépendant — c’est simplement une province rebelle de la sphère d’influence russe qui doit être ramenée dans le giron par n’importe quel moyen nécessaire. Accepter cette demande créerait un précédent catastrophique : n’importe quel pays pourrait envahir son voisin, échouer à conquérir tout ce qu’il voulait, puis exiger lors des négociations de paix non seulement de garder ce qu’il a pris mais aussi d’obtenir ce qu’il a raté. Ce serait la fin de tout ordre international basé sur des règles et le retour à la loi de la jungle où la puissance militaire brute détermine les frontières.
Le rejet du gel sur les lignes actuelles de front
La proposition de Trump — geler le conflit le long des lignes de front actuelles et négocier ensuite un règlement permanent — est rejetée catégoriquement par Moscou. Lavrov a déclaré publiquement que la Russie recherche « une paix durable à long terme », suggérant qu’un gel constituerait simplement une pause temporaire dans les combats. Cette formulation trahit les véritables intentions russes : Poutine ne veut pas la paix, il veut une victoire complète. Un cessez-le-feu gelant les lignes actuelles permettrait à l’Ukraine de se rearmer, de renforcer ses défenses, et potentiellement de rejoindre l’OTAN ou d’obtenir d’autres garanties de sécurité qui rendraient une future invasion russe beaucoup plus difficile. Du point de vue de Moscou, c’est inacceptable. La position russe est claire : continuons à nous battre jusqu’à ce que nous ayons tout ce que nous voulons, puis nous parlerons de paix. C’est exactement la stratégie qu’un agresseur emploie lorsqu’il croit avoir l’avantage militaire ou au moins la capacité d’endurer la guerre d’attrition plus longtemps que son adversaire. Poutine parie que l’Ukraine s’épuisera avant la Russie, que le soutien occidental finira par s’effriter, et que finalement Zelensky sera forcé d’accepter des conditions encore pires que celles proposées aujourd’hui. Le rejet du gel des lignes de front révèle également quelque chose d’important : Lavrov a affirmé que cette proposition contredisait les « compréhensions » supposées établies lors du sommet d’août en Alaska entre Trump et Poutine. Cela suggère soit que Trump a fait des promesses à Poutine qu’il ne peut ou ne veut pas tenir, soit que Poutine ment sur ce qui a été convenu, sachant que Trump niera rarement publiquement avoir fait des concessions.
Les restrictions sur les forces armées ukrainiennes
Au-delà des exigences territoriales, la Russie insiste également sur des restrictions sévères aux forces armées ukrainiennes dans tout accord de paix. Bien que les détails exacts de ces demandes ne soient pas publics, elles incluent probablement des limites sur la taille de l’armée ukrainienne, des interdictions sur certains types d’armes, et des contraintes sur où les forces ukrainiennes peuvent être déployées. Ces restrictions laisseraient l’Ukraine pratiquement sans défense face à une future agression russe. Il pourrait également y avoir une sorte de zone démilitarisée le long d’une nouvelle frontière, mais qui la contrôlerait ? Des forces russes ? Des observateurs internationaux que Moscou pourrait facilement intimider ou ignorer ? L’histoire des zones démilitarisées sans mécanisme d’application robuste montre qu’elles deviennent rapidement des fictions légales que l’agresseur viole à sa convenance. Poutine exige essentiellement que l’Ukraine accepte de devenir un État faible, désarmé, incapable de se défendre — un État vassal en tout sauf le nom. Aucun gouvernement ukrainien ne pourrait accepter ces termes et survivre politiquement, et aucun pays souverain ne devrait être forcé de renoncer à son droit fondamental à l’autodéfense. Pourtant, Trump semble considérer ces demandes comme « raisonnables », reprenant même l’argument russe selon lequel le Donbas contient des russophones et devrait donc appartenir à la Russie — une logique qui justifierait l’annexion de dizaines de régions à travers le monde où vivent des minorités ethniques ou linguistiques.
Les leaders européens se positionnent contre Trump

La déclaration conjointe de onze leaders le 21 octobre
Le même jour où la Maison-Blanche annonçait l’annulation du sommet de Budapest, onze leaders européens — incluant le Premier ministre britannique Keir Starmer — ont publié une déclaration remarquable qui exprime simultanément leur soutien à la proposition de Trump de geler les combats tout en condamnant implicitement sa volonté de faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle cède des territoires. La déclaration affirme leur « fort soutien » à l’assertion de Trump selon laquelle « les combats devraient cesser immédiatement et la ligne de contact actuelle devrait servir de base aux négociations ». Mais elle ajoute ensuite une critique acerbe des « tactiques dilatoires de la Russie » et souligne la rigidité de la position de Moscou. C’est un équilibre délicat : les Européens ne veulent pas contrarier ouvertement Trump et risquer de perdre le soutien américain à l’Ukraine, mais ils veulent aussi clairement signaler qu’ils ne soutiendront pas une capitulation ukrainienne déguisée en accord de paix. La déclaration mentionne spécifiquement que « la Russie manque de véritables intentions de paix », une formulation qui contredit directement l’espoir naïf de Trump que Poutine négocie de bonne foi. En incluant Zelensky comme signataire de cette déclaration, les Européens envoient un message clair : nous sommes avec l’Ukraine, pas avec un arrangement Trump-Poutine qui sacrifierait la souveraineté ukrainienne pour permettre à Trump de revendiquer une victoire diplomatique factice. Cette unité européenne, bien que fragile et potentiellement temporaire, représente un obstacle important aux plans de Trump.
Le rejet catégorique de Lavrov
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rejeté publiquement la déclaration des leaders européens, déclarant que Moscou recherche « une paix durable à long terme » plutôt qu’un simple gel temporaire des hostilités. Cette formulation soigneusement choisie révèle la stratégie russe fondamentale : continuer la guerre jusqu’à ce que l’Ukraine soit forcée d’accepter des conditions qui garantissent qu’elle restera faible et vulnérable à perpétuité. Lavrov a également suggéré qu’un gel des lignes de front actuelles ne ferait que créer une pause dans les combats, laissant entendre que la Russie reprendrait son offensive dès qu’elle en aurait l’opportunité. C’est essentiellement une admission que Moscou n’a aucune intention de respecter un cessez-le-feu si celui-ci ne lui donne pas tout ce qu’elle veut. Le rejet de Lavrov expose également la naïveté de la position de Trump. Le président américain semble croire qu’il peut convaincre Poutine d’accepter un compromis par la force de sa personnalité ou par des concessions sur l’Ukraine. Mais Poutine n’a aucun intérêt à un compromis — il pense qu’il peut gagner militairement ou au moins user l’Ukraine et l’Occident jusqu’à ce qu’ils abandonnent. Tant que cette croyance persiste, aucune quantité de charme présidentiel ou de pressions sur Kiev ne produira un accord de paix. Les Européens semblent comprendre cette réalité mieux que Trump, d’où leur insistance sur le fait que toute négociation doit partir du principe que l’agression ne paie pas.
Viktor Orbán : le grand perdant de cette annulation
Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui devait accueillir le sommet Trump-Poutine, est probablement le plus déçu par cette annulation. Orbán avait vu dans cet événement une opportunité en or de se positionner comme l’indispensable pont entre l’Occident et la Russie, de démontrer son importance géopolitique malgré son isolement croissant au sein de l’Union européenne. Accueillir un sommet présidentiel entre les États-Unis et la Russie aurait donné à la Hongrie — et personnellement à Orbán — un prestige international énorme. Cela aurait validé son approche pro-Kremlin, justifié ses blocages répétés des sanctions européennes contre la Russie, et renforcé sa position comme leader d’une faction « réaliste » en Europe qui privilégie les relations avec Moscou plutôt que le soutien inconditionnel à Kiev. Le choix de Budapest par Trump était déjà controversé précisément parce qu’il semblait récompenser Orbán pour sa complaisance envers la Russie. Maintenant que le sommet est annulé, Orbán se retrouve dans une position embarrassante : il avait probablement déjà vanté son rôle crucial à venir, mobilisé des ressources pour préparer l’événement, et maintenant il doit expliquer pourquoi tout cela s’est effondré. L’annulation soulève également des questions sérieuses sur l’invitation qui aurait été étendue à Poutine. La Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre Poutine en 2023 pour crimes de guerre, spécifiquement la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Russie. Bien que la Hongrie ne soit pas membre de la CPI et n’aurait donc aucune obligation légale d’arrêter Poutine, sa présence à Budapest aurait créé un spectacle obscène où un criminel de guerre présumé est accueilli avec les honneurs d’État.
L'Alaska revisité : le précédent qui aurait dû alerter Trump

Le sommet d’août qui n’a produit aucun résultat
Le 15 août 2025, Trump et Poutine s’étaient déjà rencontrés en personne à Anchorage, Alaska, pour ce qui était présenté comme une percée diplomatique majeure. Ce sommet, le premier entre les deux leaders depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier, était censé établir un cadre pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il n’a produit absolument aucun résultat tangible. Aucun accord n’a été signé. Aucun progrès concret vers un cessez-le-feu n’a été réalisé. Aucune compréhension mutuelle sur les termes d’un règlement futur n’a émergé. Les deux présidents ont émis des déclarations vagues sur leur « dialogue constructif » et leur « volonté de continuer à travailler ensemble », mais ces formules creuses ne cachaient pas l’échec fondamental de la rencontre. Ce qui s’est réellement passé en Alaska reste largement mystérieux, car ni la Maison-Blanche ni le Kremlin n’ont publié de compte rendu détaillé. Mais quelques éléments ont filtré suggérant que Poutine a fait exactement ce qu’il a refait maintenant : il a présenté des demandes maximalistes, a refusé tout compromis substantiel, et a quitté la réunion sans bouger d’un pouce de ses positions. Trump, pour sa part, semble avoir interprété le simple fait que Poutine ait accepté de le rencontrer comme une victoire diplomatique, confondant le processus avec le résultat. Dans les jours suivant le sommet d’Alaska, la Russie a immédiatement lancé une nouvelle série d’attaques massives contre les villes ukrainiennes, bombardant des infrastructures civiles et causant des dizaines de morts. Ce timing n’était pas accidentel — c’était un message clair de Moscou que les sommets avec Trump ne changeraient rien à la stratégie militaire russe.
Le schéma répétitif que Trump refuse de voir
L’échec du sommet d’Alaska aurait dû enseigner à Trump une leçon fondamentale : Poutine n’est pas intéressé par une négociation équitable. Il utilise les sommets et les appels téléphoniques comme des outils de manipulation psychologique et de propagande, pas comme des occasions sincères de résoudre les différends. Chaque fois que Trump annonce une percée imminente, Poutine sait qu’il peut extraire plus de concessions en laissant Trump investir émotionnellement et politiquement dans le processus de paix. Ensuite, quand les termes finaux sont discutés, Trump sera tellement engagé qu’il fera pression sur l’Ukraine plutôt que d’admettre que sa diplomatie a échoué. C’est de la manipulation de niveau expert, et Trump tombe dedans à répétition. Après l’Alaska, Trump aurait dû réaliser que Poutine joue un jeu différent. Au lieu de cela, il a immédiatement recommencé le même cycle : un appel téléphonique avec Poutine, une annonce enthousiaste d’un sommet imminent, des attentes gonflées, puis l’effondrement inévitable lorsque les Russes réaffirment leurs demandes inacceptables. Einstein aurait défini la folie comme faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Selon cette définition, la diplomatie ukrainienne de Trump est profondément folle. Le fait que Trump ne semble pas capable d’apprendre de l’expérience, qu’il ne reconnaisse pas les schémas même quand ils se répètent sous ses yeux, soulève de sérieuses questions sur ses capacités cognitives et son jugement. Un président compétent ajusterait sa stratégie après un échec. Trump répète simplement les mêmes erreurs avec plus d’enthousiasme.
Les bombardements russes comme réponse aux négociations
Mardi soir 21 octobre, quelques heures seulement après que Trump ait annoncé que le sommet de Budapest était annulé, la Russie a lancé des frappes massives à travers l’Ukraine, tuant au moins six personnes et endommageant des infrastructures critiques. Ce timing, comme celui suivant le sommet d’Alaska, n’est pas une coïncidence. C’est la réponse russe réelle aux efforts de paix de Trump : des missiles et des drones, pas des compromis et des concessions. Le message de Moscou est clair et constant : nous continuerons à bombarder l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle capitule complètement, et aucune quantité de sommets présidentiels ne changera cette stratégie. Chaque fois que Trump annonce des progrès diplomatiques, Poutine répond par une escalade militaire. Pourquoi ? Parce que ça marche. Ces attaques rappellent à tout le monde que la Russie contrôle le tempo de la guerre, que c’est elle qui décide quand frapper et où. Elles démontrent que toute la diplomatie de Trump est essentiellement sans conséquence pour les calculs stratégiques russes. Et elles forcent Trump à choisir : soit intensifier le soutien militaire à l’Ukraine pour punir cette intransigeance, soit continuer à faire pression sur Kiev pour qu’elle accepte les termes russes. Jusqu’à présent, Trump a presque toujours choisi la seconde option, validant ainsi la stratégie de Poutine. Les Ukrainiens paient le prix de cette faiblesse diplomatique américaine en sang et en destructions continues. Les bombardements post-annulation envoient également un message aux Européens qui venaient de publier leur déclaration de soutien à un cessez-le-feu : la Russie se fiche de vos appels à la paix et continuera à détruire l’Ukraine indépendamment de ce que vous dites ou faites.
Ce que révèle cette débâcle sur Trump
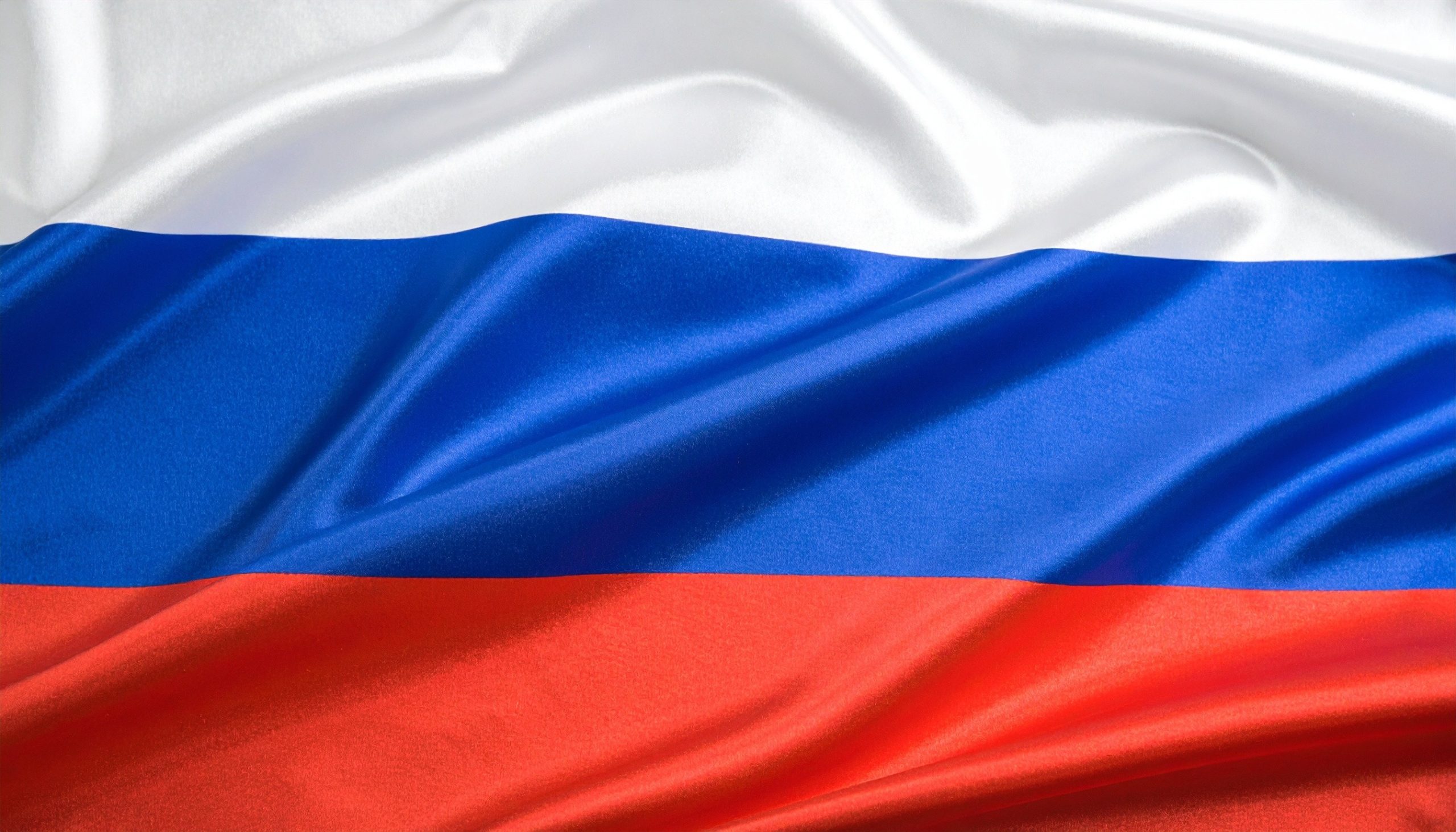
La promesse des « 24 heures » complètement abandonnée
Durant sa campagne électorale de 2024, Trump avait affirmé à de nombreuses reprises qu’il pourrait résoudre la guerre entre la Russie et l’Ukraine en « 24 heures » s’il était réélu. C’était une promesse audacieuse, caractéristique de son style hyperbolique, mais des millions d’Américains l’ont prise au sérieux et ont voté pour lui en partie sur cette base. Nous sommes maintenant en octobre 2025, dix mois après son investiture, et non seulement la guerre continue sans relâche, mais Trump n’est même pas capable d’organiser une réunion avec Poutine, encore moins de négocier un cessez-le-feu. Les « 24 heures » se sont transformées en près d’un an de piétinements diplomatiques, d’annonces grandioses suivies d’échecs embarrassants, et de cycles répétés d’espoirs gonflés puis éclatés. Cette promesse n’était jamais réaliste, bien sûr. Quiconque connaît l’histoire et la complexité du conflit ukrainien savait qu’aucun règlement rapide n’était possible. Mais l’écart entre la promesse et la réalité est si vaste qu’il ne peut être ignoré. Trump a soit délibérément menti aux électeurs, sachant que sa promesse était impossible, soit il croyait sincèrement qu’il pourrait résoudre un conflit géopolitique complexe par la force de sa personnalité — auquel cas son niveau de narcissisme et de déconnexion de la réalité est encore plus alarmant que nous le pensions. Dans les deux cas, sa base électorale devrait se sentir trahie. Ils ont voté pour un homme qui promettait la paix et ont obtenu un président qui ne peut même pas organiser une réunion.
L’incapacité à exercer un levier sur la Russie
Trump fait face à un problème fondamental dans ses négociations avec Poutine : il n’a aucun levier réel sur la Russie. Un levier, en diplomatie, signifie la capacité d’imposer des coûts ou d’offrir des récompenses qui modifient le calcul stratégique de l’autre partie. Trump refuse d’imposer des coûts supplémentaires à la Russie — pas de nouvelles sanctions significatives, pas de fourniture d’armes plus avancées à l’Ukraine, pas de menaces crédibles de conséquences militaires. En fait, il fait le contraire : il envisage d’assouplir les sanctions existantes, bloque certaines livraisons d’armes à Kiev, et signale constamment sa réticence à soutenir l’Ukraine à long terme. Du point de vue de Poutine, pourquoi ferait-il des concessions ? Trump lui offre essentiellement tout ce qu’il veut — une Amérique qui se retire du soutien à l’Ukraine, qui fait pression sur Zelensky pour qu’il capitule, qui traite les demandes russes comme légitimes — sans exiger quoi que ce soit en retour. C’est une négociation où une partie abandonne tout son pouvoir de marchandage dès le début, puis s’étonne que l’autre partie ne fasse aucun compromis. Les présidents américains précédents comprenaient que négocier avec la Russie nécessite un mélange de bâtons et de carottes, de fermeté sur les principes fondamentaux combinée à une flexibilité sur les détails d’implémentation. Trump offre uniquement des carottes et se demande pourquoi Poutine continue à exiger plus. Un ancien responsable du Département d’État a résumé le problème avec une clarté brutale : « Trump ne comprend pas que Poutine ne cherche pas la paix. Il cherche la victoire. Et tant que Trump n’est pas prêt à rendre la victoire impossible ou au moins excessivement coûteuse, Poutine continuera simplement à se battre. »
La susceptibilité aux talking points du Kremlin
L’un des aspects les plus troublants de la gestion par Trump du dossier ukrainien est sa tendance à adopter presque immédiatement les arguments et les cadrages russes. Après son appel avec Poutine le 16 octobre, Trump a commencé à répéter plusieurs points de discussion du Kremlin : que le conflit n’était qu’une « opération spéciale, pas même une guerre » ; que Poutine pourrait escalader beaucoup plus s’il le voulait ; que la demande de Poutine concernant le Donbas est « raisonnable » parce que la région contient des russophones ; que Poutine pourrait être disposé à échanger des territoires. Ces arguments reprennent la propagande russe mot pour mot. L’affirmation que le Donbas devrait appartenir à la Russie parce que des russophones y vivent est particulièrement pernicieuse. C’est exactement la logique qu’Hitler a utilisée pour justifier l’annexion des Sudètes en 1938 — que les régions avec des populations germanophones devraient faire partie de l’Allemagne. Si ce principe était appliqué globalement, il justifierait des centaines d’annexions territoriales et déclencherait des conflits dans le monde entier. Il y a des millions d’hispanophones dans le sud-ouest des États-Unis ; cela signifie-t-il que le Mexique a le droit de revendiquer la Californie et le Texas ? Il y a d’importantes populations chinoises dans toute l’Asie du Sud-Est ; cela justifie-t-il l’expansion territoriale chinoise ? Bien sûr que non. Mais Trump répète cet argument comme s’il avait un sens, soit parce qu’il ne comprend pas ses implications, soit parce qu’il ne se soucie tout simplement pas.
Les conséquences pour l'Ukraine et l'ordre international
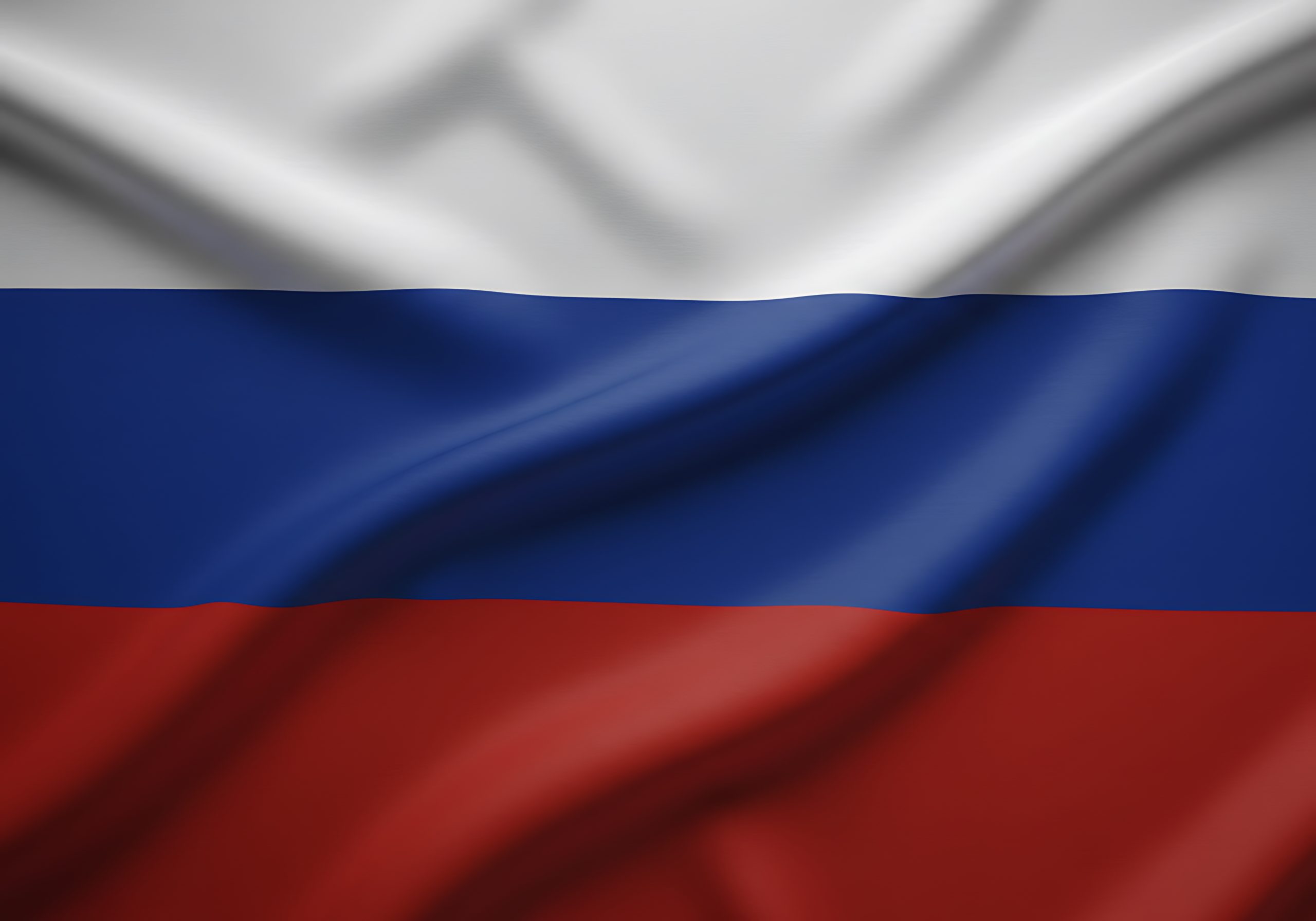
Kiev piégée entre l’agression russe et la pression américaine
L’Ukraine se trouve dans une position impossible. D’un côté, elle fait face à une agression militaire russe continue qui détruit ses villes, tue ses citoyens et menace son existence même en tant qu’État indépendant. De l’autre, elle subit une pression croissante de son principal allié, les États-Unis, pour qu’elle accepte des concessions territoriales massives qui la laisseraient dangereusement vulnérable à de futures attaques. Zelensky ne peut pas capituler aux demandes russes sans déclencher probablement un soulèvement populaire — le peuple ukrainien a enduré trop de souffrances pour accepter maintenant que tout cela était pour rien. Mais il ne peut pas non plus se permettre de perdre complètement le soutien américain, car sans armes et aide financière américaines, l’effort de guerre ukrainien s’effondrerait en quelques mois. Cette situation crée un dilemme stratégique terrifiant pour Kiev. Si Zelensky refuse fermement les demandes de Trump, risque-t-il que les États-Unis coupent l’aide militaire ? Si il fait semblant d’accepter tout en traînant les pieds sur l’implémentation, Trump deviendra-t-il frustré et l’abandonnera-t-il ? Si il essaie de convaincre Trump que les exigences russes sont inacceptables, sera-t-il écouté ou simplement accusé d’être un obstacle à la paix ? Il n’y a pas de bonnes options, seulement des mauvaises et des pires. Les Européens offrent un certain contrepoids au retrait américain potentiel, mais leur soutien seul ne suffirait pas à compenser une perte complète de l’aide américaine. L’Ukraine est essentiellement prise en otage entre l’intransigeance russe et l’incompétence diplomatique américaine.
Le précédent catastrophique pour les conflits futurs
Si Trump réussissait à forcer l’Ukraine à accepter les termes russes — céder le Donbas, restreindre ses forces armées, renoncer à l’adhésion à l’OTAN — cela créerait un précédent désastreux pour l’ordre international. Le message serait clair : l’agression militaire paie. Si vous êtes assez puissant et assez patient, vous pouvez envahir vos voisins, et finalement la communauté internationale fatiguée forcera la victime à vous donner une partie de ce que vous vouliez. Cela encouragerait toutes les puissances régionales avec des ambitions territoriales à tenter leur chance. La Chine regarderait Taiwan et penserait : si la Russie peut s’en tirer avec l’Ukraine, pourquoi pas nous ? La Turquie pourrait intensifier ses opérations contre les Kurdes. L’Azerbaïdjan pourrait lancer une nouvelle offensive contre l’Arménie. Le Pakistan pourrait devenir plus agressif au Cachemire. La liste continue. L’ordre international basé sur des règles établi après la Seconde Guerre mondiale — le principe que les frontières ne devraient pas être changées par la force — s’effondrerait complètement. Nous retournerions à un monde où la puissance militaire brute détermine qui possède quel territoire, où les accords internationaux ne sont que des bouts de papier à ignorer quand c’est pratique. Ce serait catastrophique pour la paix et la stabilité globales, déclenchant probablement une vague de conflits alors que les pays se précipitent pour régler les différends territoriaux par la force avant que la fenêtre d’opportunité ne se ferme.
La crédibilité américaine en ruines permanentes
Indépendamment de la façon dont cette débâcle particulière se termine, les dommages à la crédibilité américaine sont déjà massifs et possiblement irréparables. Les alliés des États-Unis à travers le monde regardent Trump se faire manipuler par Poutine et tirent leurs propres conclusions sur la fiabilité américaine. Si les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas soutenir fermement l’Ukraine — un pays qui a accepté de renoncer aux armes nucléaires en 1994 en échange de garanties de sécurité américaines, britanniques et russes — alors quelle valeur ont les garanties américaines ailleurs ? Les pays d’Asie de l’Est qui dépendent de la protection américaine contre la Chine se demandent si Washington les abandonnerait aussi facilement face à l’agression. Les alliés européens réalisent qu’ils ne peuvent plus compter entièrement sur le parapluie de sécurité américain et commencent à investir massivement dans leurs propres capacités de défense. Les adversaires des États-Unis, quant à eux, sont enhardis. Ils voient qu’un président américain peut être flatté, manipulé et joué par un autocrate patient. Ils apprennent les techniques qui fonctionnent sur Trump et planifient comment les utiliser à leur propre avantage. Cette érosion de la crédibilité prendra des décennies à réparer, si elle peut l’être. Même après que Trump aura quitté ses fonctions, les gouvernements étrangers se souviendront que les États-Unis ont élu un président si incompétent et si facilement manipulé, et ils ajusteront leurs calculs stratégiques en conséquence.
Conclusion
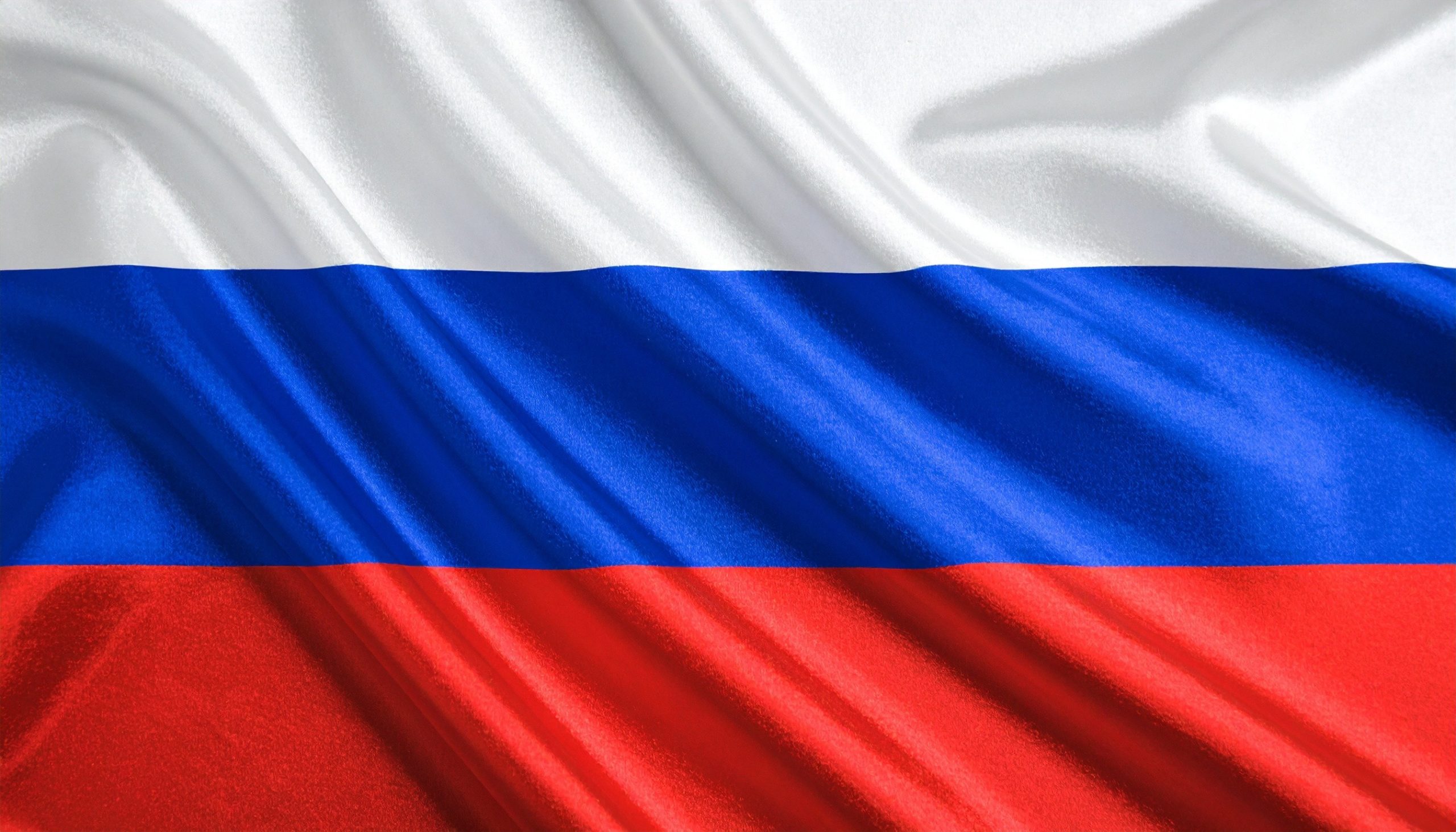
Le sommet de Budapest qui devait avoir lieu dans les deux semaines suivant l’annonce de Trump est maintenant dans les limbes, reporté indéfiniment, probablement mort mais pas encore officiellement enterré pour permettre aux deux parties de sauver la face. Cette débâcle diplomatique — du triomphalisme initial de Trump à l’annulation humiliante en moins d’une semaine — résume parfaitement sa présidence et son approche de la politique étrangère. Quarante-trois mois de guerre brutale en Ukraine, des dizaines de milliers de morts, des villes entières réduites en ruines, des millions de réfugiés, et Trump croyait sincèrement qu’il pourrait résoudre tout ça en 24 heures grâce à son charisme personnel et ses compétences de négociateur. Dix mois après son retour au pouvoir, il ne peut même pas organiser une réunion avec Poutine sans que celle-ci s’effondre avant d’avoir lieu. Le cycle est devenu douloureusement prévisible : Trump parle avec Poutine, adopte immédiatement les points de discussion russes, annonce une percée imminente, fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle cède des territoires, se heurte à l’intransigeance russe et au refus ukrainien, puis tout s’effondre pendant que Trump prétend que c’était lui qui a décidé que la réunion serait une « perte de temps ». Moscou réitère ses demandes inacceptables — le Donbas complet y compris les territoires non conquis, des restrictions sévères sur les forces armées ukrainiennes, le rejet catégorique de tout gel des lignes de front actuelles. Poutine n’a absolument aucune intention de négocier équitablement ; il veut une capitulation ukrainienne déguisée en accord de paix. Et Trump, soit par naïveté soit par affinité idéologique avec l’autoritarisme russe, traite ces demandes absurdes comme si elles méritaient une considération sérieuse. Les leaders européens, pour leur part, ont trouvé suffisamment de colonne vertébrale collective pour publier une déclaration signalant qu’ils ne suivront pas Trump dans un arrangement pourri qui sacrifierait l’Ukraine. Mais combien de temps cette unité tiendra-t-elle face à une pression américaine soutenue ? L’Ukraine est piégée entre l’agression russe et la pression américaine, forcée de résister simultanément à un ennemi qui veut détruire son existence et à un allié qui veut la forcer à capituler. Le précédent que cela créerait — que l’agression militaire paie finalement si vous êtes assez patient — serait catastrophique pour l’ordre international. Et pendant ce temps, la crédibilité américaine s’effrite jour après jour, sommet raté après sommet raté, alors que le monde entier regarde Trump se faire jouer comme un violon par Poutine qui ne le respecte même pas assez pour prétendre le prendre au sérieux. Budapest n’aura pas lieu. Mais ce qui s’est passé — cette parade d’incompétence diplomatique, cette démonstration publique de la façon dont Poutine manipule Trump sans même avoir besoin d’être subtil à ce sujet — révèle des vérités terrifiantes sur qui dirige actuellement les États-Unis et à quel point l’Amérique est vulnérable sous son leadership.