Le message de Trump sur Truth Social le 9 novembre 2025 était clair et provocateur, comme à son habitude. « Ceux qui s’opposent aux droits de douane sont des IMBÉCILES! » a-t-il écrit en lettres majuscules. « Nous sommes désormais le pays le plus riche et le plus respecté du monde, avec une inflation quasi nulle et un cours boursier record. Un dividende d’au moins 2000 dollars par personne (hors personnes à hauts revenus!) sera versé à tous. » La formulation est astucieuse. Trump ne parle pas de « chèque » ou de « paiement direct », mais de « dividende » — un terme qui évoque l’idée que les Américains sont des actionnaires du succès économique de leur pays et méritent leur part des profits. Cette rhétorique est puissante. Elle transforme les tarifs douaniers — normalement perçus comme une taxe sur les consommateurs — en une source de revenus qui bénéficie directement au peuple. C’est du pur marketing politique, et c’est brillamment exécuté.
Mais derrière les slogans et les lettres majuscules, les détails restent désespérément vagues. Qui exactement compte comme « personne à hauts revenus »? Est-ce qu’un ménage gagnant 100 000 dollars par an est exclu? 150 000? 200 000? Trump ne l’a jamais précisé. Comment ces paiements seront-ils calculés? Par personne ou par ménage? Les sources diffèrent — certains articles parlent de 2000 dollars par personne, d’autres par foyer. Quand cet argent arrivera-t-il? Trump n’a donné aucune date. Et surtout, d’où viendra exactement cet argent? Les recettes douanières ont effectivement explosé, atteignant 30 milliards de dollars par mois selon Le Figaro. Sur une année, cela représente 360 milliards de dollars. Mais distribuer 2000 dollars à chaque ménage américain — il y en a environ 130 millions — coûterait 260 milliards de dollars. Si c’est par personne et non par ménage, on parle de plus de 600 milliards de dollars. Les calculs ne tiennent tout simplement pas la route.
Scott Bessent et l’aveu d’impuissance : « aucune proposition formelle »
Quelques heures seulement après l’annonce de Trump, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des États-Unis, est interrogé sur ABC News. La question est directe : pouvez-vous nous donner des détails sur ce dividende de 2000 dollars? La réponse de Bessent est un chef-d’œuvre d’esquive politique. « Aucune proposition formelle n’a été faite concernant les chèques de 2000 dollars », affirme-t-il. Puis il ajoute : « Le dividende de 2000 dollars pourrait prendre plusieurs formes. Il pourrait s’agir simplement des baisses d’impôts prévues dans le programme du président : exonération d’impôt sur les pourboires, les heures supplémentaires et les cotisations de sécurité sociale, déductibilité des prêts automobiles… autant de déductions substantielles. » Attendez… quoi? Ce que Bessent est en train de dire, c’est que les 2000 dollars promis ne sont peut-être pas du tout un chèque direct. Ce pourrait être simplement une valorisation de diverses réductions d’impôts déjà dans le pipeline.
Cette déclaration a l’effet d’une bombe glacée. Les Américains qui s’imaginaient recevoir un virement bancaire de 2000 dollars réalisent soudain que ce « dividende » pourrait n’être qu’une abstraction comptable — une estimation de combien ils économiseront peut-être en impôts sur l’année. Pour une serveuse qui compte sur les pourboires, l’exonération fiscale sur ces pourboires pourrait représenter quelques centaines de dollars par an. Pour quelqu’un qui fait beaucoup d’heures supplémentaires, l’exonération fiscale pourrait être similaire. Mais additionner ces différentes déductions pour arriver à 2000 dollars nécessite une gymnastique fiscale complexe que la plupart des Américains ordinaires ne peuvent même pas comprendre, encore moins calculer. Et surtout, ces « économies » ne sont pas du cash immédiat dans votre poche. C’est de l’argent que vous ne paierez pas en impôts, ce qui signifie que si vous ne gagnez pas assez pour payer beaucoup d’impôts — et des millions d’Américains à faibles revenus sont dans ce cas — vous ne verrez aucun bénéfice de ces « dividendes ».
Les calculs qui ne tiennent pas : l'arithmétique de l'illusion

Faisons les comptes avec précision. Il y a environ 130 millions de ménages aux États-Unis. Si chacun reçoit 2000 dollars, cela représente un coût total de 260 milliards de dollars. Si c’est par personne plutôt que par ménage, et qu’on exclut seulement les 10 pour cent les plus riches, on parle de distribuer cet argent à environ 300 millions de personnes, soit 600 milliards de dollars. Or, les recettes douanières annuelles, même avec l’augmentation massive imposée par Trump, atteignent environ 360 milliards de dollars selon les estimations les plus optimistes. Il y a donc un gouffre béant entre les promesses et la réalité comptable. D’autant plus que Trump a également promis d’utiliser « tout l’argent restant » pour rembourser la dette nationale de 37 billions de dollars. Comment peut-on simultanément distribuer 260 à 600 milliards en dividendes ET rembourser substantiellement la dette avec les mêmes recettes douanières?
Erica York, vice-présidente chargée de la politique fiscale fédérale à la Tax Foundation, a calculé que distribuer 2000 dollars en espèces à la majeure partie de la population américaine pourrait coûter 300 milliards de dollars, voire plus — un montant supérieur aux recettes nettes générées jusqu’à présent par les nouveaux droits de douane de Trump. Et il y a un autre problème, encore plus grave : ces tarifs douaniers pourraient être annulés. La Cour suprême des États-Unis a tenu une audience de plus de trois heures le 5 novembre 2025 pour examiner la légalité de l’usage par Trump d’une loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) pour imposer ses taxes douanières. Plusieurs des neuf juges ont exprimé leur scepticisme, notant que cette loi ne mentionne pas explicitement l’expression « taxes douanières ». Si la Cour suprême déclare ces tarifs illégaux — une décision attendue au début de 2026 — toute la base de financement de cette promesse de 2000 dollars s’effondre. Trump lui-même a reconnu que ce serait « dévastateur » si la Cour se prononçait contre lui, bien qu’il affirme s’attendre à gagner l’affaire.
Les chiffres ne mentent jamais. Ils ont cette brutalité, cette honnêteté implacable qui démasque les illusions. Je regarde ces calculs, ces budgets qui ne collent pas, et je me demande : qui exactement pense-t-on duper? Les Américains ne sont pas idiots. Ils savent compter. Ils savent qu’on ne peut pas distribuer 600 milliards qu’on n’a pas. Alors pourquoi cette promesse? Pourquoi cette annonce tonitruante sans plan concret pour la tenir? La réponse est simple et désolante : parce que ça marche. Parce que les gens veulent tellement y croire qu’ils suspendent leur jugement critique. Jusqu’à ce que la déception arrive, encore une fois.
Les tarifs douaniers : qui paie vraiment la facture?
Il faut déconstruire le mythe central sur lequel repose toute cette promesse : l’idée que les pays étrangers paient les tarifs douaniers. Trump l’a répété ad nauseam — « Nous encaissons des milliers de milliards de dollars » venant de pays étrangers. C’est faux. Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les tarifs. Dans la réalité économique, les tarifs douaniers sont payés par les importateurs américains, pas par les gouvernements chinois, mexicain ou européen. Ces importateurs — des entreprises américaines — répercutent ensuite ces coûts sur les consommateurs américains sous forme de prix plus élevés. Une étude du Peterson Institute for International Economics estime que les tarifs de Trump coûtent en moyenne 1200 à 1500 dollars par an aux ménages américains sous forme de prix gonflés sur tout, des vêtements aux électroniques en passant par les meubles et l’alimentation.
Donc, dans une ironie cruelle, Trump prélève effectivement 1200 à 1500 dollars sur chaque famille américaine à travers l’inflation causée par ses tarifs, génère des revenus gouvernementaux avec cet argent, puis promet de leur redistribuer 2000 dollars — dont 1200 à 1500 servent simplement à compenser les coûts qu’il leur a imposés en premier lieu. Le gain net réel serait donc de 500 à 800 dollars au mieux, et c’est en supposant que le chèque arrive vraiment et dans son intégralité. C’est comme si quelqu’un vous volait 15 dollars dans votre poche gauche, puis vous en rendait 20 dans votre poche droite en se vantant de sa générosité — sauf que vous avez encore perdu du pouvoir d’achat à cause de l’inflation généralisée causée par les tarifs. Cette dynamique révèle l’absurdité fondamentale de toute la promesse. Ce n’est pas de l’argent « gratuit » venant de l’étranger. C’est de l’argent pris aux Américains eux-mêmes, recyclé à travers le gouvernement, puis partiellement redistribué avec une grande fanfare médiatique.
Le timing suspect : une promesse face à la Cour suprême

Le timing de cette annonce n’est pas accidentel. Trump a fait sa promesse de 2000 dollars le week-end suivant l’audience de la Cour suprême sur la légalité de ses tarifs. Les observateurs politiques y voient une tentative désespérée de gagner la bataille de l’opinion publique alors qu’il risque de perdre la bataille juridique. En promettant que les tarifs vont bénéficier directement aux Américains ordinaires, Trump espère créer une pression populaire sur la Cour suprême pour qu’elle maintienne ses politiques. « Regardez tous ces gens qui attendent leurs 2000 dollars! » pourrait être son argument implicite aux juges. « Vous allez vraiment les décevoir en déclarant mes tarifs illégaux? » C’est une stratégie cynique qui instrumentalise les espoirs financiers de millions de gens pour des calculs politiques et juridiques.
Le Parisien a souligné cette dimension dans son article du 10 novembre : « Cette promesse intervient alors que les droits de douane, son arme commerciale favorite, sont vivement critiqués. Ils pourraient même être interdits par la Cour Suprême prochainement. » Le journal ajoute que « les observateurs pensent donc que Donald Trump essaie de remporter la bataille des idées en promettant un retour sur investissement pour le peuple américain. » C’est exactement ça. Trump ne gouverne pas avec des politiques cohérentes et planifiées. Il gouverne par coups médiatiques, par annonces choc, par promesses grandioses qui occupent l’espace public pendant quelques jours avant de s’évaporer dans les brumes de Washington. Cette approche peut être efficace électoralement — elle maintient Trump au centre de l’attention, elle donne à ses partisans des raisons de continuer à croire en lui. Mais elle est désastreuse pour la gouvernance réelle, pour la planification à long terme, pour la stabilité économique dont les entreprises et les familles ont besoin pour prendre des décisions.
Les réactions : espoir, scepticisme et colère
Les réactions à cette promesse ont été profondément divisées, suivant les lignes politiques prévisibles. Les partisans de Trump ont salué l’annonce comme une preuve de plus que leur président tient ses promesses et se bat pour les gens ordinaires contre les élites mondialistes. Sur Truth Social et les forums pro-Trump, l’enthousiasme était palpable. « Enfin un président qui nous redonne notre argent! » « Les démocrates ne feront jamais ça! » « Trump 2028! » Les commentaires reflétaient un espoir authentique, un soulagement à l’idée que de l’aide financière pourrait arriver. Pour des familles qui luttent pour payer leurs factures médicales, qui ont vu leurs primes d’assurance exploser, qui subissent l’inflation quotidienne à l’épicerie et à la pompe, 2000 dollars représentent une bouée de sauvetage potentielle. On ne peut pas leur reprocher d’espérer.
Mais du côté des économistes, des analystes et de l’opposition démocrate, le scepticisme était immédiat et brutal. Le Parisien a titré : « Tout cela n’est que mensonge : Trump promet un… » Le Journal de Montréal a rapporté que « le secrétaire du Trésor des États-Unis, Scott Bessent, avait affirmé lors d’une entrevue à ABC News qu’aucune proposition formelle n’avait été faite concernant les chèques de 2000 dollars. » Les démocrates ont bondi sur l’occasion pour dénoncer ce qu’ils appellent une « arnaque électorale ». Plusieurs élus ont souligné que même si ces paiements étaient distribués, ils seraient largement annulés par les coûts accrus causés par les tarifs eux-mêmes. « Trump vous vole d’une main ce qu’il vous donne de l’autre », a déclaré un sénateur démocrate. Les économistes ont alerté sur les conséquences inflationnistes potentielles d’une injection massive de liquidités dans l’économie, et sur l’irresponsabilité budgétaire de faire de telles promesses sans plan de financement solide. La fracture entre ceux qui veulent croire et ceux qui vérifient les calculs n’a jamais été aussi évidente.
Cette division me brise le cœur, sincèrement. D’un côté, des gens qui ont tellement besoin d’aide qu’ils s’accrochent à chaque promesse comme un naufragé à une planche. De l’autre, des experts qui démontent méthodiquement ces promesses avec des chiffres, des graphiques, des analyses. Les deux ont raison, d’une certaine manière. Le besoin est réel. Les problèmes avec la promesse le sont aussi. Mais dans cette guerre de narratives, la vérité se perd quelque part au milieu, et ce sont toujours les plus vulnérables qui finissent par payer le prix de ces jeux politiques.
Les formes alternatives : déductions fiscales déguisées en dividendes

Revenons à la déclaration cruciale de Scott Bessent sur ABC News. Lorsqu’il dit que le « dividende » pourrait prendre la forme d’exonérations d’impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires, la sécurité sociale, ou la déductibilité des prêts automobiles, il révèle la véritable nature de cette promesse. Ce ne sont pas des paiements directs. Ce sont des politiques fiscales qui étaient déjà dans le programme électoral de Trump, maintenant rebrandées comme un « dividende de 2000 dollars ». C’est du marketing politique brillant mais profondément trompeur. Une serveuse qui gagne 30 000 dollars par an avec 5000 dollars en pourboires pourrait économiser environ 500 dollars en impôts fédéraux si ces pourboires sont exonérés. Un travailleur qui fait beaucoup d’heures supplémentaires pourrait économiser quelques centaines de dollars supplémentaires. La déductibilité des prêts automobiles pourrait ajouter encore quelques centaines.
Mais additionner toutes ces déductions pour arriver à 2000 dollars nécessite que vous bénéficiez de TOUTES ces mesures simultanément — que vous receviez des pourboires ET fassiez des heures supplémentaires ET ayez un prêt automobile ET bénéficiez des autres déductions. La plupart des Américains ne cochent pas toutes ces cases. De plus, ces « économies » sont étalées sur une année fiscale complète et ne se matérialisent que si vous gagnez assez pour payer des impôts fédéraux substantiels. Les Américains à très faibles revenus — ceux qui ont le plus besoin d’aide — paient peu ou pas d’impôts fédéraux sur le revenu et ne bénéficieront donc pas de ces déductions. C’est l’ironie cruelle de transformer un « dividende » promis en déductions fiscales : vous aidez principalement ceux qui gagnent déjà assez pour payer des impôts, pas ceux qui sont le plus dans le besoin. Et vous appelez ça un cadeau au « peuple américain à revenus faibles et moyens ». Le langage compte. Les mots ont un pouvoir. Et ici, ils sont utilisés pour créer une illusion de générosité qui masque une réalité bien plus modeste.
Le contexte politique : les midterms de 2026 approchent
Cette promesse ne peut pas être comprise sans considérer le contexte politique. Les élections de mi-mandat de 2026 approchent, et les sondages montrent que l’avantage traditionnel de Trump sur les questions économiques s’érode rapidement. Les démocrates ont martelé le message que les républicains ont provoqué une « crise de la santé » en laissant expirer les subventions de l’Obamacare, causant des explosions de primes d’assurance pour des millions d’Américains. Ils ont accusé Trump de gouverner pour les riches et les corporations, pas pour les gens ordinaires. Cette promesse de 2000 dollars est la contre-attaque de Trump — une tentative de reprendre le contrôle du narrative économique en se positionnant comme le champion des travailleurs américains contre les élites mondialistes et les compagnies étrangères qui « volent » l’Amérique.
C’est un calcul politique classique : faire une promesse audacieuse qui domine le cycle médiatique, mobilise la base, et force les démocrates sur la défensive. Peu importe si la promesse peut réellement être tenue — ce qui compte, c’est l’effet immédiat sur l’opinion publique. Les démocrates se retrouvent dans une position inconfortable : s’ils critiquent la promesse, ils risquent d’apparaître comme s’opposant à donner de l’argent aux Américains ordinaires. S’ils ne disent rien, Trump contrôle le narrative. Leur stratégie a été de pointer les incohérences et l’absence de détails, de souligner que le secrétaire au Trésor lui-même ne sait pas de quoi parle le président, et de rappeler que les tarifs eux-mêmes coûtent aux Américains plus qu’ils ne leur rapportent. C’est une stratégie rationnelle basée sur les faits, mais elle manque peut-être du punch émotionnel d’une promesse simple de 2000 dollars. Les élections se gagnent souvent sur les émotions, pas sur les analyses budgétaires détaillées. Trump le sait. Il l’a toujours su.
La politique moderne est devenue un théâtre permanent où les performances comptent plus que les politiques. Où les slogans l’emportent sur les solutions. Où promettre l’impossible rapporte plus de votes qu’expliquer patiemment ce qui est réalisable. Je ne sais pas si c’est notre faute à tous — nous, le public, qui réclamons des réponses simples à des problèmes complexes — ou celle des leaders qui exploitent cyniquement cette tendance. Probablement un peu des deux. Ce que je sais, c’est que ce système ne mène nulle part de bon.
Les précédents : les stimulus checks de la pandémie
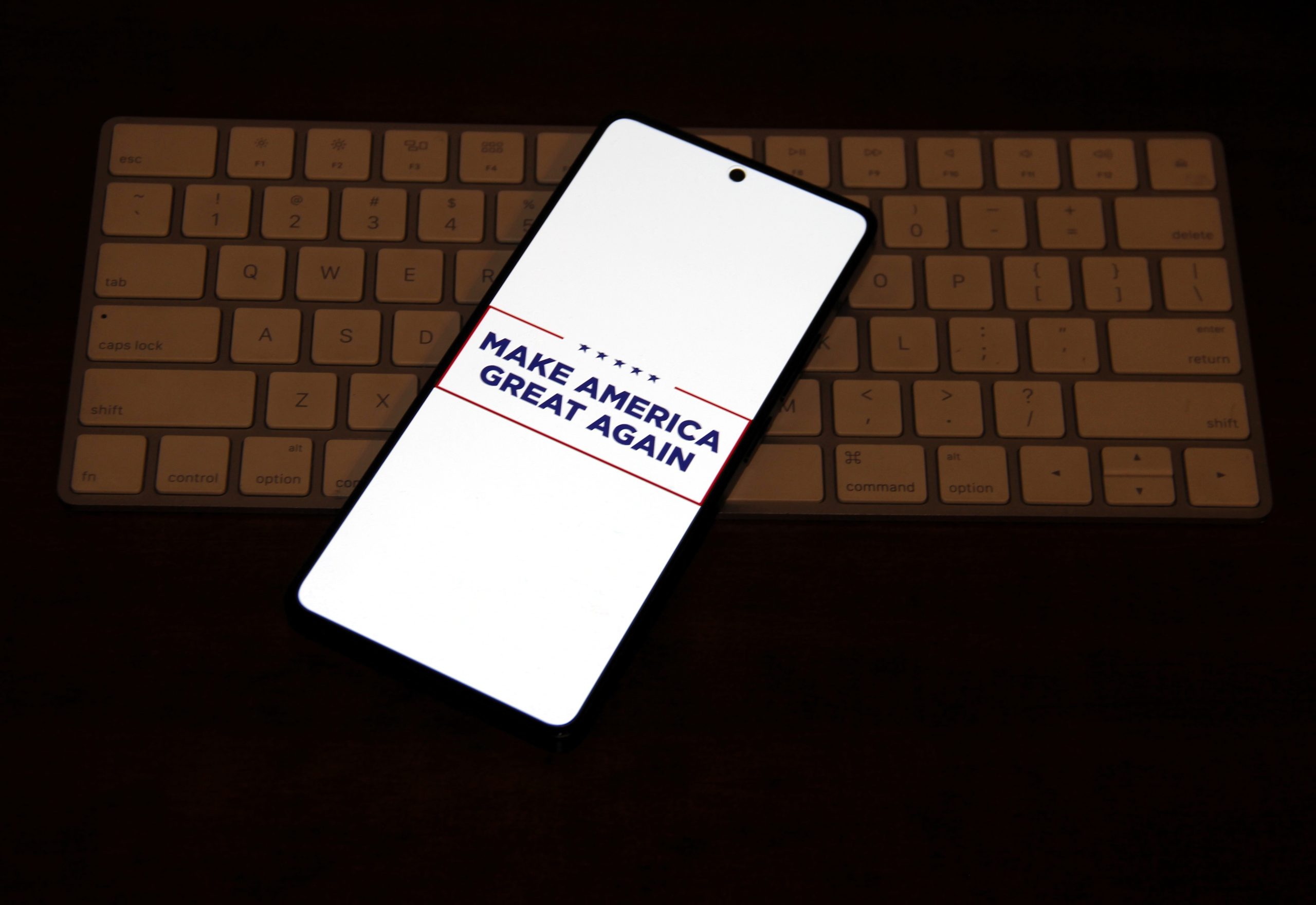
Il y a un précédent récent qui hante cette promesse : les stimulus checks distribués pendant la pandémie de COVID-19. En 2020 et 2021, le gouvernement américain a envoyé des paiements directs aux Américains — 1200 dollars, puis 600 dollars, puis 1400 dollars — pour aider les familles à traverser les confinements et la crise économique. Ces paiements ont été généralement populaires et ont effectivement aidé de nombreuses familles. Trump, qui était président lors des premiers stimulus checks, s’est assuré que son nom apparaisse sur les chèques — un mouvement sans précédent qui a transformé une aide gouvernementale en outil de branding personnel. Ce précédent explique en partie pourquoi sa promesse actuelle de 2000 dollars résonne si fortement : les gens se souviennent d’avoir reçu ces chèques auparavant et peuvent imaginer en recevoir à nouveau.
Mais il y a des différences cruciales. Les stimulus checks de la pandémie ont été adoptés par le Congrès avec un soutien bipartisan (du moins pour les premiers rounds), financés par de la dette fédérale dans un contexte de crise économique aiguë où l’activité normale était suspendue. C’était une mesure d’urgence extraordinaire pour une situation extraordinaire. La promesse actuelle de Trump, par contre, n’a aucun soutien législatif. Le Congrès n’a voté aucune loi autorisant ces paiements. Trump l’a simplement annoncé sur les réseaux sociaux, apparemment sans consulter son propre secrétaire au Trésor au préalable. De plus, nous ne sommes pas dans une crise économique aiguë comparable à 2020. L’économie tourne, le chômage est relativement bas, le marché boursier est à des niveaux records. Pourquoi alors distribuer 260 à 600 milliards de dollars en paiements directs? La justification est beaucoup moins claire. Et le financement proposé — les recettes douanières — est à la fois insuffisant et potentiellement illégal, comme l’audience de la Cour suprême l’a suggéré. Cette promesse ressemble donc à une tentative de recréer la magie politique des stimulus checks sans aucune des conditions qui les ont rendus possibles et nécessaires.
Les conséquences économiques : inflation et instabilité

Supposons un instant que Trump parvienne réellement à distribuer 260 à 600 milliards de dollars en paiements directs aux Américains. Quelles seraient les conséquences économiques? Les économistes sont presque unanimes : cela alimenterait l’inflation. Injecter des centaines de milliards de dollars dans l’économie augmente la demande pour les biens et services sans augmenter l’offre. Résultat : les prix montent. C’est exactement ce qui s’est passé en partie après les stimulus checks de la pandémie — bien que d’autres facteurs comme les disruptions des chaînes d’approvisionnement aient aussi joué un rôle majeur. Dans le contexte actuel, où l’inflation a seulement récemment commencé à baisser après les pics de 2023-2024, une nouvelle injection massive de liquidités pourrait raviver les pressions inflationnistes que la Réserve fédérale a travaillé si dur à contenir.
Il y a aussi la question de la dette fédérale. Trump promet d’utiliser « l’argent restant » après les paiements de 2000 dollars pour réduire la dette nationale de 37 billions de dollars. Mais si les recettes douanières suffisent à peine à couvrir les paiements eux-mêmes, comment peut-il rester de l’argent pour réduire la dette? Et si Trump décide de financer ces paiements en creusant le déficit — en empruntant l’argent — alors la dette augmentera au lieu de diminuer. C’est une contradiction fondamentale dans la promesse elle-même. Les Républicains se sont traditionnellement positionnés comme le parti de la responsabilité fiscale, critiquant les démocrates pour leurs dépenses excessives et l’augmentation de la dette. Mais ici, Trump propose de distribuer des centaines de milliards sans financement clair, tout en prétendant simultanément réduire la dette. Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement pas. Cette incohérence n’a pas échappé aux républicains fiscalement conservateurs au Congrès, dont certains ont exprimé en privé leur inconfort avec cette promesse. Mais publiquement, peu osent critiquer Trump, craignant la colère de sa base électorale loyale.
L’économie n’est pas de la magie. Elle ne fonctionne pas sur la base de vœux pieux ou de déclarations audacieuses. Elle obéit à des lois — offre et demande, équilibres budgétaires, conséquences inflationnistes. On peut les ignorer temporairement, les contourner avec des tours de passe-passe comptables, mais elles finissent toujours par nous rattraper. L’inflation qui dévore l’épargne. La dette qui hypothèque l’avenir. L’instabilité qui effraie les investisseurs et freine la croissance. Ces conséquences sont invisibles au moment où on fait les promesses. Elles n’apparaissent que plus tard, quand il est trop tard pour revenir en arrière.
Que se passera-t-il maintenant? Les scénarios possibles
Alors, concrètement, que va-t-il se passer avec cette promesse de 2000 dollars? Plusieurs scénarios se dessinent. Scénario un : Trump parvient à faire passer une législation au Congrès pour des paiements directs, mais sous une forme beaucoup plus limitée que promis. Peut-être 500 ou 1000 dollars au lieu de 2000. Peut-être avec des restrictions de revenus strictes qui excluent la majorité des ménages. Peut-être étalés sur plusieurs années. Il pourra alors clamer victoire — « J’ai tenu ma promesse! » — tout en ayant livré une fraction de ce qui avait été annoncé. C’est la stratégie classique : promettre la lune, livrer un caillou, puis déclarer que le caillou était exactement ce qu’on avait promis depuis le début. Scénario deux : la « promesse » se transforme silencieusement en un paquet de déductions fiscales diverses, comme Bessent l’a suggéré. Aucun chèque direct ne sera jamais envoyé. Au lieu de cela, l’administration Trump produira des calculs montrant que les Américains « économiseront » en moyenne 2000 dollars grâce aux diverses exonérations fiscales. La plupart des gens ne verront jamais cet argent de manière tangible, mais Trump pourra techniquement prétendre avoir tenu sa parole.
Scénario trois : la promesse est simplement abandonnée sans fanfare. L’administration cesse d’en parler, espérant que les médias et les électeurs passeront à autre chose. Lorsque interrogé, Trump dira qu’il « travaille toujours dessus » ou que « les démocrates obstructionnistes au Congrès l’en empêchent ». Ce scénario est probable si la Cour suprême déclare les tarifs illégaux, éliminant toute la base de financement prétendue de la promesse. Scénario quatre, le plus cynique : Trump propose une législation pour les 2000 dollars, sachant qu’elle sera bloquée par les démocrates ou même certains républicains fiscalement conservateurs. Il passe ensuite la campagne de 2026 à dire : « Je voulais vous donner cet argent, mais ILS m’en ont empêché. Votez républicain en novembre et donnez-moi une majorité plus forte, et je le ferai. » C’est une stratégie classique : promettre, ne pas livrer, puis transformer l’échec en arme politique contre l’opposition. Quel que soit le scénario qui se réalise, une chose est pratiquement certaine : les Américains ne recevront pas 2000 dollars en cash dans leur compte bancaire comme la promesse initiale le laissait entendre. Le « nous verrons » de Scott Bessent était un avertissement déguisé.
Je voudrais pouvoir prédire l’avenir avec certitude. Dire aux gens exactement ce qui va se passer pour qu’ils puissent planifier en conséquence. Mais la vérité est que même ceux qui sont au pouvoir ne semblent pas le savoir. Cette improvisation constante, cette absence de plan concret, c’est peut-être la caractéristique déterminante de cette ère politique. Nous vivons dans un état permanent d’incertitude où les annonces grandioses remplacent les politiques réfléchies, et où personne — ni les citoyens, ni les experts, ni même les responsables gouvernementaux — ne sait vraiment ce qui va se passer demain.
Les leçons ignorées : répéter les erreurs du passé

Cette saga n’est pas nouvelle. C’est le dernier chapitre d’une longue histoire de promesses politiques non tenues qui remonte bien avant Trump. Les politiciens ont toujours eu tendance à promettre plus qu’ils ne peuvent livrer. « Un poulet dans chaque pot. » « Lisez sur mes lèvres : pas de nouveaux impôts. » « Si vous aimez votre médecin, vous pourrez garder votre médecin. » L’histoire politique américaine est jonchée de promesses qui n’ont pas survécu au contact avec la réalité. Mais Trump a poussé cette tendance à un niveau extrême. Ses promesses sont plus grandioses, plus spécifiques (comme ce chiffre de 2000 dollars), et souvent complètement déconnectées de tout plan réaliste pour les tenir. Le mur payé par le Mexique. L’infrastructure Week qui n’est jamais venue. Le plan de santé « bien meilleur » que l’Obamacare qui reste dans le domaine des « concepts ». Et maintenant, 2000 dollars pour tous.
L’histoire offre pourtant des leçons. Les leaders qui ont réussi à faire des changements durables — Franklin Roosevelt avec le New Deal, Lyndon Johnson avec Medicare — ont généralement été honnêtes sur l’ampleur des défis, ont construit des coalitions larges, et ont livré des résultats concrets même si ces résultats étaient moins spectaculaires que leurs promesses initiales. Ils ont compris que gouverner nécessite de la patience, des compromis, et souvent des victoires incrementales plutôt que des transformations révolutionnaires. Trump représente l’approche opposée : promettre la révolution, gouverner par décrets et tweets, chercher les victoires médiatiques plutôt que les victoires politiques durables. Cette approche peut être électoralement efficace à court terme, mais elle est désastreuse pour la gouvernance à long terme. Les problèmes structurels ne sont jamais résolus, seulement masqués par de nouvelles annonces tonitruantes. Les institutions sont affaiblies. La confiance s’érode. Et le pays devient de plus en plus difficile à gouverner pour quiconque, quelle que soit son affiliation politique. Ces leçons de l’histoire sont là, disponibles pour quiconque veut les apprendre. Mais elles semblent être systématiquement ignorées au profit de l’instant médiatique, du tweet viral, de la promesse qui fait les gros titres.
On dit que ceux qui ignorent l’histoire sont condamnés à la répéter. Mais que se passe-t-il quand nous connaissons l’histoire, quand nous voyons clairement les patterns, et que nous choisissons quand même de répéter les mêmes erreurs? C’est là où nous en sommes. Nous savons que les promesses grandioses sans plan concret se terminent en désillusion. Nous l’avons vu encore et encore. Et pourtant, nous continuons à y croire, à espérer que cette fois sera différente. Peut-être que c’est ça, l’espoir — cette capacité à croire en dépit de toutes les preuves du contraire. Ou peut-être que c’est simplement de la folie.
Conclusion

Deux mille dollars. Un chiffre. Une promesse. Un rêve pour des millions de familles américaines. Et maintenant, un « nous verrons » qui résonne comme un glas funèbre sur les espoirs qu’il a suscités. Cette saga encapsule tout ce qui dysfonctionne dans la politique américaine contemporaine : des promesses grandioses sans plan réaliste, une rhétorique qui privilégie l’impact médiatique sur la substance, des calculs qui ne tiennent pas, et des électeurs pris en otage entre espoir et désillusion. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor de Trump, a involontairement révélé la vérité avec ses commentaires évasifs sur ABC News : cette promesse n’est pas ce qu’elle semble être. Ce ne sera probablement pas un chèque direct de 2000 dollars atterrissant dans votre compte bancaire. Ce sera, au mieux, un ensemble de déductions fiscales diverses que l’administration additionnera généreusement pour arriver à ce chiffre magique. Au pire, ce sera une promesse simplement abandonnée, oubliée dans le flot incessant des prochaines annonces tonitruantes.
Les calculs économiques ne mentent pas. Distribuer 2000 dollars à chaque ménage américain coûterait 260 milliards, voire 600 milliards si c’est par personne. Les recettes douanières, même gonflées par les tarifs agressifs de Trump, ne suffisent pas à couvrir ce coût tout en remboursant simultanément la dette nationale comme promis. De plus, ces tarifs eux-mêmes coûtent aux Américains 1200 à 1500 dollars par an en prix plus élevés, annulant largement le bénéfice supposé de tout dividende. Et la Cour suprême pourrait déclarer ces tarifs illégaux au début de 2026, effondrant toute la base de financement prétendue de cette promesse. C’est un château de cartes qui menace de s’écrouler à tout moment. Pendant ce temps, des millions d’Américains attendent, espèrent, calculent comment ils vont utiliser cet argent. Des familles reportent peut-être des dépenses essentielles en comptant sur ce chèque à venir. D’autres font des plans, rêvent d’un petit soulagement financier dans un monde où tout devient plus cher. Leur déception, lorsqu’elle viendra — et elle viendra — sera d’autant plus amère qu’elle était prévisible. Le « nous verrons » de Bessent était un avertissement que peu ont voulu entendre. Parce qu’il est tellement plus facile, tellement plus réconfortant de croire à la promesse que d’affronter la froide réalité des chiffres. Cette promesse de 2000 dollars restera comme un symbole parfait de notre époque politique — grande, bruyante, séduisante, et ultimement vide.
Source : BFMTV
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.