Naissance d’un géant dans la taïga
Le cosmodrome de Vostochny n’est pas né par hasard. Son histoire commence dans les années 2000, quand le Kremlin réalise une vérité dérangeante : la Russie dépend du Kazakhstan pour accéder à l’espace. Baïkonour, le mythique cosmodrome d’où Gagarine s’est envolé en 1961, se trouve en territoire kazakh depuis l’effondrement de l’URSS. Moscou paie un loyer annuel de plusieurs dizaines de millions de dollars pour utiliser ses propres installations historiques. Une situation humiliante pour une puissance spatiale qui se veut indépendante. Vladimir Poutine, dès son arrivée au pouvoir, comprend qu’il faut construire un nouveau port spatial, entièrement russe, entièrement souverain. Le choix se porte sur la région de l’Amour, en Extrême-Orient, près de la ville de Tsiolkovsky – un nom qui n’est pas anodin, puisqu’il rend hommage au père de l’astronautique russe. Les travaux débutent en 2012, mobilisant des milliers d’ouvriers dans des conditions extrêmes. La taïga sibérienne ne pardonne pas. Les températures descendent à moins quarante degrés l’hiver, les moustiques dévorent les travailleurs l’été.
Le premier lancement depuis Vostochny a lieu le 28 avril 2016. Une fusée Soyuz-2.1a décolle avec succès, marquant l’entrée en service opérationnel du cosmodrome. Poutine assiste personnellement à l’événement, conscient de sa portée symbolique. Depuis, le site n’a cessé de monter en puissance. Contrairement à Baïkonour, situé dans les steppes kazakhes, Vostochny bénéficie d’une position géographique plus favorable pour certains types de missions. Sa latitude de 51,8 degrés Nord permet des lancements vers des orbites polaires et héliosynchrones avec une efficacité accrue. Le cosmodrome dispose actuellement d’un seul pas de tir opérationnel, le Site 1S, dédié aux fusées Soyuz. Mais les plans d’expansion sont ambitieux. Un second complexe de lancement pour les futures fusées lourdes Angara est en construction, malgré les retards et les scandales de corruption qui ont émaillé le projet. Vostochny représente un investissement colossal, estimé à plusieurs milliards de dollars, mais pour Moscou, le jeu en vaut la chandelle. C’est le prix de l’indépendance spatiale.
Un outil géopolitique autant que technique
Mais Vostochny n’est pas qu’une question de souveraineté technique. C’est aussi un instrument de politique étrangère. En offrant des services de lancement à des pays comme l’Iran, le Bélarus ou l’Équateur, la Russie se positionne comme une alternative crédible aux acteurs occidentaux. Ces nations, souvent exclues des programmes spatiaux américains ou européens pour des raisons politiques, trouvent en Moscou un partenaire disposé à les aider sans poser trop de questions. Le lancement du 29 décembre 2024 illustre parfaitement cette stratégie. Parmi les cinquante charges utiles secondaires, on trouve trois satellites iraniens : Kowsar-1.5, Paya et Zafar-2. Ces engins sont officiellement destinés à l’observation de la Terre et à des missions scientifiques. Mais dans le contexte des tensions entre Téhéran et l’Occident, leur présence dans l’espace soulève des questions. Les États-Unis et Israël surveillent de près les capacités spatiales iraniennes, craignant qu’elles ne servent à des fins militaires ou de renseignement.
Le Bélarus, autre paria occidental depuis la répression brutale des manifestations de 2020 et son soutien à l’invasion russe de l’Ukraine, bénéficie également de ce lancement. Deux satellites biélorusses, NASBSat-1 et NASBSat-2, ont été placés en orbite. Pour Minsk, c’est une victoire symbolique. Le régime d’Alexandre Loukachenko peut ainsi démontrer à sa population qu’il reste capable de mener des projets technologiques ambitieux malgré les sanctions occidentales. L’Équateur, quant à lui, représente un cas différent. Ce petit pays d’Amérique du Sud n’est pas un paria international, mais ses ressources limitées l’empêchent d’accéder facilement aux services de lancement occidentaux, souvent plus coûteux. En se tournant vers la Russie, Quito obtient un accès à l’espace à moindre coût, tout en diversifiant ses partenaires internationaux. Le satellite équatorien UTE-Galapagos embarqué lors de cette mission témoigne de cette coopération pragmatique. Vostochny devient ainsi le hub spatial des nations que l’Occident a oubliées ou rejetées.
Il y a quelque chose de profondément ironique dans tout ça. L’Occident, qui se targue de promouvoir l’accès universel à l’espace, qui finance des programmes d’aide au développement spatial pour les pays émergents, se retrouve court-circuité par Moscou. Pourquoi ? Parce qu’on a politisé l’espace. Parce qu’on a décidé que certains pays ne méritaient pas d’avoir des satellites. L’Iran ? Trop dangereux. Le Bélarus ? Trop autoritaire. Et pendant qu’on moralise, la Russie agit. Elle lance. Elle livre. Elle construit des partenariats. On peut critiquer Poutine autant qu’on veut – et Dieu sait qu’il y a matière – mais sur ce coup-là, il a compris quelque chose que nous avons oublié : l’espace n’attend pas. Soit tu y vas, soit quelqu’un d’autre prend ta place.
Section 3 : les satellites Aist-2T, fierté russe

Une technologie d’observation de pointe
Les deux satellites Aist-2T constituent la charge utile principale de cette mission. Développés par RKTs Progress à Samara, ces engins de 670 kilogrammes chacun représentent une évolution significative par rapport à leur prédécesseur, l’Aist-2D lancé en 2016. Leur mission : photographier la surface terrestre avec une précision redoutable. La résolution atteint 1,6 mètre en mode panchromatique lorsque le satellite pointe directement vers le sol, et jusqu’à 1,9 mètre en mode stéréoscopique. Pour les images multispectrales et en couleur, la résolution descend à 4,8 mètres en nadir et 5,9 mètres en stéréo. Ces chiffres peuvent sembler abstraits, mais ils signifient concrètement qu’Aist-2T peut distinguer une voiture individuelle, identifier un bâtiment spécifique, suivre des mouvements de troupes. C’est une capacité de surveillance qui rivalise avec les meilleurs satellites commerciaux occidentaux, et qui dépasse largement ce que la plupart des nations peuvent s’offrir.
La grande innovation d’Aist-2T réside dans son système de caméras doubles. Contrairement à l’Aist-2D qui n’embarquait qu’une seule caméra, la version 2T en possède deux, permettant de capturer des images stéréoscopiques. Cette capacité est cruciale pour créer des modèles numériques de terrain, des représentations en trois dimensions de la surface terrestre. Applications militaires évidentes : planification d’opérations, analyse de terrain, détection de changements. Mais aussi applications civiles : cartographie, gestion des ressources naturelles, surveillance environnementale, planification urbaine. Autre amélioration majeure : le système de propulsion intégré. Pour la première fois sur un satellite Aist, des moteurs permettent de modifier l’orbite, d’ajuster la position, de prolonger la durée de vie opérationnelle. Enfin, la bande passante de transmission des données a été multipliée par dix, passant de 150 mégabits par seconde sur Aist-2D à 1600 mégabits par seconde sur la version 2T. Cela signifie que les images peuvent être téléchargées vers les stations au sol beaucoup plus rapidement, réduisant le délai entre la capture et l’exploitation des données.
Un projet marqué par les retards
Mais le chemin vers le lancement n’a pas été sans embûches. Initialement prévu pour novembre 2022, le décollage d’Aist-2T a été repoussé à plusieurs reprises. En 2021, la date glisse à 2023. Puis à décembre 2024. En octobre 2024, nouveau report, cette fois jusqu’en mars 2025. Début 2025, on parle de juin, puis d’août, avant de finalement fixer le lancement au 28 décembre 2025. Ces retards successifs reflètent les difficultés du secteur spatial russe, confronté à des problèmes de financement, de gestion de projet, et aux conséquences des sanctions occidentales qui compliquent l’accès à certains composants électroniques. Roscosmos, l’agence spatiale russe, a tenté de minimiser ces délais, invoquant des raisons techniques et la nécessité de garantir la fiabilité des systèmes. Mais dans les couloirs de l’industrie spatiale, on murmure que les problèmes sont plus profonds. Corruption, détournements de fonds, incompétence managériale : les maux qui rongent l’économie russe n’épargnent pas le secteur spatial.
Malgré ces difficultés, le lancement du 29 décembre 2024 s’est déroulé sans accroc. La fusée Soyuz-2.1b a fonctionné parfaitement, l’étage supérieur Fregat a effectué ses manœuvres orbitales avec précision, et les satellites Aist-2T ont été déployés sur leur orbite héliosynchrone à 550 kilomètres d’altitude. Cette orbite particulière, inclinée à environ 98,57 degrés par rapport à l’équateur, permet aux satellites de survoler chaque point de la Terre à la même heure solaire locale, garantissant des conditions d’éclairage constantes pour la prise d’images. C’est l’orbite de prédilection pour les satellites d’observation, utilisée aussi bien par les engins civils que militaires. Les deux Aist-2T sont positionnés sur des plans orbitaux différents, maximisant leur couverture géographique. Ensemble, ils forment une constellation d’observation capable de photographier n’importe quel point du globe plusieurs fois par jour. Pour la Russie, c’est un atout stratégique majeur, d’autant plus précieux dans le contexte actuel de tensions géopolitiques.
Les retards, les problèmes, les scandales. Oui, tout ça existe. Mais au final, la fusée a décollé. Les satellites sont en orbite. Ils fonctionnent. Et c’est ça qui compte, non ? On peut se moquer des dysfonctionnements russes, pointer du doigt la corruption, ricaner devant les reports successifs. Mais pendant qu’on ricane, Moscou met des satellites en orbite. Pendant qu’on débat de l’éthique de la coopération spatiale avec des régimes autoritaires, la Russie construit des constellations. Il y a une leçon là-dedans, quelque part. Une leçon sur la différence entre parler et agir. Entre promettre et livrer. L’Occident excelle dans le premier. La Russie, malgré tous ses défauts, continue de faire le second.
Section 4 : l'Iran dans l'espace, cauchemar occidental
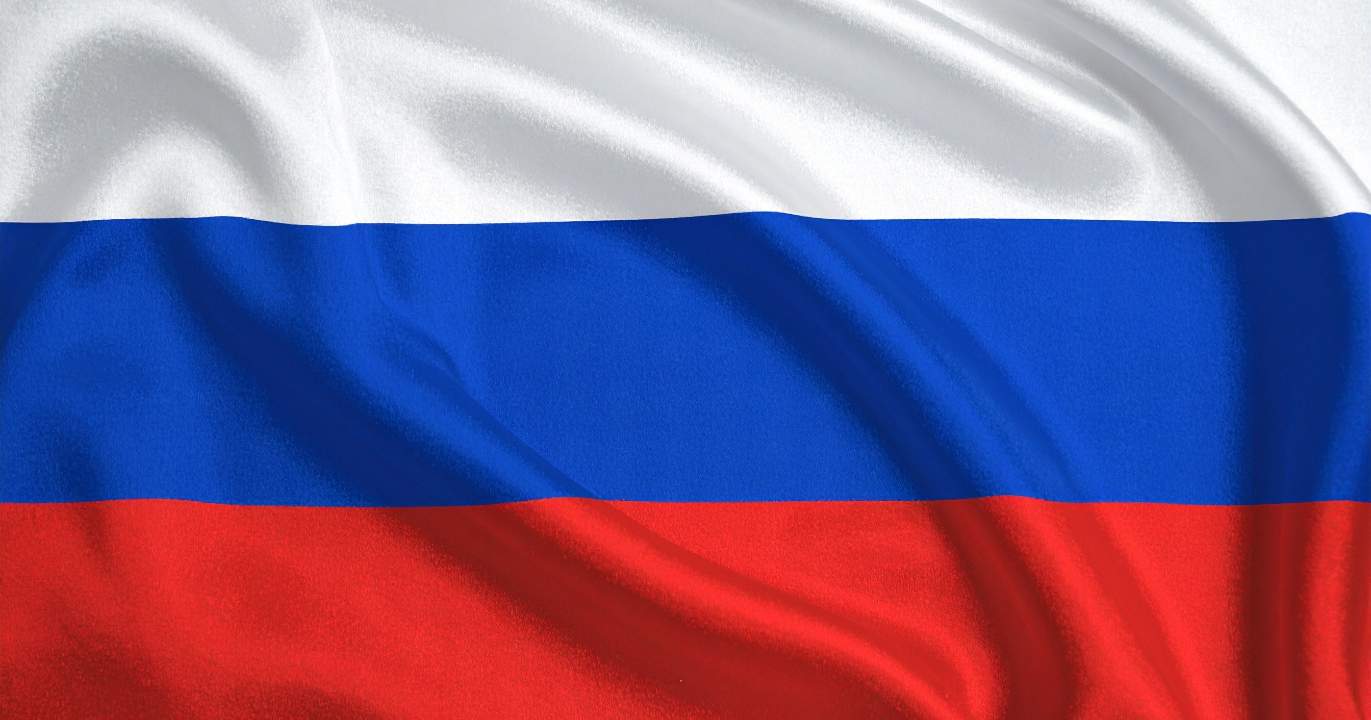
Trois satellites qui font trembler Washington
Parmi les cinquante charges utiles secondaires de cette mission, trois satellites iraniens attirent particulièrement l’attention : Kowsar-1.5, Paya (aussi appelé Tolou-3) et Zafar-2. Officiellement, ces engins sont destinés à l’observation de la Terre et à des missions scientifiques. Kowsar-1.5, également désigné sous le nom de 2See-1, est un satellite d’imagerie développé par l’Agence spatiale iranienne. Paya, pesant environ 50 kilogrammes et mesurant 1,2 mètre sur 1 mètre, est décrit comme un satellite de télédétection. Zafar-2, le plus lourd des trois avec 113 kilogrammes, poursuit également des objectifs d’observation terrestre. Pour Téhéran, ces lancements représentent une victoire majeure. Depuis des années, l’Iran tente de développer son programme spatial malgré les sanctions internationales et les sabotages présumés de ses installations par Israël et les États-Unis. Plusieurs tentatives de lancement depuis le territoire iranien ont échoué, alimentant les soupçons d’interventions extérieures.
En se tournant vers la Russie, l’Iran contourne ces obstacles. Moscou fournit non seulement le service de lancement, mais aussi, selon certaines sources, une assistance technique pour le développement des satellites eux-mêmes. Cette coopération spatiale s’inscrit dans un rapprochement stratégique plus large entre les deux pays, renforcé par leur soutien commun au régime syrien de Bachar al-Assad et, plus récemment, par la fourniture de drones iraniens à la Russie pour son offensive en Ukraine. Pour Washington et ses alliés, ces satellites iraniens sont une source d’inquiétude majeure. Les capacités d’observation spatiale peuvent servir à des fins militaires : surveillance des mouvements de troupes, identification de cibles potentielles, évaluation des dommages après des frappes. Dans le contexte des tensions persistantes entre l’Iran et Israël, avec des échanges de frappes de plus en plus fréquents, l’accès de Téhéran à des satellites d’observation modifie l’équilibre stratégique régional. Israël, qui dispose de ses propres satellites espions sophistiqués, voit d’un très mauvais œil cette montée en puissance iranienne.
Une coopération qui défie les sanctions
Le lancement de ces satellites iraniens depuis Vostochny constitue également un défi direct aux sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne. Ces sanctions visent notamment à empêcher l’Iran d’accéder aux technologies spatiales, considérées comme potentiellement duales, c’est-à-dire utilisables à la fois pour des applications civiles et militaires. En particulier, Washington craint que les technologies de lanceurs spatiaux ne soient détournées pour développer des missiles balistiques intercontinentaux. Les mêmes moteurs-fusées qui propulsent un satellite en orbite peuvent, avec quelques modifications, lancer une ogive nucléaire à des milliers de kilomètres. Cette préoccupation n’est pas nouvelle. Depuis des décennies, les États-Unis tentent de limiter la prolifération des technologies de missiles, avec un succès mitigé. Le Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), créé en 1987, vise à restreindre les transferts de technologies liées aux missiles capables de transporter des armes de destruction massive. Mais la Russie, bien que membre du MTCR, interprète ses obligations de manière flexible quand il s’agit de ses alliés.
Pour Moscou, lancer des satellites iraniens présente plusieurs avantages. D’abord, c’est une source de revenus non négligeable pour l’industrie spatiale russe, qui peine à trouver des clients depuis que les sanctions occidentales ont tari une partie de ses marchés traditionnels. Ensuite, c’est un moyen de renforcer les liens avec Téhéran, un allié précieux dans un Moyen-Orient de plus en plus complexe. Enfin, c’est une manière de défier l’hégémonie occidentale dans le domaine spatial, de montrer que la Russie reste un acteur incontournable malgré son isolement diplomatique. Les États-Unis ont protesté contre ces lancements, qualifiant la coopération russo-iranienne dans le domaine spatial de « déstabilisante » et « contraire aux intérêts de la sécurité internationale ». Mais ces protestations restent largement symboliques. Washington n’a pas les moyens d’empêcher physiquement ces lancements, et les sanctions supplémentaires qu’il pourrait imposer auraient un impact limité sur des pays déjà lourdement sanctionnés. Le résultat : l’Iran continue de développer ses capacités spatiales, avec l’aide de la Russie, sous le regard impuissant de l’Occident.
Voilà où nous en sommes. L’Iran, que nous avons passé des décennies à isoler, à sanctionner, à diaboliser, met des satellites en orbite. Pas depuis son propre territoire – ça, on a réussi à le saboter. Mais depuis la Russie. Et nous, qu’est-ce qu’on fait ? On proteste. On dénonce. On menace de nouvelles sanctions. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Comme si Téhéran et Moscou allaient soudainement se dire : « Oh, Washington n’est pas content, arrêtons tout. » C’est pathétique. Notre stratégie d’isolement a échoué. Elle a même produit l’effet inverse : elle a poussé nos adversaires dans les bras les uns des autres. L’Iran et la Russie n’étaient pas des alliés naturels. On les a rendus alliés. Bravo.
Section 5 : le Bélarus, satellite de Moscou dans tous les sens
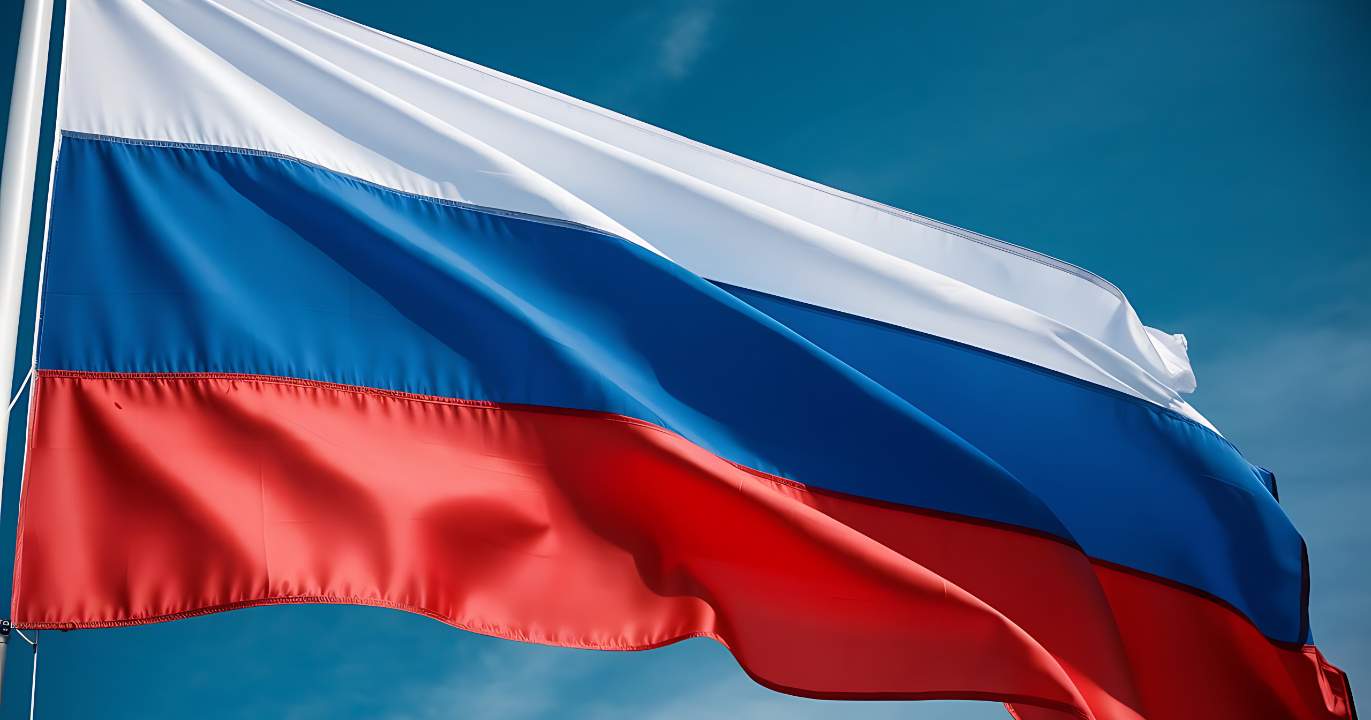
Deux cubesats pour un régime contesté
Le Bélarus a également profité de ce lancement pour placer deux satellites en orbite : NASBSat-1 et NASBSat-2. Ces engins, développés par la société Sputniks en collaboration avec des institutions biélorusses, sont des cubesats de format 6U, c’est-à-dire des satellites miniatures mesurant environ 10 centimètres sur 20 centimètres sur 30 centimètres. Malgré leur petite taille, ces satellites embarquent des instruments d’observation de la Terre et de télécommunications. Pour le régime d’Alexandre Loukachenko, ce lancement revêt une importance symbolique considérable. Depuis la répression brutale des manifestations de 2020 et le soutien apporté à l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, le Bélarus est devenu un paria international. L’Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions sévères, ciblant l’économie, les dirigeants et les secteurs stratégiques du pays. Dans ce contexte, pouvoir afficher des réalisations technologiques comme le lancement de satellites devient un enjeu de légitimité politique pour Loukachenko.
Le programme spatial biélorusse, bien que modeste, existe depuis plusieurs années. Le pays a lancé son premier satellite, BKA, en 2012, depuis Baïkonour au Kazakhstan. Depuis, plusieurs autres engins ont suivi, toujours avec l’aide de la Russie. Cette dépendance totale vis-à-vis de Moscou pour l’accès à l’espace reflète la situation géopolitique du Bélarus : un pays coincé entre la Russie et l’Union européenne, qui a choisi son camp, ou plutôt qui y a été poussé par les circonstances. Les satellites NASBSat sont présentés comme des outils de développement technologique et de formation pour les ingénieurs biélorusses. Ils permettent de tester des technologies, de collecter des données, de maintenir une expertise spatiale nationale. Mais au-delà de ces objectifs techniques, ils servent surtout à démontrer que le Bélarus reste capable de mener des projets ambitieux malgré les sanctions. C’est un message destiné autant à la population intérieure qu’à la communauté internationale : Minsk ne plie pas, ne s’effondre pas, continue d’avancer.
Une intégration spatiale dans l’orbite russe
La coopération spatiale entre le Bélarus et la Russie s’inscrit dans un processus d’intégration politique et économique plus large. Les deux pays forment officiellement un « État d’Union » depuis 1999, une entité censée créer une union politique et économique étroite, bien que les progrès concrets aient été limités pendant longtemps. Mais depuis 2020, et surtout depuis l’invasion de l’Ukraine, cette intégration s’est accélérée. Le Bélarus a autorisé le déploiement de troupes russes sur son territoire, servi de base arrière pour l’offensive contre Kiev, accepté le stationnement d’armes nucléaires tactiques russes. En échange, Moscou fournit un soutien économique vital, des livraisons d’énergie à prix réduit, et un accès à ses infrastructures, y compris spatiales. Le lancement de satellites biélorusses depuis Vostochny s’inscrit dans cette logique. C’est un service que la Russie rend à son allié le plus fidèle, un moyen de renforcer les liens, de créer des interdépendances.
Pour le Bélarus, cette dépendance spatiale vis-à-vis de la Russie n’est pas sans risques. Elle signifie que Minsk n’a aucune autonomie stratégique dans ce domaine, qu’elle dépend entièrement du bon vouloir de Moscou. Si les relations se détérioraient – hypothèse peu probable dans le contexte actuel, mais pas impossible à long terme – le Bélarus se retrouverait sans accès à l’espace. Mais pour l’instant, Loukachenko n’a pas d’autre choix. L’Occident lui a fermé ses portes, et la Russie est le seul partenaire disposé à l’aider. Les satellites NASBSat, aussi modestes soient-ils, symbolisent cette réalité géopolitique : un petit pays pris en étau, qui a choisi son camp par nécessité autant que par conviction, et qui tente de maintenir une façade de souveraineté technologique malgré sa dépendance totale. C’est triste, d’une certaine manière. Mais c’est aussi révélateur de l’état du monde en 2025 : un monde de blocs, où les petits pays doivent choisir leur protecteur, où l’indépendance véritable est un luxe que peu peuvent se permettre.
Le Bélarus me fait penser à ces pays satellites de l’URSS pendant la Guerre froide. Officiellement souverains, en réalité totalement inféodés à Moscou. Loukachenko joue le rôle du dirigeant loyal, celui qui ne pose pas de questions, qui suit la ligne, qui obtient en échange protection et ressources. Ses satellites dans l’espace ne sont que le reflet de sa situation sur Terre : en orbite autour de la Russie, incapable de s’en échapper. On peut le mépriser pour ça. On peut le condamner pour sa répression, sa brutalité, sa complicité dans l’agression contre l’Ukraine. Mais il faut aussi comprendre qu’il n’avait pas beaucoup d’options. L’Occident ne voulait pas de lui. La Russie, si. Alors il a choisi. Et maintenant, il vit avec les conséquences de ce choix.
Section 6 : l'Équateur et les autres, la diversité des passagers
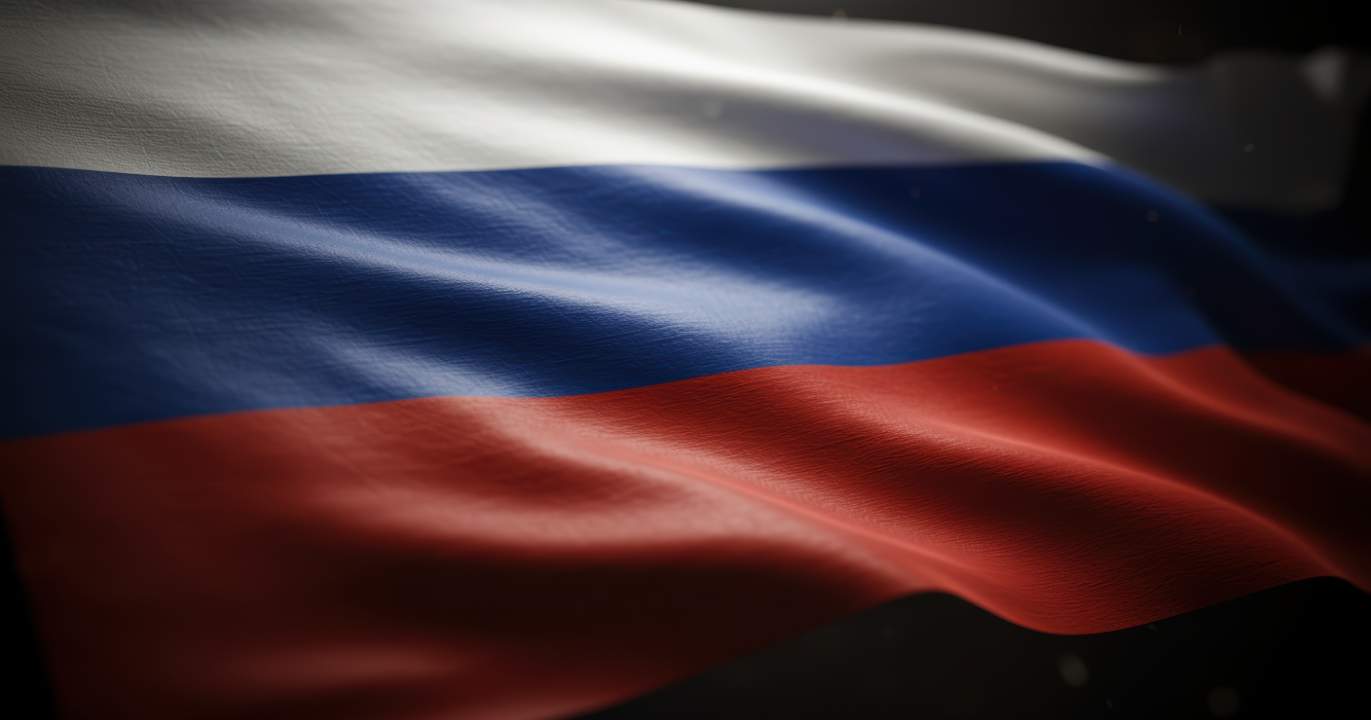
Un satellite équatorien pour les Galapagos
L’Équateur représente un cas différent parmi les bénéficiaires de ce lancement. Contrairement à l’Iran ou au Bélarus, ce pays d’Amérique du Sud n’est pas un paria international. Il entretient des relations normales avec l’Occident, participe aux institutions internationales, respecte globalement les normes démocratiques. Mais l’Équateur est aussi un petit pays avec des ressources limitées, et son programme spatial reste embryonnaire. Le satellite UTE-Galapagos embarqué lors de cette mission témoigne de cette réalité. Développé par l’Université Technique de l’Équateur, cet engin est probablement un cubesat destiné à des missions éducatives et scientifiques. Les détails techniques restent flous, mais on peut supposer qu’il servira à former des ingénieurs équatoriens, à collecter des données environnementales, peut-être à surveiller les célèbres îles Galapagos qui donnent leur nom au satellite. Pour Quito, se tourner vers la Russie pour lancer ce satellite est avant tout une question de pragmatisme économique.
Les services de lancement russes sont généralement moins coûteux que leurs équivalents occidentaux. Une fusée Soyuz peut embarquer des dizaines de petits satellites en tant que charges utiles secondaires, partageant les coûts entre de nombreux clients. Pour un pays comme l’Équateur, dont le budget spatial est minuscule, c’est une opportunité inestimable. Les alternatives occidentales existent – SpaceX propose des lancements de cubesats via son programme Rideshare, l’Europe offre des services similaires avec Arianespace – mais elles ne sont pas toujours accessibles ou abordables pour les petits acteurs. La Russie, en revanche, a une longue tradition de coopération spatiale avec les pays en développement, héritée de l’époque soviétique. Moscou voit dans ces partenariats un moyen de maintenir son influence, de créer des liens, de se positionner comme une alternative crédible aux puissances occidentales. Pour l’Équateur, c’est simplement une opportunité de participer à l’aventure spatiale sans se ruiner.
Une mosaïque de petits satellites
Au-delà de l’Iran, du Bélarus et de l’Équateur, cette mission transportait une véritable mosaïque de petits satellites représentant une diversité d’acteurs et d’objectifs. Parmi eux, des cubesats développés par des universités russes dans le cadre du programme UniverSat, destiné à former la prochaine génération d’ingénieurs spatiaux. Des satellites commerciaux de la société Sitronics, spécialisée dans l’identification automatique des navires via le système AIS (Automatic Identification System), crucial pour la surveillance maritime. Des engins expérimentaux testant de nouvelles technologies, comme les satellites Marafon-IoT développés par ISS Reshetnev, censés ouvrir la voie à un système d’Internet des Objets spatial, bien que ce projet soit désormais menacé par les coupes budgétaires. Des satellites scientifiques, comme Skorpion, équipé de détecteurs de sursauts gamma et de sources transitoires, destiné à l’étude des phénomènes astrophysiques les plus violents de l’univers.
Cette diversité reflète l’évolution du secteur spatial mondial. L’ère des satellites géants et coûteux, développés exclusivement par les agences gouvernementales, cède progressivement la place à une démocratisation de l’accès à l’espace. Les cubesats, ces satellites miniatures standardisés, ont révolutionné l’industrie en rendant l’espace accessible aux universités, aux startups, aux petits pays. Une mission comme celle du 29 décembre 2024, avec ses cinquante charges utiles secondaires, aurait été impensable il y a vingt ans. Aujourd’hui, c’est devenu la norme. Les lanceurs modernes sont conçus pour embarquer des dizaines de petits satellites en plus de leur charge utile principale, maximisant l’efficacité économique de chaque lancement. La Russie, avec ses fusées Soyuz fiables et éprouvées, s’est positionnée comme un acteur majeur de ce marché des lancements multiples. Vostochny, en particulier, est devenu un hub pour ces missions complexes, où des satellites de toutes origines et de toutes tailles partagent le même voyage vers l’orbite.
Cette diversité me fascine. Dans une seule fusée, on trouve des satellites iraniens qui inquiètent Washington, des cubesats universitaires russes qui forment des étudiants, des engins commerciaux qui traquent des navires, des instruments scientifiques qui étudient les sursauts gamma. C’est beau, non ? C’est l’espace tel qu’il devrait être : un lieu de coopération, de science, d’opportunités pour tous. Pas un terrain de jeu réservé aux grandes puissances. Pas un outil de domination géopolitique. Juste un endroit où n’importe qui, avec une bonne idée et un peu de financement, peut envoyer un satellite. Évidemment, la réalité est plus complexe. Certains de ces satellites servent des objectifs militaires ou de renseignement. D’autres sont des outils de propagande pour des régimes autoritaires. Mais quand même. Il y a quelque chose d’espoir dans cette diversité.
Section 7 : la fusée Soyuz, cheval de bataille spatial
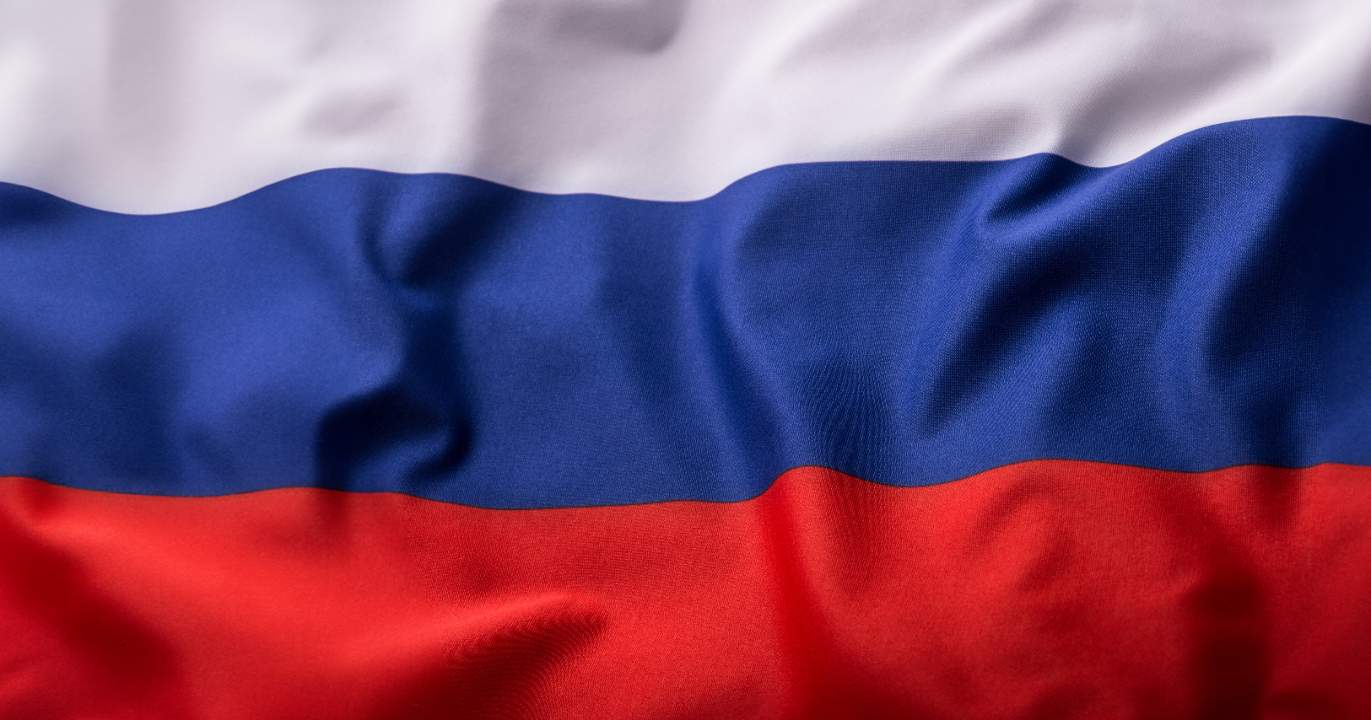
Une lignée qui traverse les décennies
La fusée Soyuz-2.1b qui a propulsé cette mission vers l’espace appartient à une lignée légendaire. Les fusées Soyuz, sous diverses variantes, volent depuis 1966. Oui, vous avez bien lu : 1966. Presque soixante ans de service continu. Aucun autre lanceur au monde ne peut se targuer d’une telle longévité. La famille Soyuz descend directement de la R-7 Semiorka, le premier missile balistique intercontinental soviétique, développé dans les années 1950 sous la direction de Sergueï Korolev, le père du programme spatial soviétique. C’est une R-7 modifiée qui a lancé Spoutnik en 1957, ouvrant l’ère spatiale. C’est une R-7 qui a propulsé Youri Gagarine en orbite en 1961, faisant de lui le premier humain dans l’espace. Depuis, les fusées dérivées de cette conception originale n’ont cessé d’évoluer, s’améliorant progressivement tout en conservant l’architecture de base : un corps central entouré de quatre boosters coniques, une silhouette immédiatement reconnaissable.
La version Soyuz-2.1b utilisée pour cette mission représente l’une des évolutions les plus récentes de cette famille. Introduite en 2006, elle se distingue de ses prédécesseurs par son troisième étage modernisé, équipé du moteur RD-0124, plus puissant et plus efficace que les anciens moteurs RD-0110. Cette amélioration permet d’augmenter la charge utile transportable, un avantage crucial pour des missions comme celle du 29 décembre 2024, qui embarquait cinquante-deux satellites. La Soyuz-2.1b mesure environ 46 mètres de hauteur et pèse près de 312 tonnes au décollage, dont la majeure partie est constituée de carburant. Elle utilise un mélange de kérosène et d’oxygène liquide, une combinaison éprouvée, relativement simple à manipuler et moins coûteuse que les carburants plus exotiques utilisés par certains lanceurs modernes. La fiabilité de Soyuz est légendaire. Sur des centaines de lancements, les échecs restent rares, et la fusée a acquis une réputation de robustesse et de prévisibilité qui en fait un choix privilégié pour les missions critiques.
L’étage supérieur Fregat, le chef d’orchestre orbital
Mais la vraie star de cette mission, c’est l’étage supérieur Fregat. Cet engin, développé par NPO Lavochkin, est un véritable remorqueur spatial. Après que les trois premiers étages de la Soyuz ont propulsé la charge utile hors de l’atmosphère, c’est Fregat qui prend le relais pour effectuer les manœuvres orbitales complexes nécessaires au déploiement des satellites. Pour la mission du 29 décembre 2024, Fregat a dû réaliser une chorégraphie orbitale sophistiquée. Première allumage de son moteur au-dessus de l’Arctique, environ neuf minutes après le décollage, pour insérer l’ensemble dans une orbite de transfert. Puis une longue phase de vol libre, pendant laquelle Fregat et ses passagers ont grimpé passivement vers l’apogée de leur trajectoire. Deuxième allumage près de l’Antarctique, environ une heure après le lancement, pour circulariser l’orbite à 830 kilomètres d’altitude. Déploiement des deux satellites Aist-2T. Puis, au cours des heures suivantes, séparation progressive des cinquante charges utiles secondaires, chacune larguée au moment optimal pour atteindre sa position orbitale désignée.
Cette capacité à effectuer de multiples allumages, à rester en vol pendant plusieurs heures, à déployer des satellites sur différentes orbites, fait de Fregat un outil extrêmement flexible. C’est ce qui permet à la Russie de proposer des missions de covoiturage spatial aussi complexes, où des dizaines de clients différents partagent le même lancement tout en atteignant des orbites légèrement différentes. Après avoir largué son dernier passager, environ cinq heures après le décollage, Fregat a effectué une dernière manœuvre pour se placer sur une trajectoire de rentrée atmosphérique, se désintégrant au-dessus du Pacifique équatorial. Cette destruction contrôlée est importante pour éviter de créer des débris spatiaux supplémentaires, un problème croissant qui menace la durabilité à long terme des activités spatiales. La Russie, malgré ses nombreux défauts, prend ce problème au sérieux, du moins pour ses missions récentes. Fregat, avec sa capacité à se désorbiter proprement, contribue à cette responsabilité environnementale spatiale.
Il y a quelque chose de rassurant dans la Soyuz. Dans un monde spatial de plus en plus dominé par les fusées réutilisables de SpaceX, par les innovations disruptives, par les milliardaires qui jouent aux astronautes, la vieille Soyuz continue de faire son boulot. Pas de fioritures. Pas de livestreams spectaculaires avec des atterrissages de boosters. Juste une fusée qui décolle, qui met des satellites en orbite, qui fonctionne. C’est l’approche russe en un mot : pragmatique, éprouvée, fiable. Pas la plus sexy. Pas la plus innovante. Mais efficace. Et dans l’espace, l’efficacité compte plus que le spectacle. Enfin, normalement. Parce que de nos jours, avec Elon Musk qui transforme chaque lancement en événement médiatique, on a tendance à l’oublier.
Section 8 : Roscosmos, un géant aux pieds d'argile
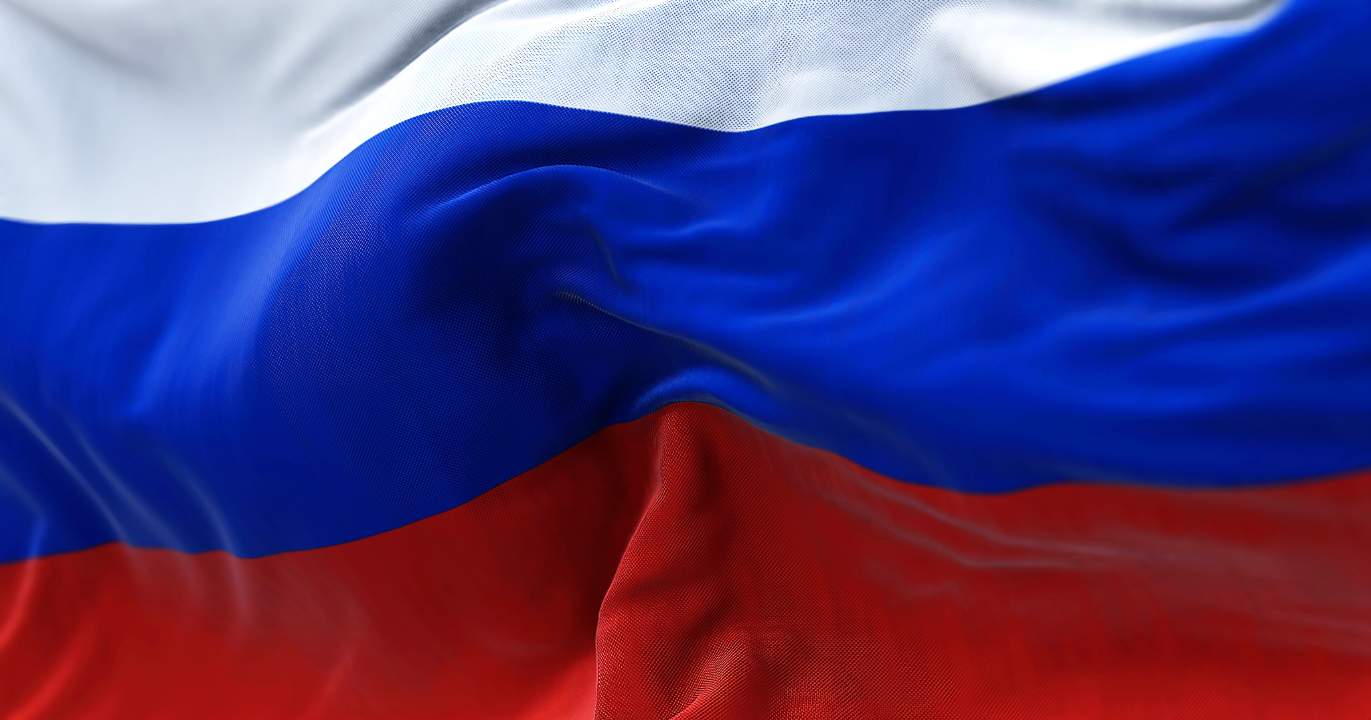
Les défis d’une agence spatiale en crise
Roscosmos, l’agence spatiale russe, traverse une période difficile. Créée en 1992 après l’effondrement de l’URSS, elle a hérité du glorieux programme spatial soviétique, mais aussi de ses infrastructures vieillissantes et de ses problèmes structurels. Pendant les années 1990 et 2000, Roscosmos a tant bien que mal maintenu les activités spatiales russes, s’appuyant sur les revenus générés par les lancements commerciaux et le transport d’astronautes vers la Station spatiale internationale. Mais depuis une décennie, l’agence accumule les difficultés. Les scandales de corruption se multiplient, avec des détournements de fonds massifs révélés dans plusieurs projets majeurs, notamment la construction du cosmodrome de Vostochny. Les retards s’accumulent sur pratiquement tous les programmes. Les échecs de lancement, bien que rares, entachent la réputation de fiabilité de l’industrie spatiale russe. Et surtout, le budget stagne, voire diminue en termes réels, alors que les ambitions affichées restent démesurées.
Les sanctions occidentales imposées après l’annexion de la Crimée en 2014, puis renforcées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, ont aggravé la situation. Roscosmos a perdu une partie importante de ses clients commerciaux occidentaux, qui se sont tournés vers SpaceX et d’autres fournisseurs. L’accès à certains composants électroniques de haute technologie, souvent fabriqués en Occident ou en Asie, est devenu plus difficile, obligeant l’industrie russe à développer des substituts nationaux, un processus long et coûteux. La coopération internationale, autrefois un pilier du programme spatial russe, s’est effondrée. L’Europe a suspendu les lancements de Soyuz depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Les États-Unis ont mis fin à leur dépendance vis-à-vis des fusées russes pour envoyer leurs astronautes vers l’ISS, grâce aux capsules Crew Dragon de SpaceX. Même la coopération sur l’ISS elle-même, symbole de collaboration post-Guerre froide, est menacée, la Russie ayant annoncé son intention de se retirer de la station après 2028 pour construire sa propre station orbitale nationale.
Entre ambitions et réalités budgétaires
Malgré ces difficultés, Roscosmos continue d’afficher des ambitions grandioses. Retour sur la Lune. Missions vers Mars. Construction d’une nouvelle station spatiale. Développement de nouveaux lanceurs lourds. Sur le papier, le programme spatial russe reste impressionnant. Dans la réalité, les ressources manquent cruellement. Le budget de Roscosmos pour 2025 est estimé à environ 200 milliards de roubles, soit environ 2 milliards de dollars au taux de change actuel. C’est dérisoire comparé aux 25 milliards de dollars de la NASA, ou même aux budgets spatiaux chinois et européens. Avec de tels moyens, impossible de tout faire. Des choix doivent être faits, des priorités établies. Mais la gouvernance de Roscosmos, marquée par l’ingérence politique et le manque de vision stratégique claire, rend ces arbitrages difficiles. Le résultat : des projets qui s’éternisent, des programmes qui sont lancés puis abandonnés, des ressources gaspillées dans des initiatives sans lendemain.
Le lancement du 29 décembre 2024, malgré son succès technique, illustre aussi ces contradictions. Les satellites Aist-2T, initialement prévus pour 2022, ont finalement décollé avec trois ans de retard. Les satellites Marafon-IoT embarqués comme charges secondaires appartiennent à un programme désormais menacé d’annulation faute de financement. Même Vostochny, le cosmodrome censé incarner la renaissance spatiale russe, reste largement sous-utilisé, avec seulement une poignée de lancements par an, loin des objectifs initiaux. Roscosmos survit, mais ne prospère pas. L’agence s’appuie sur ses acquis historiques – la fiabilité de Soyuz, l’expertise accumulée pendant des décennies, la capacité à opérer dans des conditions difficiles – mais peine à innover, à se renouveler, à s’adapter aux nouvelles réalités du secteur spatial. Pendant ce temps, SpaceX révolutionne l’industrie avec ses fusées réutilisables, la Chine multiplie les succès spectaculaires, l’Europe tente de maintenir son indépendance d’accès à l’espace. La Russie, elle, regarde passer le train de la modernisation spatiale, prisonnière de ses problèmes internes.
Roscosmos me rend triste. Vraiment. Parce que cette agence, cet héritage, ce savoir-faire, tout ça mérite mieux. Les Russes ont été les premiers dans l’espace. Les premiers à mettre un satellite en orbite. Les premiers à envoyer un homme là-haut. Les premiers à marcher dans l’espace. Les premiers à poser un engin sur la Lune. Leur histoire spatiale est glorieuse. Et maintenant ? Maintenant, ils lancent des satellites pour l’Iran et le Bélarus pendant que SpaceX envoie des dizaines de fusées par mois. C’est la déchéance d’un géant. Et le pire, c’est que c’est évitable. Avec les bonnes réformes, les bons investissements, la bonne gouvernance, la Russie pourrait redevenir un leader spatial. Mais ça n’arrivera pas. Pas avec le système actuel. Pas avec la corruption endémique. Pas avec les priorités militaires qui vampirisent les budgets. Alors Roscosmos continuera de décliner, lentement mais sûrement, jusqu’à devenir une ombre de ce qu’elle fut.
Section 9 : la géopolitique spatiale en 2025
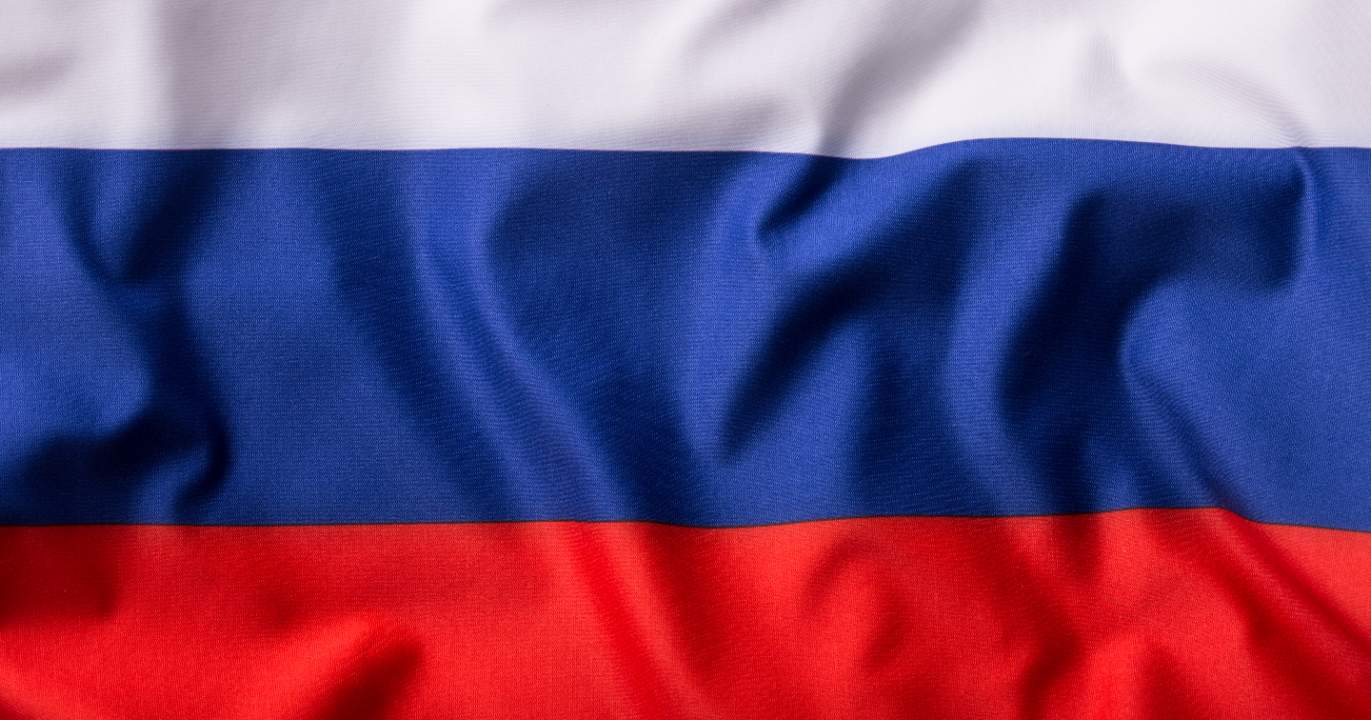
Un espace de plus en plus fragmenté
Le lancement du 29 décembre 2024 depuis Vostochny n’est pas un événement isolé. Il s’inscrit dans une tendance plus large : la fragmentation croissante du secteur spatial le long de lignes géopolitiques. Pendant la Guerre froide, l’espace était un terrain d’affrontement entre deux superpuissances, les États-Unis et l’URSS. Après l’effondrement soviétique, une brève période de coopération internationale s’est ouverte, symbolisée par la construction de la Station spatiale internationale, projet réunissant Américains, Russes, Européens, Japonais et Canadiens. Mais depuis une décennie, cette ère de coopération s’efface progressivement. Les tensions géopolitiques terrestres se répercutent dans l’espace. Les sanctions, les boycotts, les restrictions technologiques se multiplient. Les programmes spatiaux deviennent des outils de soft power, des moyens d’affirmer sa puissance, de renforcer ses alliances, d’isoler ses adversaires. L’espace, loin d’être le domaine de coopération pacifique rêvé par les pionniers, devient un nouveau champ de bataille de la rivalité entre grandes puissances.
Cette fragmentation se manifeste de plusieurs manières. D’abord, par la formation de blocs spatiaux distincts. D’un côté, un bloc occidental dominé par les États-Unis, incluant l’Europe, le Japon, le Canada, l’Australie, et de plus en plus l’Inde. De l’autre, un bloc sino-russe, avec la Chine comme puissance montante et la Russie comme partenaire junior, entouré de satellites comme l’Iran, le Bélarus, le Pakistan, certains pays d’Asie centrale. Entre les deux, des pays non-alignés qui tentent de naviguer entre les blocs, profitant des opportunités offertes par chacun. Ensuite, par la militarisation croissante de l’espace. Les satellites militaires se multiplient, les capacités antisatellites se développent, les doctrines stratégiques intègrent de plus en plus la dimension spatiale. Les États-Unis ont créé une Space Force dédiée, la Chine développe des armes antisatellites, la Russie teste régulièrement des systèmes capables de détruire ou d’aveugler des satellites ennemis. L’espace, autrefois sanctuaire, devient un domaine de conflit potentiel.
La Chine, nouvelle superpuissance spatiale
Dans ce paysage géopolitique reconfiguré, la Chine émerge comme le grand gagnant. En l’espace de deux décennies, Pékin est passé du statut de retardataire spatial à celui de superpuissance rivale des États-Unis. Le programme spatial chinois accumule les succès : missions lunaires robotiques, station spatiale nationale en construction, projets martiens, constellation de navigation BeiDou rivale du GPS américain, développement de lanceurs lourds. Surtout, la Chine investit massivement, avec un budget spatial estimé à plus de 10 milliards de dollars par an, et une volonté politique sans faille. Pour Pékin, l’espace est un domaine stratégique crucial, à la fois pour des raisons de prestige national, de développement technologique, et de sécurité militaire. Le Parti communiste chinois a fait de la conquête spatiale une priorité nationale, mobilisant des ressources considérables et planifiant sur le long terme. Le résultat : une montée en puissance spectaculaire qui inquiète Washington.
Face à cette ascension chinoise, les États-Unis tentent de maintenir leur leadership spatial, mais avec des résultats mitigés. D’un côté, le secteur privé américain, mené par SpaceX, révolutionne l’industrie avec des innovations majeures comme les fusées réutilisables. De l’autre, la NASA peine à concrétiser ses ambitions lunaires avec le programme Artemis, confronté à des retards et des dépassements budgétaires. L’Europe, quant à elle, tente de préserver son indépendance d’accès à l’espace, mais avec des moyens limités et une gouvernance complexe impliquant de nombreux pays aux intérêts parfois divergents. La Russie, comme nous l’avons vu, décline lentement, s’appuyant sur ses acquis historiques mais incapable de rivaliser avec les investissements chinois ou américains. Dans ce contexte, des missions comme celle du 29 décembre 2024 prennent tout leur sens. En lançant des satellites pour l’Iran, le Bélarus et d’autres pays marginalisés par l’Occident, la Russie tente de maintenir sa pertinence géopolitique, de préserver son statut de puissance spatiale, même si ce statut est de plus en plus contesté.
On assiste à une nouvelle Guerre froide spatiale. Sauf que cette fois, ce n’est pas binaire. Ce n’est pas juste les États-Unis contre l’URSS. C’est plus complexe, plus fluide, plus dangereux aussi. La Chine monte, la Russie décline, l’Amérique tente de maintenir sa domination, l’Europe cherche sa place. Et au milieu de tout ça, des dizaines de pays qui veulent leur part du gâteau spatial, qui développent leurs propres capacités, qui nouent des alliances. C’est fascinant et terrifiant à la fois. Fascinant parce que l’espace se démocratise, devient accessible à plus d’acteurs. Terrifiant parce que cette démocratisation s’accompagne d’une militarisation, d’une fragmentation, d’une perte de coopération. On s’éloigne du rêve d’un espace pacifique, domaine commun de l’humanité. On se rapproche d’un espace conflictuel, terrain de rivalités et de confrontations.
Section 10 : les enjeux techniques et opérationnels
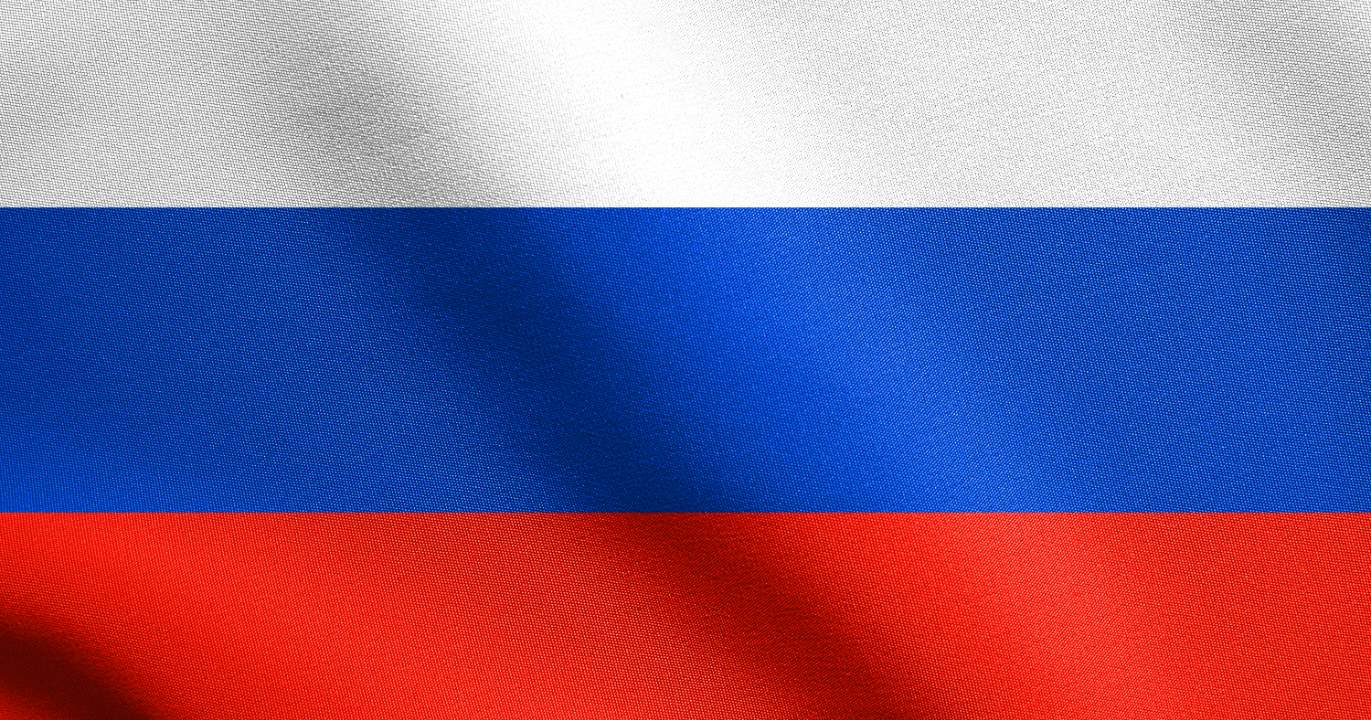
La complexité d’un lancement multiple
Lancer cinquante-deux satellites en une seule mission n’est pas une mince affaire. Cela requiert une coordination technique extrêmement précise, une planification minutieuse, et une exécution sans faille. Chaque satellite a ses propres exigences : orbite cible, orientation, moment de séparation, fréquences de communication. L’étage supérieur Fregat doit orchestrer cette chorégraphie complexe, effectuant de multiples allumages de son moteur, ajustant sa trajectoire, larguant les satellites un par un ou par groupes au moment optimal. La moindre erreur peut compromettre la mission, envoyer un satellite sur la mauvaise orbite, provoquer une collision. Les ingénieurs de RKTs Progress et de NPO Lavochkin, les entreprises responsables de la fusée Soyuz et de l’étage Fregat, ont passé des mois à préparer cette mission, simulant chaque phase, vérifiant chaque paramètre, s’assurant que tout fonctionnerait comme prévu. Le succès du lancement témoigne de leur expertise et de leur professionnalisme.
Un autre défi majeur concerne l’intégration des charges utiles. Les cinquante satellites secondaires proviennent de sources diverses : universités russes, entreprises commerciales, agences spatiales étrangères. Chacun a été développé indépendamment, avec ses propres spécifications, ses propres interfaces. Il faut les intégrer dans des conteneurs de lancement standardisés, les fixer solidement pour résister aux vibrations et aux accélérations du décollage, tout en garantissant qu’ils se sépareront proprement une fois en orbite. Les deux satellites principaux Aist-2T, pesant 670 kilogrammes chacun, occupent la position centrale, fixés directement sur l’adaptateur de charge utile de Fregat. Autour d’eux, les cinquante charges secondaires sont réparties dans dix-sept conteneurs de lancement fournis par Aerospeis Kapital, une société moscovite spécialisée dans ces systèmes. Certains conteneurs abritent un seul satellite de taille moyenne, d’autres contiennent plusieurs cubesats empilés. L’ensemble est protégé par la coiffe 81KS, une structure en forme d’ogive qui protège les satellites pendant la traversée de l’atmosphère, avant de se séparer en deux moitiés et de retomber vers la Terre.
Les défis de la gestion du trafic spatial
Une fois en orbite, les cinquante-deux satellites rejoignent les milliers d’engins déjà présents dans l’espace. La gestion du trafic spatial devient un enjeu crucial. Avec la multiplication des lancements, notamment des méga-constellations comme Starlink de SpaceX qui compte déjà plusieurs milliers de satellites, le risque de collision augmente. Chaque nouveau satellite doit être catalogué, suivi, ses paramètres orbitaux constamment mis à jour. Les opérateurs doivent coordonner leurs activités, éviter les zones encombrées, effectuer des manœuvres d’évitement si nécessaire. Les débris spatiaux, fragments de satellites détruits ou de fusées abandonnées, compliquent encore la situation. On estime qu’il y a actuellement plus de 30 000 objets de plus de 10 centimètres en orbite terrestre, et des millions de fragments plus petits. Une collision avec l’un de ces débris peut détruire un satellite opérationnel, créant à son tour de nouveaux débris dans une réaction en chaîne catastrophique connue sous le nom de syndrome de Kessler.
La Russie, comme les autres puissances spatiales, est consciente de ce problème. Roscosmos maintient un système de surveillance spatiale qui suit les objets en orbite et alerte les opérateurs en cas de risque de collision. L’étage Fregat, après avoir déployé tous ses satellites, effectue une manœuvre de désorbitation pour se détruire dans l’atmosphère, évitant ainsi de devenir un débris supplémentaire. Mais ces efforts restent insuffisants face à l’ampleur du problème. Il n’existe pas de réglementation internationale contraignante sur les débris spatiaux, pas d’autorité mondiale chargée de gérer le trafic orbital. Chaque pays agit selon ses propres règles, ses propres priorités. Le résultat : une situation de plus en plus chaotique, où le risque d’accident majeur augmente chaque année. Certains experts prédisent qu’à ce rythme, certaines orbites pourraient devenir inutilisables d’ici quelques décennies, rendues trop dangereuses par la densité de débris. C’est une tragédie des communs spatiale : chacun profite de l’espace, mais personne ne veut payer le coût de son nettoyage ou de sa régulation.
Les débris spatiaux, c’est notre héritage toxique pour les générations futures. On pollue l’espace comme on a pollué les océans, l’atmosphère, les sols. Avec la même insouciance, la même myopie à court terme. Chaque lancement ajoute des objets en orbite. Chaque satellite en fin de vie devient un débris potentiel. Chaque collision crée des milliers de fragments. Et on continue. On lance toujours plus, toujours plus vite, sans vraiment se soucier des conséquences à long terme. Parce que l’espace semble infini, parce que les orbites semblent vastes, parce qu’on se dit que quelqu’un trouvera bien une solution plus tard. Sauf que l’espace n’est pas infini. Les orbites utiles sont limitées. Et les solutions, elles coûtent cher, elles demandent de la coopération internationale, elles nécessitent qu’on mette de côté nos rivalités géopolitiques. Bonne chance avec ça.
Section 11 : l'avenir de Vostochny et du spatial russe
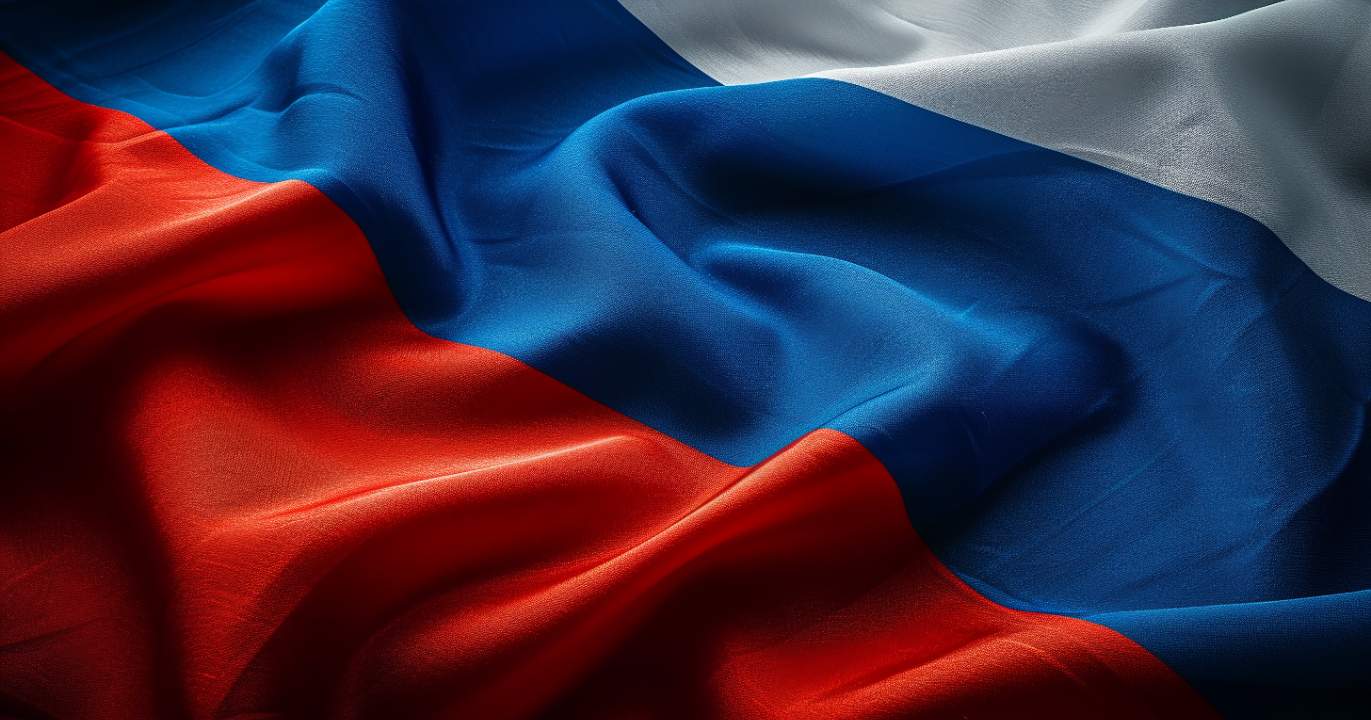
Des projets ambitieux sur le papier
Malgré les difficultés actuelles, Roscosmos continue d’afficher des ambitions pour Vostochny. Le cosmodrome est censé devenir le principal port spatial russe, remplaçant progressivement Baïkonour. Un second complexe de lancement, destiné aux futures fusées lourdes Angara-A5, est en construction depuis plusieurs années. Ces lanceurs, plus puissants que les Soyuz, permettraient à la Russie de mener des missions plus ambitieuses : satellites lourds, missions interplanétaires, vols habités vers la Lune. Sur le papier, Angara représente l’avenir du spatial russe, un système moderne utilisant du kérosène et de l’oxygène liquide, modulaire, capable de s’adapter à différents types de missions. Dans la réalité, le programme Angara accumule les retards depuis plus de vingt ans. Le premier vol d’essai a eu lieu en 2014, mais la production en série tarde à démarrer. Les coûts explosent, les problèmes techniques se multiplient, et le pas de tir de Vostochny, initialement prévu pour 2021, puis 2023, puis 2025, n’est toujours pas terminé.
Au-delà d’Angara, Roscosmos évoque régulièrement des projets encore plus ambitieux. Une station spatiale nationale russe, qui remplacerait la participation à l’ISS après 2028. Des missions lunaires habitées. Une base permanente sur la Lune, en coopération avec la Chine. Des missions vers Mars. Tout cela sonne bien dans les discours officiels, dans les présentations PowerPoint, dans les annonces médiatiques. Mais les observateurs avertis restent sceptiques. Avec un budget de 2 milliards de dollars par an, comment financer tout cela ? Comment rattraper le retard technologique accumulé ? Comment surmonter les problèmes de corruption et de mauvaise gestion qui plombent l’industrie spatiale russe ? Les réponses à ces questions restent floues. Roscosmos semble prisonnière d’un cercle vicieux : les échecs et les retards érodent la confiance, ce qui réduit les financements, ce qui entraîne de nouveaux échecs et retards. Sortir de cette spirale nécessiterait des réformes profondes, un leadership fort, une vision claire. Rien de tout cela n’est visible à l’horizon.
Le partenariat avec la Chine, bouée de sauvetage ?
Face à ces difficultés, la Russie se tourne de plus en plus vers la Chine comme partenaire spatial. Pékin et Moscou ont annoncé en 2021 un projet commun de station de recherche lunaire internationale, une alternative à l’initiative américaine Artemis. Ce partenariat sino-russe dans l’espace s’inscrit dans un rapprochement stratégique plus large entre les deux pays, unis par leur opposition à l’hégémonie occidentale. Pour la Russie, s’allier avec la Chine présente des avantages évidents : accès aux financements chinois, partage des coûts de développement, maintien d’un rôle dans les grandes missions spatiales. Mais cette alliance comporte aussi des risques. La Chine est désormais la puissance dominante dans ce partenariat, et la Russie risque de devenir un partenaire junior, fournissant de la technologie et de l’expertise mais sans réel pouvoir de décision. C’est un renversement ironique de la situation des années 1950-1960, quand l’URSS était le mentor et la Chine l’élève en matière spatiale.
Le projet de station lunaire sino-russe illustre cette dynamique. Sur le papier, c’est un partenariat égalitaire. Dans la réalité, la Chine apporte la majeure partie du financement et de la technologie moderne, tandis que la Russie contribue principalement avec son expertise historique et ses systèmes éprouvés. Pour Moscou, c’est mieux que rien. Cela permet de rester dans la course spatiale, de participer aux grandes missions du XXIe siècle, même dans un rôle diminué. Mais c’est aussi une reconnaissance implicite du déclin russe. L’héritier du programme spatial soviétique, qui a dominé l’espace pendant des décennies, se retrouve dans l’ombre de son ancien protégé. C’est une pilule amère à avaler pour les nostalgiques de la grandeur spatiale russe. Mais c’est aussi la réalité géopolitique de 2025 : la Chine monte, la Russie s’adapte, et l’équilibre des forces dans l’espace se reconfigure en conséquence. Vostochny, dans ce contexte, pourrait devenir un hub pour les missions sino-russes, un point de lancement pour des projets communs. Ou il pourrait rester sous-utilisé, symbole des ambitions déçues d’une puissance spatiale en déclin.
Le partenariat sino-russe dans l’espace, c’est un mariage de raison. Pas d’amour, pas de confiance profonde, juste des intérêts convergents. La Chine a besoin de l’expertise russe, de ses technologies éprouvées, de son expérience spatiale. La Russie a besoin de l’argent chinois, de ses capacités industrielles, de son dynamisme. Ensemble, ils peuvent rivaliser avec l’Occident, créer une alternative crédible aux programmes américains et européens. Mais pour combien de temps ? Que se passera-t-il quand la Chine n’aura plus besoin de la Russie, quand elle aura absorbé toute l’expertise, développé ses propres technologies ? Moscou se retrouvera seul, dépassé, relégué au rang de puissance spatiale de second ordre. C’est peut-être inévitable. C’est peut-être le prix à payer pour avoir laissé le secteur spatial se délabrer pendant des décennies. Mais c’est triste quand même.
Conclusion : un lancement qui en dit long sur notre époque

Au-delà de la prouesse technique
Le lancement du 29 décembre 2024 depuis Vostochny était, techniquement parlant, un succès. Cinquante-deux satellites placés en orbite, aucun incident majeur, une démonstration de la fiabilité russe dans le domaine spatial. Mais au-delà de la prouesse technique, cette mission révèle des dynamiques géopolitiques profondes qui redessinent le paysage spatial mondial. Elle montre une Russie isolée qui se tourne vers des partenaires marginalisés par l’Occident – l’Iran, le Bélarus – pour maintenir sa pertinence. Elle illustre la fragmentation croissante du secteur spatial le long de lignes politiques, avec la formation de blocs rivaux qui reproduisent dans l’espace les tensions terrestres. Elle témoigne des difficultés structurelles de Roscosmos, une agence spatiale autrefois glorieuse qui peine désormais à rivaliser avec les investissements chinois ou l’innovation américaine. Et elle soulève des questions sur l’avenir de la coopération spatiale internationale, sur la durabilité des activités orbitales face à la prolifération des débris, sur le rôle de l’espace dans les rivalités géopolitiques du XXIe siècle.
Ce lancement nous rappelle aussi que l’espace n’est pas un domaine à part, isolé des réalités terrestres. Les satellites qui tournent au-dessus de nos têtes sont des outils de pouvoir, des instruments de surveillance, des moyens de communication et de navigation dont dépendent nos sociétés modernes. Contrôler l’accès à l’espace, c’est exercer une forme de pouvoir sur le monde. Et dans cette compétition pour le contrôle spatial, la Russie tente de maintenir sa position malgré des ressources déclinantes et un isolement croissant. Vostochny, ce cosmodrome perdu dans la taïga sibérienne, devient ainsi un symbole de cette lutte pour la pertinence géopolitique. Chaque lancement depuis ce site est une affirmation de souveraineté, une démonstration de capacité, un message envoyé aux rivaux et aux alliés. Le 29 décembre 2024, ce message était clair : la Russie reste une puissance spatiale, capable de lancer des missions complexes, disposée à aider ceux que l’Occident a abandonnés. Que ce message soit entendu ou ignoré, qu’il soit perçu comme une menace ou une opportunité, dépend de la perspective de chacun.
L’espace, miroir de nos divisions
En fin de compte, cette mission depuis Vostochny nous renvoie à une question fondamentale : quel avenir voulons-nous pour l’espace ? Un espace fragmenté, divisé en blocs rivaux, où chaque puissance poursuit ses propres intérêts sans se soucier du bien commun ? Ou un espace coopératif, régi par des règles internationales, où les bénéfices de l’exploration et de l’exploitation spatiales sont partagés équitablement ? La réponse à cette question déterminera non seulement l’avenir du secteur spatial, mais aussi, dans une certaine mesure, l’avenir de l’humanité. Car l’espace représente à la fois une opportunité immense – ressources, connaissances, expansion de notre civilisation – et un risque existentiel si nous le transformons en champ de bataille. Le lancement du 29 décembre 2024, avec ses satellites iraniens, biélorusses, équatoriens, russes, nous montre que nous sommes actuellement sur la mauvaise trajectoire. Nous reproduisons dans l’espace les erreurs que nous avons commises sur Terre : nationalisme, rivalités, militarisation, exploitation sans régulation.
Mais il n’est pas trop tard pour changer de cap. L’espace reste largement inexploré, largement inexploité. Les opportunités de coopération existent encore, si nous avons la sagesse de les saisir. Les défis communs – débris spatiaux, météorites, exploration lointaine – nécessitent des réponses communes. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seul ces défis. La Russie, malgré ses problèmes, possède une expertise spatiale précieuse qui pourrait bénéficier à l’humanité entière si elle était partagée plutôt que monopolisée. L’Iran, le Bélarus, l’Équateur et tous les autres petits acteurs spatiaux ont le droit de participer à l’aventure spatiale, de développer leurs capacités, de contribuer à l’exploration commune. Exclure ces pays, les marginaliser, les pousser dans les bras de puissances rivales, c’est non seulement contre-productif, c’est aussi moralement indéfensible. L’espace appartient à tous, ou il n’appartient à personne. C’est un principe inscrit dans le Traité de l’espace de 1967, mais que nous semblons avoir oublié dans notre course effrénée à la domination spatiale. Le lancement depuis Vostochny nous rappelle brutalement cette vérité : tant que nous traiterons l’espace comme un terrain de jeu géopolitique, nous passerons à côté de son véritable potentiel.
Je regarde ces cinquante-deux satellites qui tournent maintenant au-dessus de nos têtes, et je me demande ce qu’ils voient. Voient-ils les frontières que nous avons tracées sur Terre ? Les murs que nous avons érigés entre nous ? Les guerres que nous menons, les sanctions que nous imposons, les haines que nous cultivons ? Ou voient-ils simplement une planète bleue, fragile, unique, habitée par une espèce qui a la capacité extraordinaire d’atteindre les étoiles mais qui choisit trop souvent de se déchirer elle-même ? L’espace devrait nous unir. Il devrait nous rappeler notre humanité commune, notre destin partagé. Au lieu de ça, on en fait un nouveau terrain de confrontation. On reproduit là-haut les erreurs d’ici-bas. Et pendant qu’on se dispute, pendant qu’on se sanctionne mutuellement, pendant qu’on construit nos petits empires orbitaux, l’univers continue son expansion, indifférent à nos querelles mesquines. Un jour, peut-être, on comprendra. Un jour, peut-être, on regardera en arrière et on se demandera pourquoi on a gâché tant de temps, tant d’énergie, tant d’opportunités. Mais ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Alors en attendant, la Russie lance ses satellites, l’Iran construit ses capacités, le Bélarus suit Moscou, et l’Occident regarde ailleurs, convaincu de sa supériorité morale. Et l’espace, lui, attend. Patient. Infini. Indifférent.
Sources
Sources primaires
TASS (Agence de presse russe) – « Russia launches satellites for its allies from Vostochny spaceport » – 29 décembre 2024 – https://tass.com/science/2066061
TASS (Agence de presse russe) – « Fregat upper stage with 52 satellites separates from Soyuz-2.1b rocket » – 29 décembre 2024 – https://tass.com/science/2065933
RussianSpaceWeb.com – « Soyuz rocket launches the Aist-2T pair, Iranian satellites » – Anatoly Zak – 28 décembre 2024 – https://russianspaceweb.com/aist2t.html
Sources secondaires
Space.com – « Russia launches satellite for Iran toward orbit alongside 2 space weather probes » – Mike Wall – 25 juillet 2025 – https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/russia-launches-2-space-weather-satellites-iranian-spacecraft-to-orbit
Iran International – « Iran set to orbit three satellites in joint launch from Russia » – 22 décembre 2024 – https://www.iranintl.com/en/202512224276
IRNA (Agence de presse iranienne) – « Iran launches three domestically built satellites aboard Russian rocket » – 28 décembre 2024 – https://en.irna.ir/news/86038360/
Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.