La succession des frappes qui marquent l’absence de retour en arrière possible
Revenons au début de ce cauchemar progressif qui s’est déplié en 2025. En février, Trump lance le signal : la campagne de pression maximale revient. Le maximum pressure, ce vieux serpent qu’on croyait mort avec l’administration Biden, renaît de ses cendres. Trump qui dit vouloir négocier avec les Iraniens, qui prétend préférer un accord à des bombardements — mais Trump qui, simultanément, ordonne aux généraux et aux conseillers de se préparer à oblitérer l’Iran s’il était assassiné. C’est du pur Trump : parler paix en préparant la guerre. Khamenei, en février déjà, refuse tous les pourparlers. L’Iran ne négocie pas sous la menace, affirme Téhéran. Les généraux des Gardiens de la révolution menacent les bases américaines de « dévastateur ». L’atmosphère s’épaissit, devient irrespirable.
Puis vient le mois de mars. Trump menace de tenir le régime iranien responsable si un seul missile houthi explose quelque part en direction d’un navire américain. C’est un ultimatum clair : l’Iran sera tenu pour comptable des actes de ses alliés yéménites. C’est dire à l’Iran qu’il n’existe aucune zone de liberté, aucun espace où il pourrait agir sans risquer la destruction. Ensuite, en avril, les choses s’accélèrent. Ali Larijani, conseiller de Khamenei, menace Trump directement : l’Iran fabriquera des armes nucléaires si la pression persiste. Et plus loin — et c’est crucial — les militaires iraniens recommandent une frappe préventive sur les bases américaines. La chaîne de commandement iranienne envisage sérieusement de frapper en premier. C’est le moment où tout bascule dans l’irremédiable. Les deux puissances cessent de calculer les risques et commencent à préparer les actes.
Le dénouement de juin : l’escalade totale
Et puis le 13 juin arrive. Cette date mériterait d’être inscrite en rouge dans les manuels d’histoire du Moyen-Orient. Israël lance son offensive contre l’Iran — non comme une réplique à une attaque précédente, mais comme une attaque dite préventive. Tel-Aviv justifie cela par la nécessité de neutraliser le programme nucléaire iranien, de détruire les usines de missiles, de frapper les Gardiens de la révolution. Mais ce qui se passe vraiment, c’est la première véritable guerre directe entre Israël et l’Iran depuis la nuit des temps. Plus de tirs de missiles échangés depuis des pays tiers. Plus de jeux d’ombres. C’est du face-à-face brutal. Bombardiers israéliens au-dessus de Téhéran. Drones. Missiles de croisière. L’Iran riposte. De juillet à octobre, l’escalade se perpétue : attaques de drones, frappes sur les infrastructures civiles et militaires. L’Iran affirme que son programme nucléaire demeure strictement civil, que tout cela n’est que prétexte. Personne n’écoute plus. Les armes parlent seules maintenant.
Washington verrouille les portes : la stratégie du verrouillage systématique

Les bases militaires comme instruments de contrôle régional permanent
Énumérons-les, ces bases. Énumérons simplement leur présence. Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Diego Garcia — l’océan Indien et le Golfe deviennent des étendues militarisées par Washington. Ce ne sont pas des postes d’écoute discrets. Ce sont des machineries de guerre, des dépôts de missiles, des centres de commandement d’où les ordres de destruction s’envolent vers les quatre coins. Pour l’Iran, c’est comme d’être assiégé de tous côtés. Le Golfe n’est pas un espace de commerce libre; c’est un champ clos américain. La liberté de navigation tant vantée par Washington, c’est la liberté sous supervision, la liberté sous les canons. Oman appelle en novembre 2025 à la reprise des pourparlers — un appel désespéré venant du seul médiateur qui ait jamais compté. Mais comment pourrait-on médier quand l’une des parties dispose de l’écrasante supériorité militaire et en use régulièrement ?
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio visite Israël en septembre 2025 pour réaffirmer l’appui inébranlable des États-Unis. Cet adjectif — inébranlable — c’est tout dire. L’Amérique promet à son allié que rien ne changera, que peu importe ce qu’Israël fait, même si c’est bombarder le Qatar en tuant des civils, les États-Unis seront là. C’est une garantie de blanche-seing. Et c’est exactement ce qui pousse l’Iran à penser qu’il n’existe aucun intérêt américain qu’il pourrait servir, aucun compromis qui pourrait l’éloigner de la pression constante. Pourquoi négocier si les dés sont déjà jetés, si Washington a déjà choisi son camp de manière irréversible ?
L’ingérence systématique dans les affaires régionales
Regardons comment les États-Unis interviennent en Irak. En avril 2025, des congressmen américains, Joe Wilson et Jimmy Panetta, introduisent une legislation appelée le « Free Iraq from Iran ». L’ironie du titre — libérer l’Irak de l’Iran — alors que c’est l’Irak qui a voté librement des gouvernements en coalition avec l’Iran, c’est l’Irak qui a fait ses propres choix diplomatiques. Mais cette legislation mandates le développement d’une stratégie américaine pour « irréversiblement démanteler » les milices soutenues par l’Iran. Elle impose des sanctions à des figures politiques et militaires irakiennes alignées avec l’Iran. Elle fournit un soutien à la « société civile » irakienne — ce qui signifie, dans la langue diplomatique, les groupes d’opposition à l’influence iranienne. C’est de l’ingérence, c’est de la reconquête par procuration, c’est l’Amérique qui refuse d’accepter que l’Irak ait ses propres comptes à régler avec l’Iran.
Et au Yémen ? La même tactique. Les Houthis, financés par l’Iran selon Washington, posaient un problème à la navigation dans la mer Rouge. Qu’a fait Trump ? Il a lancé des opérations aériennes massives en mars 2025 contre les infrastructures houthis. Deux mois de bombardements intensifs. Et puis, surprrise, en mai il annonce un cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce qu’il voulait impressionner les États du Golfe, satisfaire leurs appétits d’apaisement, et peut-être montrer à l’Iran que Washington avait les mains libres pour frapper ses alliés sans que personne ne puisse rien faire. C’est un message : rejoignez notre camp ou nous frappons vos amis. C’est du chantage, mais du chantage militaire, massif, inévitable.
L'impossible négociation : où les mots se brisent contre la réalité

Les pourparlers de 2025 : illusion d’une sortie de crise
En avril 2025, quelque chose s’est produit. Les États-Unis et l’Iran se sont assis à une table. Par l’intermédiaire d’Oman, un pays qui joue depuis des années le rôle crucial de médiateur, les deux puissances ont engagé des négociations sur le nucléaire. C’était supposé être un moment d’apaisement. Après les débâcles de l’administration Biden, après les promesses de Trump de chercher des accords plutôt que des guerres, on espérait. Vraiment on espérait. Puis l’Iran annonce en juin qu’il va soumettre sa propre proposition pour un accord nucléaire. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, parle de cadre « raisonnable, logique et équilibré ». Le vice-ministre Majid Takht-Ravanchi affirme qu’une négociation approfondie pourrait débuter sur les détails.
Et puis… rien. Ou plutôt, ce qui se passe après, c’est le 13 juin. Les bombes israéliennes tombent. Les Américains frappent les sites nucléaires iraniens. Et tous les pourparlers s’effondrent. Les négociations sur le nucléaire sont gelées depuis la guerre éclair de juin, affirme-t-on poliment. Gelées. C’est un mot intéressant. Ça veut dire qu’elles n’ont pas disparu, juste qu’elles attendent. Mais comment attendre quand on vient de bombarder directement les installations que tu étais censé négocier ? Comment revenir à une table quand l’autre partie vient de frapper vos villes ? C’est dérisoire. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, réaffirme bien sûr que Téhéran veut reprendre les discussions — mais uniquement sur le nucléaire, à l’exclusion de tout débat sur les missiles balistiques. C’est-à-dire : nous ne céderons rien sur nos défenses. Nous ne désarmerons pas sur les seules armes qui nous protègent d’une attaque directe.
L’Iran propose, l’Amérique impose : l’asymétrie fondamentale
Voilà ce qui est crucial à comprendre. L’Iran, affaibli, frappe, bombarde depuis des bases militaires en sol iranien. L’Iran propose des accords qui reconnaissent sa souveraineté territoriale, la légitimité de ses programmes civils. L’Iran demande que les sanctions — ces sanctions qui étouffent son économie depuis des années — soient levées. Le ministre iranien du Parlement Mohammad-Bagher Ghalibaf affirme que la proposition américaine reçue en mai — dont le contenu reste secret — ne résout pas la question cruciale de la levée des sanctions. Washington soutient le contraire : oui, nous lèverons les sanctions, mais d’abord, vous démontrez que vos programmes sont civils, d’abord vous acceptez nos inspecteurs, d’abord vous renoncez à enrichir l’uranium au-delà des limites, d’abord, d’abord, d’abord.
C’est toujours pareil. Les Américains veulent une reddition étalée sur le temps. D’abord tu montres bonne volonté, et on te pardonne un peu. Puis tu montres plus de bonne volonté, et on te pardonne davantage. Mais jamais, au grand jamais, tu n’es véritablement restauré. L’Iran veut un échange simultané : je reconnais ma subordination diplomatique, et vous me traitez comme une nation respectable. L’Amérique refuserait que l’Iran soit jamais traité comme une nation respectable. C’est la différence radicale. C’est aussi la raison pour laquelle ces pourparlers étaient morts-nés dès le départ. Oman appelle encore à la reprise. Mais qui écoute ? Personne ne regarde Oman. Tout le monde regarde Washington et Téhéran, deux puissances qui ne parlent plus que par les armes.
La rhétorique de la puissance : comment Trump perpétue l'héritage du siège

Le maximum pressure 2.0 : une doctrine immonde et immuable
Trump revient au pouvoir en 2025 et sa première impulsion, c’est de restaurer le maximum pressure. Cette vieille doctrine qui proclamait qu’on pourrait affamer une nation entière jusqu’à la soumission. Sous Trump 1.0, les sanctions contre l’Iran étaient si draconiennes que l’Iran perdait des milliards de dollars en exportations pétrolières annuelles. On en parlait pas assez, mais cela signifiait que des hôpitaux iraniensmanquaient de médicaments, que des patients cancéreux n’avaient pas accès aux radiothérapies, que les universités iraniennes ne pouvaient plus acheter d’équipements de recherche. C’est du siège, c’est du siège moderne, c’est de la destruction économique méthodique. Et Trump revient avec la même idée. Le secrétaire d’État Mike Pompeo, sous la première présidence Trump, disait que c’était un moyen de « ramener Washington à une position d’avantage ». Avantage — comme si c’était un jeu. Comme si la vie de millions de personnes n’était qu’un pion sur un échiquier.
Et maintenant Trump menace explicitement l’Iran. Il dit aux généraux de préparer une oblitération totale si lui, Trump, venait à être assassiné. C’est une promesse de destruction nucléaire prononcée tranquillement, comme si on parlait de la météo. L’Iran comprend le message. S’il y a un attentat contre Trump — n’importe quel attentat — l’Iran sera rendu responsable et sera détruit. C’est un régime de culpabilité assignée d’avance. C’est dire à l’Iran : il n’existe aucune situation où vous ne serez pas blâmés. Même si vous n’aviez rien à voir avec quelque chose, vous le paierez. C’est un système d’injustice totale institutionnalisée. Et c’est cela que proposent les État-Unis au monde : une ordre où les faibles doivent accepter la culpabilité éternelle et où les forts décident de tout.
Les alliés régionaux : le ciment de l’enfermement américain
Mais Washington ne peut pas faire tout cela seul. Washington a besoin de partenaires régionaux pour maintenir la pression. Les États du Golfe — l’Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, le Koweït — se sont peu à peu rangés derrière Washington. Pas tous de façon enthousiaste. L’Arabie Saoudite, par exemple, a des relations complexes avec l’Iran. Il y a la concurrence pour l’influence au Yémen, il y a les différends religieux (les Saoudiens sont wahhabites sunites, les Iraniens chiites), il y a la lutte pour le marché pétrolier régional. Mais il n’existe aucun accord fondamental entre Washington et Riyad sur comment détruire l’Iran. Washington voudrait voir l’Iran militairement annihilé. L’Arabie Saoudite voudrait juste que l’Iran n’interfère plus dans ses affaires régionales.
Israël, lui, c’est une affaire différente. Israël a réellement bombardé le territoire iranien directement. Israël n’a pas cherché de permission. Israël a décidé que le moment était venu et a frappé. Et les Américains, loin d’être choqués, ont frappé eux aussi. C’est une alliance de fait dans la destruction de l’Iran. Et Khamenei le sait. Khamenei sait que tant que Washington soutient Israël — et Washington n’arrêtera jamais de soutenir Israël, c’est un pilier fondamental de la politique américaine depuis 1948 — il n’existe aucun chemin vers la paix pour l’Iran. L’Iran sera toujours dans le collimateur. Il y a quelque chose de cauchemardesque à regarder Khamenei énoncer une condition qu’il sait être impossible. Mais c’est justement ce qui confère à sa déclaration une autorité morale certaine. Il dénonce l’absurdité du système en l’énonçant, en la rendant visible.
Le programme nucléaire : le prétexte et la réalité cachée

Une affaire de programme civil qui refuse simplement de mourir
Revenons au cœur technique de cette affaire. L’Iran affirme — depuis le début, obstinément — que son programme nucléaire est strictement civil. Qu’il cherche à produire de l’électricité. Qu’il n’a aucune ambition d’armes atomiques. Le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) reconnaît ce droit à tous les États signataires. L’Iran est signataire. L’Iran, théoriquement, a le droit d’enrichir l’uranium, dans des limites. Mais voilà : ces limites, qui les fixe ? Washington, avec ses alliés. Et ces limites, qui les vérifie ? Une agence internationale, l’AIEA, mais une agence dont le directeur change et dont les positions épousent largement les intérêts occidentaux. Lorsqu’un inspecteur de l’AIEA arrive en Iran, il est accueilli par une administration hostile, méfiante. Parce que l’Iran sait qu’on cherche à le piéger. On lui dit : vous avez le droit d’enrichir, mais pas au-delà de 3,67 %. Vous avez le droit d’avoir des centrifugeuses, mais pas trop. Vous avez le droit d’avoir un programme, mais pas le droit d’avoir l’indépendance technologique.
En 2025, après les bombardements de juin, l’Iran remet en question les limites qu’on lui a imposées. L’Iran dit : vous m’avez frappé, vous avez attaqué directement, et vous attendez de moi que je respecte un accord ? Quel accord ? L’accord sur le nucléaire — le JCPOA, signé en 2015 — a essentiellement explodé quand Trump s’en est retiré en 2018. Avant cela, tant que l’accord tenait, l’Iran se conformait. Les inspecteurs le confirmaient régulièrement. Mais Trump a décidé que l’accord ne suffisait pas, que l’Iran était trop dangereux, que l’Amérique devait sortir. Depuis 2018, c’est un cirque de sanctions croissantes et d’enrichissement progressif par l’Iran. Et maintenant, en 2025, après les frappes directes, l’Iran enrichit davantage, et les Occidentaux s’inquiètent. Mais qui a créé cette situation ? Pas l’Iran. L’Amérique a créé cette situation en se retirant de l’accord.
Le nucléaire comme couverture pour une domination plus large
Ce qui me fascine chez les observateurs occidentaux, c’est comment ils traitent le programme nucléaire iranien comme une aberration, une menace existentielle. Mais Israël possède entre 200 et 400 têtes nucléaires. Israël n’a jamais signé le TNP. Israël n’a jamais accepté d’inspections. Israël possède le monopole nucléaire régional depuis les années 1960. Et tout le monde s’en accommode. Pourquoi ? Parce qu’Israël est un allié occidental. Parce que le droit de posséder l’arme atomique n’existe que pour les puissances amies de Washington. Pour les autres, le droit d’enrichir l’uranium — même à titre civil — devient une cause de guerre. C’est une hypocrisie monumentale, une architecture de l’injustice totale. Et l’Iran, en regardant cet ordre international, ne peut que penser une seule chose : c’est absurde, c’est injuste, et je ne peux pas faire confiance à ces gens. Je dois me défendre par mes propres moyens.
Donc quand l’Iran dit aujourd’hui qu’il continuerait de respecter les limites sur le nucléaire — mais que c’est dépendant des conditions américaines — c’est en réalité une affirmation de sa souveraineté. C’est dire : je peux enrichir si je veux. Vous avez frappé mon territoire, vous avez menti sur mes intentions, vous avez occupé mes eaux territoriales avec vos bases militaires. Et vous attendez de moi que je sois docile sur la question qui me touche le plus intimement — ma sécurité ? Non. L’Iran dit : donnez-moi d’abord la levée des sanctions, donnez-moi d’abord la reconnaissance que j’existe, donnez-moi d’abord la promesse que vous ne me frappe pas. Et ensuite, peut-être, nous pourrons parler de programme nucléaire. Mais Washington refuse cette logique. Washington veut d’abord le désarmement, puis la levée des sanctions. C’est l’ordre du maître vers l’esclave, pas l’ordre de deux peuples qui se respectent.
La dernière chance perdue : comment le conflit s'enracine

L’équation insolvable : comment sortir du piège
Voilà où nous en sommes le 3 novembre 2025. Khamenei énonce ses trois conditions. Elles sont impossibles. Elles resteront impossibles. Et pourtant, elles sont justes. C’est la tragédie complète. Khamenei demande à l’Amérique d’abandonner son soutien à Israël — un soutien fondamental depuis plus de soixante-dix ans. Il demande à l’Amérique de retirer ses bases militaires — une revendication que tout État national devrait légitimement posséder. Il demande à l’Amérique de cesser de s’ingérer dans les affaires régionales — une demande universelle de souveraineté que tout peuple devrait accepter. Mais Washington ne peut rien accepter. Washington ne peut pas sacrifier Israël. Washington ne peut pas quitter le Moyen-Orient. Washington ne peut pas accepter l’émergence d’une puissance régionale autonome. Donc Khamenei énonce des conditions dans le plein savoir qu’elles seront refusées. Et en les énonçant, il renforce l’argument que rien ne changera, que la confrontation est inévitable, que l’Iran doit se préparer à la guerre existentielle.
Oman appelle à la reprise des négociations. Oman appelle encore en novembre 2025. Mais personne ne marche. Les États-Unis continuent de frapper les Houthis au Yémen. Les Américains continuent de soutenir Israël malgré ses bombardements inconvenants au Qatar. Les Iraniens continuent de renforcer leurs forces militaires, d’approfondir leurs liens avec la Russie et la Chine, d’accepter que le chemin de la coopération avec l’Ouest est fermé à jamais. C’est une fracture irréversible. Et elle va persister. Elle va s’approfondir. Elle va causer des souffrances incalculables à des gens ordinaires des deux côtés qui n’ont rien demandé que de vivre en paix.
L’engrenage de la méfiance totale
En avril, les États-Unis et l’Iran s’assoient à Oman pour des négociations. Cela signifie qu’au moins symboliquement, on croit encore à une sortie. Puis en juin, Israël bombarde l’Iran, et l’Amérique bombarde l’Iran. Tout s’effondre. C’est comme si Washington prenait soin de démontrer à Khamenei qu’il avait raison. Raison d’être méfiant. Raison de refuser les paroles apaisantes. Raison de croire que seule la puissance militaire fait la différence. Et maintenant, Khamenei durcit sa position. Maintenant, l’Iran refuse simplement. Et pourquoi accepterait-il ? Quel signal avez-vous envoyé en le bombardant ? Quel message avez-vous passé ? Vous avez dit : nous n’avons aucune confiance. Vous avez dit : vos paroles sont vides. Vous avez dit : seul compte la force. Et maintenant vous avez la confrontation que vous avez créée.
En mai, le cessez-le-feu au Yémen entre les États-Unis et les Houthis laisse penser qu’une certaine raison persiste. Trump veut impressionner les États du Golfe. Trump veut montrer qu’il peut maîtriser les situations rapidement. Mais ce cessez-le-feu — qui n’est que militaire, temporaire, conditionnel — n’arrange rien pour l’Iran. Cela signifie simplement que Washington a une corde raide de moins à tenir. Cela signifie que Washington peut se concentrer entièrement sur l’Iran. Cela signifie qu’une pression supplémentaire peut être exercée. Les généraux iraniens le comprennent. Et ils réagissent en recommandant une frappe préventive sur les bases américaines. Mais le système politique iranien refuse encore. Encore en mars, on refuse. Encore en avril, on refuse. Et puis en juin, c’est Israël qui frappe, pas l’Iran. Et ensuite, c’est trop tard. La riposte devient une réaction désespérée, pas une stratégie maîtrisée.
Conclusion
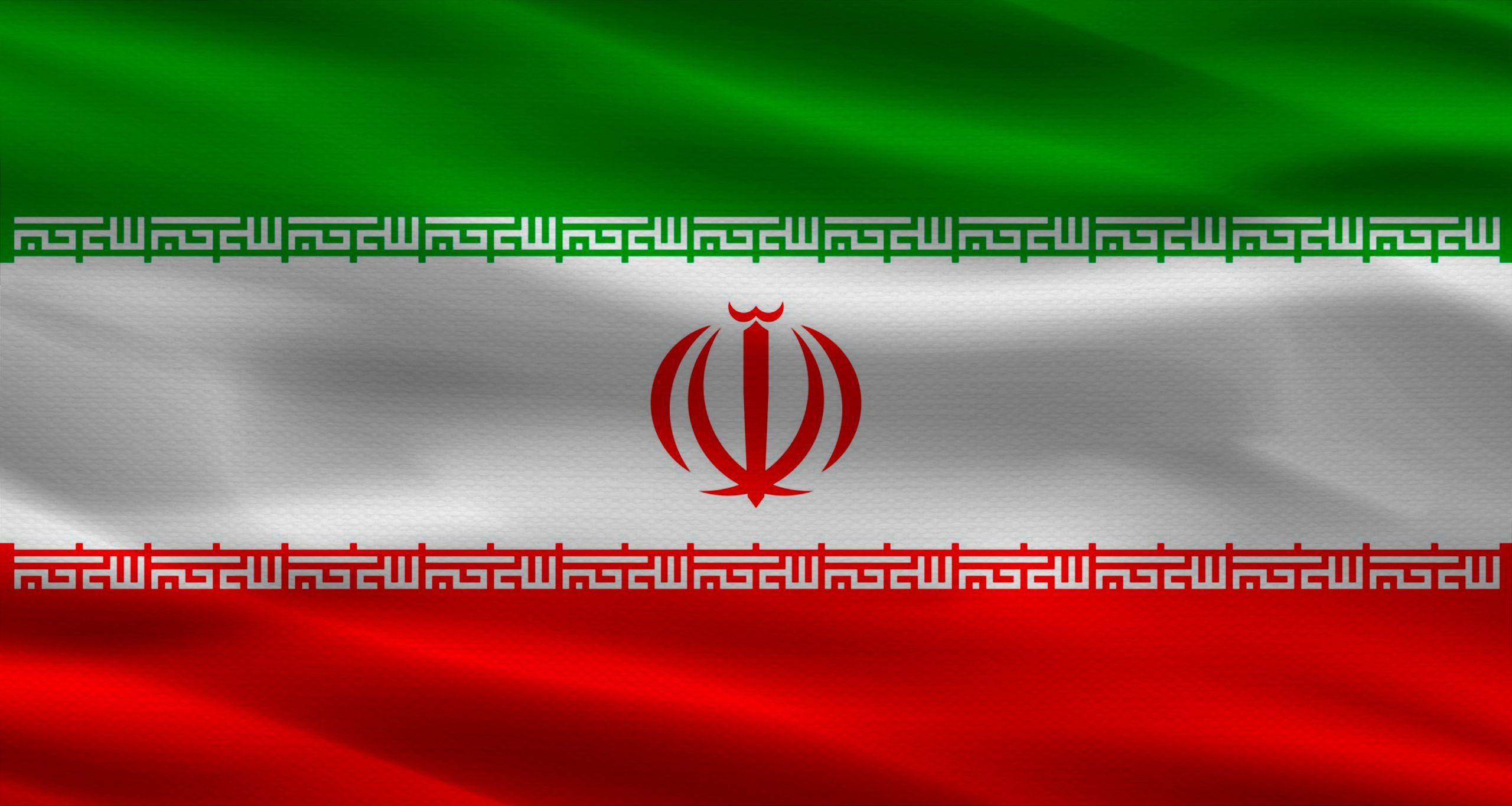
L’Iran a parlé : Washington peut-il encore entendre ?
Lundi 3 novembre 2025, l’ayatollah Ali Khamenei a dit ce qu’il pensait réellement. Et ce qu’il pense, c’est que la route vers Washington est fermée, soudée, imperméable à toute tentative de passage. Trois conditions : l’abandon du soutien à Israël, le retrait des bases militaires, l’arrêt de l’ingérence régionale. Ce ne sont pas des conditions de négociation. Ce sont les énoncés d’une séparation définitive. C’est un acte de pure lucidité, de reconnaissance du fait que quelque chose de fondamental s’est cassé. Et ce qui s’est cassé, c’est cette illusion que coexister était possible, que la diplomatie pouvait traverser le fossé des intérêts divergents. Washington refuse d’accepter l’Iran comme puissance régionale autonome. L’Iran refuse d’accepter la domination américaine. Et entre ces deux refus, il n’existe aucune zone de compromis.
Khamenei pourrait mentir. Il pourrait dire : oui, nous continuerons de négocier, nous cherchons une sortie. Mais il choisit de dire la vérité. La vérité crue, la vérité brutale, la vérité qui enlève toutes les couches de polémique diplomatique et expose l’os. Il dit à Washington : vous avez choisi Israël. Vous avez choisi les bases. Vous avez choisi l’ingérence. Et tant que c’est votre choix, je ne coopère pas. C’est un choix courageux, parce qu’il renonce à tout espoir de changement à court terme. Mais c’est aussi le choix d’un homme qui a regardé les événements de 2025 et qui a compris que rien d’autre ne restait à faire que de dire la vérité.
Oman appelle encore à la reprise des discussions. Les deux puissances pourraient, théoriquement, se relever et marcher. Mais je doute que cela se produise. Je doute parce que chaque action américaine depuis novembre 2024 — quand Trump a annoncé son retour — a poussé l’Iran davantage dans le coin. Le maximum pressure revient. Les alliés d’Israël mobilisent leurs bases. Les menaces deviennent plus explicites. Et Khamenei, en réponse, dessine la limite : c’est ici que je m’arrête. C’est ici que votre monde finit et le mien commence. C’est l’une des plus belles déclarations d’indépendance que l’Iran a jamais énoncée — pas en fanfare, mais en refus tranquille. C’est une affirmation que l’Iran ne sera jamais le jouet de Washington, même si cela doit coûter une génération d’isolation économique, même si cela doit signifier une jeunesse iranienne grandir dans la pauvreté. L’Iran choisit la fierté.
Et pourtant, cela ne règle rien. Cela n’apaise rien. Cela ne ramène la paix nulle part. Cela ne guérit pas les blessures des civils. Cela ne nourrit pas les enfants. C’est une déclaration, c’est un positionnement, c’est une prise de conscience collective qu’une ère s’est terminée. L’ère où on pouvait croire au dialogue, à la diplomatie, au changement progressif. Cette ère est morte en juin 2025 quand les bombes ont tombé. Et maintenant nous vivons dans le monde qui en a résulté — un monde où deux puissances se font face sans pouvoir se parler, où les conditions de paix sont énoncées précisément parce qu’elles sont impossibles à remplir. C’est le Moyen-Orient en 2025 : une région où la clarté de la rupture remplace l’illusion du dialogue.